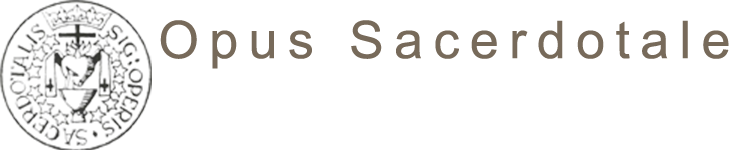Le saint sacrifice de la messe – par M. l’Abbé Cyrille Debris
Le saint sacrifice de la messe
Pour écouter la conférence, cliquez ici :
- Définition traditionnelle
- Un sacrifice unique rendu présent
L’Eucharistie n’est pas un sacrement parmi d’autres (signe visible et efficace d’une grâce invisible) mais le sacrifice permanent de la nouvelle loi par lequel Jésus s’offre toujours au Père par les mains des prêtres. « Le Christ a été immolé une seule fois en lui-même, et cependant, il est immolé chaque jour dans le sacrement » (S. Augustin, cité par ST III, 83, 1) ; « De même en effet que partout est offert un seul corps (du Christ) et non plusieurs ; de même aussi un seul sacrifice » (S. Ambroise, ibidem).
Qui nierait la dimension sacrificielle encourrait l’anathème (une des excommunications majeures équivalente à une malédiction) : « celui qui dit qu’à la messe n’est pas offert à Dieu un sacrifice vrai et véritable (…) qu’il soit anathème » (DS 1740).
Un sacrifice consiste à offrir à Dieu une chose sensible et à la détruire en quelque manière pour reconnaître son souverain pouvoir sur nous et sur toute chose.
Substantiellement, c’est donc le même sacrifice à la messe et sur la Croix : c’est le même Jésus-Christ qui s’est offert sur la Croix et qui s’offre par les mains des prêtres, ses ministres, sur nos autels, avec les mêmes intentions. Cette victime ne saurait être du pain et du vin qui ont cessé d’exister après la consécration. Mais dans la manière dont il est offert, ils diffèrent de deux façons. Jésus-Christ s’est offert en répandant son Sang et en méritant pour nous ; tandis que sur les autels, il se sacrifice sans effusion de sang et nous applique les fruits de sa Passion et de sa Mort. Il s’est aussi offert lui-même sur la Croix tandis qu’il se sert à la messe d’un prêtre humain qui agit comme son instrument.
- Un sacrifice bien réel mais non sanglant désormais : gestes sacramentaux
Il s’agit bien d’une mise à mort rituelle, une oblation et immolation où le Christ est tué. La mort est la séparation de l’âme et du corps. Le Christ est mort sur la Croix. Ce sacrifice fut sanglant une fois et est rendu présent de manière non sanglante désormais. Représenté signifie étymologiquement, re-présenté (pas l’affaiblissement sémantique du mot à la manière d’une représentation théâtrale qui se contente de mimer). Pour beaucoup d’animaux sacrifiés, la mise à mort n’est certes pas la crucifixion mais l’égorgement comme dans l’ancienne Alliance le sacrifice d’Isaac par Abraham remplacé par le jeune bélier puis l’agneau pascal durant l’exode d’Égypte avec Moïse. Cette exsanguination est donc la séparation d’un côté du sang et de l’autre du corps conduisant à la mort. « Ne cesse pas, homme de Dieu, de prier et d’intercéder pour moi quand tu fais descendre le Verbe par ta parole, quand tu sépares de manière non sanglante la chair et le sang du Seigneur, lorsque tu te sers de la parole comme d’un glaive » (S. Grégoire de Nazianze, Lettre 171 ad Amphilochium, RJ, 1019)[1].
La double consécration (séparation sacramentelle) sur les oblats du pain devenu corps du Christ et du vin devenu sang du Christ montre avec réalisme cette mort. La transsubstantiation a tout transformé et il ne demeure plus rien de l’ancienne substance de la matière apportée au sacrifice. Toutefois, parce qu’il ne serait pas très ragoûtant de communier à de la chair crue et à du sang chaud, le Seigneur a voulu cacher à notre sensibilité sous les accidents (couleur, goût, texture) du pain et du vin qui demeurent apparents la réalité nouvelle de la substance de son corps et son sang.
Certes, demeurons dans le juste milieu sur cette séparation. Ne tombons pas dans l’hérésie utraquiste. Ces Bohêmes disciples de Jacob de Mies (= Stříbro aujourd’hui) ou Jacobellus, professeur à l’université Charles de Prague, réclamaient en 1414 la communion sub utraque specie = sous l’une et l’autre espèce, du pain et du vin. Ils voulaient communier au calice, d’où leur surnom de calixtins. Ils constituaient l’aile modérée des hussites (disciples de Jan Hus brûlé au concile de Constance en 1415) contre les taborites, horebites ou orphelins tchèques qu’ils défirent à Lipany en 1434 (survivance dans les Frères Moraves chez les protestants). Toute ressemblance avec des abus modernes ne serait pas fortuite vu l’influence protestante sur la manière moderne de concevoir la messe ! Or, il est de foi catholique de croire que les laïcs ne sont lésés en rien en ne recevant qu’une des deux espèces. Le concile de Trente, en sa 21e session, rappela le 16 juillet 1562 : « aucun commandement divin n’oblige les laïcs et les clercs qui ne célèbrent pas à recevoir le sacrement de l’eucharistie sous les deux espèces ; et que l’on ne peut en aucune façon douter, sans léser la foi, que la communion sous l’une des deux espèces leur suffise pour leur salut » (DS 1726). En effet, malgré la séparation par la double consécration, par concomitance naturelle et à cause de l’union hypostatique (le Verbe divin dans l’unité de sa personne divine qui s’est unie une nature humaine par l’Incarnation), Jésus-Christ vivant et véritable est présent sous chacune des espèces. Le Ressuscité vit dans un état de gloire et donc son corps, son sang, son âme et sa divinité sont présents dans la moindre parcelle des espèces eucharistiques. D’où le respect qui leur est dû.
La messe est en lien avec la liturgie céleste. Les orthodoxes considèrent que les anges la célèbrent en parallèle au Ciel et d’ailleurs, le Canon romain énonce peu après la consécration, alors que le prêtre se penche vers le corporal, image du linceul de Jésus : « Nous vous en supplions, Dieu tout-puissant, faites porter ces offrandes par les mains de votre saint ange, là-haut, sur votre autel, en présence de votre divine Majesté ». La messe abolit donc les frontières temporelles, elle produit comme un couloir temporel (cela sonne un peu trop comme dans le film les Visiteurs mais comment mieux l’exprimer ?) entre le Calvaire et la messe à laquelle nous assistons. La messe est ainsi un raccourci chronologique entre le triduum du mois d’avril de l’an 30 et nous d’une part et à l’intérieur du triduum d’autre part, en condensant l’histoire sainte répartie sur plusieurs jours en quelques minutes puisqu’on passe de la Passion à la Résurrection du Christ, du vendredi saint à la nuit pascale.
En effet, si nous avons vu la figuration de la mort du Christ par la double consécration, la Résurrection est manifestée au moment du Libera nos (juste après le Pater), le prêtre rompt l’hostie et en réserve une petite fraction. Par ce fragmentum qu’il fait tomber dans le calice est figuré le sang qui revient dans le corps, sa Résurrection. D’ailleurs la prière récitée est claire : « Que ce mélange et cette consécration du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous allons recevoir, nous soient un gage de la vie éternelle. Ainsi soit-il » (Hæc commíxtio et consecrátio Córporis et Sánguinis Dómini nostri Iesu Christi, fiat accipiéntibus nobis in vitam ætérnam. Amen).
- Les quatre fins de la messe
On offre à Dieu le sacrifice de la messe pour 4 fins :
- Latreutique : pour lui rendre l’honneur qui lui est dû, un culte d’adoration (latrie en grec). Cela ressort de la vertu de religion dépendante de la justice, qui rend à chacun selon son dû et l’honneur à celui qui est au-dessus de nous, créateur, roi et père. C’est un acte aussi de piété et de crainte filiales.
- Eucharistique : pour le remercier de ses bienfaits, en action de grâces.
- Propitiatoire : pour l’apaiser, lui donner satisfaction (satisfactoire), réparation pour nos péchés, soulager les âmes du Purgatoire. Sous-entendu, nous mériterions de la colère divine l’enfer si Dieu le Père ne s’était pas complu à nous envoyer son Fils pour nous racheter, lui le Deus ultor (le Dieu vengeur) (Jér. 51, 56) qui s’écriait : « Mihi vindicta » (à moi la vengeance) (Rm 12, 19). Il faut que Dieu nous devienne propice. Cette mort de son Fils lui suffit car lui seul pouvait en faire assez pour le rachat : satis facere.
- Impétratoire : imploration pour obtenir les grâces nécessaires à notre vie spirituelle.
- La symbolique propitiatoire
C’est surtout sur la fin propitiatoire ou sacrificielle que se concentrent les lacunes de la nouvelle messe.
Pourtant, le sacrifice de la messe est bien sûr figuré dans l’Ancien Testament. La prophétie de Malachie : « Du levant au couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu un sacrifice (d’agréable odeur) est présenté à mon nom ainsi qu’une offrande pure » (Ml 1, 11, Vulg. : « Ab ortu enim solis usque ad occasum, magnum est nomen meum in gentibus, et in omni loco sacrificatur : et offertur nomini meo oblatio munda »). Or, comme les Juifs n’avaient pas le droit d’offrir de sacrifice en-dehors du temple de Jérusalem, cela est une annonce de la sainte messe. Tout comme le sacrifice de Melchisedek du pain et du vin, mentionné explicitement dans le canon : « Sur ces offrandes, daignez jeter un regard favorable et bienveillant ; acceptez-les comme vous avez bien voulu accepter les présents de votre serviteur Abel le Juste (cf. Mt 23, 35), le sacrifice d’Abraham, le père de notre race (Ga 3, 7), et celui de Melchisédech (Gn 14, 18), votre souverain prêtre, offrande sainte, sacrifice sans tache ».
Le sacrifice est encore clairement évoqué symboliquement par deux gestes traditionnels. À l’offertoire (qui a été supprimé en réalité car tellement affaibli et énervé en « présentation des offrandes ») le prêtre offre l’hostie posée sur la patène en faisant dépasser l’extrémité de quatre doigts (index et pouce). Ainsi sont figurées les cornes des autels. Il en existait deux : l’autel des sacrifices ou des holocaustes dans le parvis et l’autel des parfums (pour l’encens) devant le voile du temple. Sur le premier avaient lieu des sacrifices réguliers d’animaux (Ex 27, 1-2 : « Puis tu feras l’autel en bois d’acacia. L’autel aura cinq coudées de long, cinq coudées de large, – sa base sera donc carrée – et trois coudées de haut (env. 2,5 de côté et 1,5 de hauteur). Tu feras des cornes aux quatre angles de l’autel, et ses cornes feront corps avec lui. Tu le plaqueras de bronze ») sur lesquelles le sang de la victime était répandu (Ex 29, 10-12 : « Tu feras approcher le taureau devant la tente de la Rencontre ; Aaron et ses fils imposeront la main sur sa tête, et tu l’immoleras devant le Seigneur, à l’entrée de la tente de la Rencontre. Tu prendras le sang du taureau et tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l’autel. Puis tu répandras le sang à la base de l’autel »).
C’était ce qu’on appelait faire propitiation pour les fautes : les réparer en se rendant favorable Dieu. C’est la raison pour laquelle quand « Adonias eut peur de Salomon. Il se leva et s’en fut empoigner les cornes de l’autel » (1 R 1, 50) car il avait voulu usurper à son frère la succession de David et il en demandait ainsi pardon. Sur les cornes de l’autel étaient gravés en pointe de diamant par YHWH les péchés d’Israël (Jér 17, 1).
Sur le second autel des parfums, construit sur le même modèle mais plus petit (Ex 30, 1-2 et v. 10), ce rite n’avait lieu qu’une fois par an, pour l’expiation, le jour du grand pardon (Yom Kippour). Enfin, au Hanc igitur (première clochette après le Sanctus), l’imposition des mains sur l’hostie évoque la victime des sacrifices déjà évoqués et aussi une autre cérémonie, plus rare. Un sacrifice annuel s’imposait derrière le rideau (s’il avait la témérité d’y pénétrer autrement, il mourrait) avec un taureau pour le sacrifice et un bélier pour l’holocauste pour l’expiation ; puis deux boucs : un pour Dieu, un pour Azazel. « Il immolera alors le bouc destiné au sacrifice pour la faute du peuple, et il en portera le sang au-delà du rideau. Il fera avec ce sang comme il a fait avec celui du taureau : il en aspergera le dessus et le devant du propitiatoire » (Lv 16, 15) et là, le propitiatoire désigne le couvercle de l’arche d’alliance, le lieu de la présence de Dieu sur terre. Puis les cornes de l’autel devant le rideau étaient enduites (v. 18). Venait ensuite le bouc émissaire : « Une fois achevé le rite d’expiation du sanctuaire, de la tente de la Rencontre et de l’autel, Aaron fera approcher le bouc vivant. Il posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il prononcera sur celui-ci tous les péchés des fils d’Israël, toutes leurs transgressions et toutes leurs fautes ; il en chargera la tête du bouc, et il le remettra à un homme préposé qui l’emmènera au désert. Ainsi le bouc emportera sur lui tous leurs péchés dans un lieu solitaire ».
On comprend ainsi que Jésus, présence de Dieu sur terre qui n’est plus nuée sur le propitiatoire mais qui s’est incarné, assume le poids des péchés d’Israël et fait office tant d’agneau pascal que de bouc émissaire. Mais il fallait bien un sacrifice sanglant. « s’il n’y a pas de sang versé, il n’y a pas de pardon » (He 9, 22).
- L’affaiblissement de la dimension sacrificielle dans la foi eucharistique
- L’hérésie luthérienne
L’hérésiarque Martin Luther publia ses 95 thèses le 31 octobre 1517 à Wittenberg et fut excommunié à Rome le 31 janvier 1521 après avoir refusé de se rétracter. Le luthéranisme a remis en cause la dimension sacrificielle de la messe qui a donc aboutit à l’humanitarisme contemporain. Quand l’homme cesse d’offrir des sacrifices à Dieu, il tend vite à se prendre pour Dieu.
Luther ne niait pas une certaine présence de Jésus dans l’Eucharistie (mais il parlait de consubstantiation et pas de transsubstantiation car selon lui, hérétiquement, il resterait quelque chose des substances du pain et du vin). Il niait par contre énergiquement le sacrifice. Il voulait tuer la messe : « quand la messe sera renversée, je pense que nous aurons renversé la papauté car c’est sur la messe, comme sur un rocher, que s’appuie la papauté tout entière, avec ses monastères, ses évêchés, ses collèges, ses autels, ses ministres et sa doctrine (…) ; tout cela s’écroulera quand s’écroulera leur messe sacrilège et abominable » (Luther, Contra Henricum regem Angliæ, 1522, t. X, p. 220). Son acception du terme sacrifice n’est que très large comme « une chose sacrée » mais il la rejetait au sens propre : « L’élément principal de leur culte, la messe, dépasse toute impiété et toute abomination, ils en font un sacrifice et une bonne œuvre » (Luther, De votis monasticis judicium, 1521, t. VIII, p. 651).
Pour lui, la messe serait un mémorial : elle instruirait les fidèles sur le sacrifice du Calvaire, pour préparer l’acte intérieur de la foi. C’est un sacrifice de louange et action de grâces, donc sans valeur rédemptrice. Il refusait la dimension propitiatoire qui applique à nos âmes les fruits du sacrifice de la croix, acquittant notre dette due envers Dieu pour nos péchés.
« La messe n’est pas un sacrifice ou l’action d’un sacrificateur. Regardons-là comme sacrement ou comme testament. Appelons-la bénédiction, eucharistie, ou mémoire du Seigneur » (Luther, sermon du 1er dimanche de l’Avent, t. XI, p. 774). « Le saint Sacrement n’a pas été institué pour que l’on en fasse un sacrifice expiatoire (…) mais pour qu’il serve à réveiller en nous la foi, et à réconforter les consciences (…) ; la messe n’est pas un sacrifice offert pour d’autres, qu’ils soient vivants ou morts, afin d’effacer leurs péchés, mais (…) une communion dans laquelle prêtre et fidèles reçoivent le sacrement, chacun pour soi-même » (Confesion d’Augsbourg de Philipp Melanchton, 1530, art. 24). « C’est une erreur manifeste et impie d’offrir ou d’appliquer la messe pour les péchés, en qualité de satisfaction ou en faveur des défunts » (Luther, de Captivitate babylonica, 1520, t. VI, p. 521).
Luther était toutefois sournois et voulut mettre la « liturgie de la parole » devant la communion, mais en y allant très progressivement : « Pour arriver sûrement et heureusement au but, il faut conserver certaines cérémonies de l’ancienne messe pour les faibles qui pourraient être scandalisés par le changement trop brusque » (Luther, t. XII, p. 212). À Noël 1521 : il fit ainsi : confiteor, introït, kyrie, gloria, épître, évangile, prédication, pas d’offertoire, sanctus, récit à haute voix et en langue vernaculaire de l’institution de la Cène, communion sous les deux espèces (dans la main et au calice) sans confession préalable, Agnus Dei, Benedicamus Domino. Les Anglicans procédèrent ainsi : le premier Prayer Book de 1549 supprima l’offertoire, modifia le canon et adopta la version luthérienne du récit de l’Institution. La seconde édition de 1552 se rapprochait encore plus de la Cène calviniste (presbytérienne).
- La volonté œcuménique et d’ouverture au monde gangrène l’Église
La protestantisation de la messe était voulue par Paul VI qui convia 6 pasteurs protestants à la rédaction de la nouvelle messe. Parmi eux, Max Thurian, cofondateur de Taizé (mais rejeté par ses anciens coreligionnaire car converti en 1972 puis ordonné prêtre en 1997, le tout secrètement) affirma : « Dans cette messe rénovée, il n’y a rien qui puisse vraiment gêner les protestants évangéliques » (La Croix, 30 mai 1969).
Jean Guitton, confident de Paul VI, affirma : « Le messe de Paul VI, d’abord, se présente comme un banquet, et insiste beaucoup sur le côté participation à un banquet, et beaucoup moins sur la notion de sacrifice, de sacrifice rituel face à Dieu – le prêtre ne montrant que son dos. Alors je crois ne pas me tromper en disant que l’intention de Paul VI et de la nouvelle liturgie qui porte son nom, c’est de demander aux fidèles une plus grande participation à la messe, c’est de faire une plus grande place à l’Écriture, une moins grande place à tout ce qu’il y a…, certains diront de magique, d’autres de consécration transubstantielle, et qui est la foi catholique. Autrement dit, il y a chez Paul VI une intention œcuménique d’effacer, ou du moins de corriger, ou du moins d’assouplir, ce qu’il y de trop catholique au sens traditionnel dans la messe, et de rapprocher la messe, je le répète, de la cène calviniste » (sur Radio Courtoisie, le 19 décembre 1993).
Pour faire plaisir aux Luthériens, l’Église a modifié sa doctrine avec la déclaration catholico-luthérienne (à laquelle participèrent les cardinaux Lehmann, Kasper, Volk, Ratzinger) : « Le signe sensible de l’offrande de Jésus-Christ dans la célébration de l’eucharistie et celui de notre incorporation à ce sacrifice est (…) le repas (…). Cela signifie que, dans la réalisation de ce repas, le sacrifice que fait Jésus-Christ de lui-même est rendu présent et réalisé. C’est pourquoi la distinction traditionnelle, qui n’est devenue habituelle qu’après le concile de Trente, selon laquelle on distingue dans l’eucharistie d’un côté le sacrement et de l’autre le sacrifice, ne peut être retenue par la théologie, car elle en fausse la structure fondamentale. C’est dans le fait de s’offrir en nourriture que le sacrifice de Jésus-Christ trouve son expression au niveau liturgique »[2].
Pourtant la Bible est claire en condamnant la dimension de repas communautaire : « Donc, lorsque vous vous réunissez tous ensemble, ce n’est plus le repas du Seigneur que vous prenez ; en effet, chacun se précipite pour prendre son propre repas, et l’un reste affamé, tandis que l’autre a trop bu. N’avez-vous donc pas de maisons pour manger et pour boire ? Méprisez-vous l’Église de Dieu au point d’humilier ceux qui n’ont rien ? Que puis-je vous dire ? vous féliciter ? Non, pour cela je ne vous félicite pas ! » (1 Co 11, 20-22). Quel serait ce repas où l’on repartirait avec une si faible quantité de nourriture ?
Pie XII avait aussi condamné la dimension de repas que certains voulaient substituer au sacrifice (et ce n’est pas même les deux à la fois !) : « Ils s’écartent donc du chemin de la vérité ceux qui ne veulent accomplir le saint sacrifice que si le peuple chrétien s’approche de la sainte table ; et ils s’en écartent encore davantage eux qui, prétendant qu’il est absolument nécessaire que les fidèles communient avec le prêtre, affirment, dangereusement qu’il ne s’agit pas seulement d’un sacrifice, mais d’un sacrifice et d’un repas de communauté fraternelle, et font de la communion accomplie en commun comme le point culminant de toute la cérémonie.
Il faut encore remarquer que le sacrifice eucharistique consiste essentiellement dans l’immolation non sanglante de la victime divine, immolation qui est mystiquement indiquée par la séparation des saintes espèces et par leur oblation faire au Père éternel. La sainte communion en assure l’intégrité, et a pour but d’y faire participer sacramentellement, mais tandis qu’elle est absolument nécessaire de la part du ministre sacrificateur (sous peine d’invalidé), elle est seulement à recommander vivement aux fidèles » (Mediator Dei, 20 novembre 1947).
Trente anathématisa ceux qui refusaient la messe où seul le prêtre communiait (DS 1758). Personnellement, j’ai dit seul sans doute les ¾ des 4897 messes (après celle du dimanche 27 septembre 2020) célébrées depuis mon ordination. C’est peut-être dommage mais c’est ainsi ! Et Dieu n’en est pas moins honoré même s’il est normal de chercher à avoir des fidèles évidemment.
Dire que c’est un repas qui comprendrait aussi un sacrifice parce que le Christ se donne à nous en nourriture est biaisé. Le sacrifice est fait à Dieu le Père par le Fils et non pas aux hommes mais pour eux !
Enfin Mgr Annibale Bunigni, l’architecte de la nouvelle messe, affirma : « L’Église a été guidée par l’amour des âmes et le désir de tout faire pour faciliter à nos frères séparés le chemin de l’union, en écartant toute pierre qui pourrait constituer ne serait-ce que l’ombre d’un risque d’achoppement ou de déplaisir » (DC 1445 (1965), col. 604. Depuis quand l’Église demande-t-elle aux hérétiques de nous conduire dans leur erreur ?
Si on lâche ce point de la messe, comme disait Luther, tout s’écroule : le sacerdoce devient incompréhensible et on l’ouvre aux femmes, aux homosexuels actifs, aux hommes mariés. Étrangement, Vatican II contribua même à enlever les rares bons côtés de certains offices protestants : en Angleterre les autels anglicans furent retournés versus populum pour imiter les catholiques modernistes ! Ils demeurent toutefois généralement encore en ancienne RDA luthérienne.
Depuis, on sait qu’Annibale Bunigni était franc-maçon, raison pour laquelle Paul VI le nomma pro-nonce à Téhéran (janvier 1976) pour le faire oublier malgré les services appuyés rendus à sa nouvelle liturgie[3]. Dans ce sens franc-maçon, il supprima tout ce qui pouvait choquer, à savoir les références à l’enfer et au diable (Dies iræ de la messe des défunts, collectes du XVIIe dimanche, de S. Nicolas, Camille de Lellis), au péché originel (collecte du Christ-Roi), à la pénitence (collectes de S. Raymond de Peñafort, Jean-Marie Vianney, jeudi après les Cendres), au mépris des choses de la terre (S. François d’Assise, postcommunion du 2nd dimanche de l’Avent, secrète du 3e dimanche après Pâques), à la satisfaction des péchés (Sacré-Cœur), aux ennemis de l’Église (communion de l’exaltation de la S. Croix ; S. Pie V, Jean de Capistran), aux dangers hérétiques (Vendredi Saint, S. Pierre Canisius, Robert Bellarmin, Augustin de Cantorbéry).
Et surtout, il publia le nouveau missel précédé d’une institution générale hérétique qui dut d’ailleurs être corrigée et qui peut être résumée ainsi :
- La nouvelle définition de la messe comme « assemblée », plutôt que sacrifice offert à Dieu.
- La suppression des références à la doctrine catholique récusée par les protestants de la messe offrant satisfaction à Dieu pour les péchés.
- La réduction du rôle du prêtre à des fonctions proches d’un pasteur protestant.
- La négation implicite de la Présence réelle par la Transsubstantiation.
- La transformation de la consécration, action sacramentelle, en une simple narration de l’histoire de la dernière Cène.
- L’atteinte portée à l’unité de Foi ecclésiale par la multiplication des options proposées.
- L’emploi d’un langage ambigu et équivoque, ouvrant la voie à de multiples déviations.
- La messe « moderne » après la réforme liturgique suivant Vatican II
Toutes ces modifications furent volontaires pour insuffler un esprit nouveau comme le reconnut son mauvais inspirateur, Mgr Annibale Bunigni : « l’image de la liturgie donnée par le Concile est totalement différente de ce qu’elle était auparavant », (DC 1491 (1967), col. 824). Son introduction générale du nouveau missel, en son n°7 en donnait l’esprit :
« La Cène dominicale est la synaxe (assemblée religieuse pour la prière, la lecture et l’eucharistie) sacrée ou le rassemblement du peuple de Dieu se réunissant sous la présidence du prêtre pour célébrer le mémorial du Seigneur. C’est pourquoi vaut éminemment pour l’assemblée locale de la sainte Église la promesse du Christ : ‘Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux’ ».
Cette définition est hérétique car elle ne distingue plus d’avec la Cène protestante essentiellement sur 3 points :
La messe est essentiellement un sacrifice (propitiatoire), non une assemblée de fidèles réunis pour célébrer un mémorial. La messe est ainsi réduite à un repas (l’autel devenant une table), d’où la désorientation (au sens étymologique) et la réduction du sacerdoce. Les rares cas de célébration « vers le peuple » sont un contresens sur la désorientation de certaines basiliques antiques qui était justement compensée par la réorientation de l’autel, comme à S. Pierre du Vatican, à cause de la colline et de la tombe de S. Pierre, ce qui mettait en face des fidèles.
Le prêtre est essentiellement un instrument libre et volontaire par lequel le Christ renouvelle son sacrifice et non un simple président d’assemblée. Or, Dans Mediator Dei, Pie XII avait réaffirmé : « l’immolation non sanglante par le moyen de laquelle, après les paroles de la consécration, le Christ est rendu présent sur l’autel en état de victime, est accomplie par le seul prêtre en tant qu’il représente la personne du Christ, non en tant qu’il représente la personne des fidèles ».
NSJC est présent dans l’hostie avec sa chair et son sang et non seulement de façon spirituelle (comme lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom). Le mot transsubstantiation est volontairement omis, alors que Pie VI condamna le synode janséniste de Pistoia en 1794 pour ne pas l’avoir utilisée (DS 2629) car cela favorisait l’hérésie, même si ce texte était pourtant moins mauvais que l’introduction du nouveau missel.
Reprenons en détails maintenant. La nouvelle liturgie a de facto supprimé l’offertoire, cible visée par Luther : « Cette abomination (…) qu’on appelle offertoire. C’est de là qu’à peu près tout résonne et ressent le sacrifice » (Luther, in Formula missæ et communionis, 1523, t. XII, p. 211). En voici la formule traditionnelle : « Recevez, Père saint. Dieu éternel et tout-puissant, cette hostie sans tache (immaculatam hostiam) que moi, votre indigne serviteur, je vous présente à vous mon Dieu vivant et vrai pour mes péchés, offenses et négligences sans nombre, pour tous ceux qui m’entourent ainsi que pour tous les fidèles vivants et morts : qu’elle soit propice (proficiat) à mon salut et au leur pour la vie éternelle. Ainsi soit-il ». Aujourd’hui l’offertoire est remplacé par une simple « préparation des offrandes » : « Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie ».
On assiste à un simple bénédicité mais pas à un offertoire. Aucune dimension surnaturelle n’apparaît : rien de révélé, tout est horizontal, sans le sacrifice et la propitiation.
De plus, le canon romain fut encadré par une multitude de variantes : au lieu d’être une règle obligatoire (kanon), il n’est qu’une possibilité parmi d’autres assez systématiquement écartée au demeurant car prétendument trop long. Même le canon n’équivaut pas exactement à la « prière eucharistique n°1 » :
- La récitation à haute voix entraîne une désacralisation.
- La formule consécratoire se rapproche de la version luthérienne.
- Elle est banalisée car prononcée sur un ton narratif et on pas intimatif
- Le prêtre ne génuflecte plus entre la consécration et l’élévation, ce qui laisserait entendre que ce serait la foi des fidèles qui causerait la présence réelle.
- La suppression de nombreux signes de croix.
- L’ajout d’acclamations ambiguës par les fidèles après la consécration.
Prises individuellement, toutes ces modifications ne seraient pas nécessairement mauvaises mais mises ensemble et comparées à la messe traditionnelle, elles vont toutes dans le sens d’un affaiblissement de la foi.
Les autres « prières eucharistiques » pèchent par leur brièveté (surtout la n°2), rejettent beaucoup après la consécration, qui arrive ainsi très vite sans que ni prêtre n’aie tellement eu le temps de se préparer au sacrifice qu’il va réaliser (déjà qu’à la messe traditionnelle les fidèles voient vite arriver la cloche pour s’agenouiller puisque le plan du prêtre n’attend pas le leur durant leur récitation du Sanctus). L’écart entre Dieu puissant et miséricordieux (titres oubliés) et l’homme pécheur est si diminué qu’il réduit ainsi comme peau de chagrin la dimension propitiatoire.
Précisons à propos de cette dimension de péché à racheter que dans la messe traditionnelle, censée être plus cléricale, le prêtre insiste énormément sur son indignité. Il confesse séparément et en premier ses péchés, dont il reçoit l’absolution de la bouche des servants voire des fidèles ! En montant à l’autel, il récite avant d’en vénérer les reliques par un baiser au corporal : « Nous vous en prions, Seigneur, par les mérites de vos saints (il baise l’autel au milieu) dont nous avons ici les reliques et de tous les saints, daignez pardonner tous mes péchés ». À l’offertoire pour l’hostie, le Suscipe insiste particulièrement sur ce point, mais comme secrète (à voix basse) : « moi, votre indigne serviteur, je vous présente à vous mon Dieu vivant et vrai pour mes péchés, offenses et négligences sans nombre » ; ensuite mais cette fois-ci à mi-voix, après la consécration et le memento des défunts, il dit « Nobis quoque peccatóribus » (et nous pécheurs) ; après le Pater, en embrassant la patène avec laquelle il se signa, il conclut par « qu’avec le soutien de votre miséricorde nous soyons à jamais délivrés du péché et préservés de toute sorte de troubles ». Puis, avant sa communion, résonne le triple « non sum dignus » accompagné des cloches à un, puis deux, puis trois coups.
Beaucoup d’autres affaiblissement sont à signaler : les figures du sacrifice (Abel, Abraham, Melchisedek) disparaissent, l’enfer n’apparaît plus, la Vierge Marie n’est plus dite toujours vierge, les mérites des saints et des anges passent à la trappe dans une indifférenciation (même S. Pierre n’est plus nommé).
Une précision encore sur la prière eucharistique n°2 pour laquelle on fait croire au mythe d’une résurgence ancienne d’un « canon de S. Hippolyte ». D’abord, en général (in genere) la vraie Tradition, vivante s’attache à ce qui a été transmis organiquement et non pas écartée au cours des siècles et qu’on voudrait réimposer par un coup de force. C’est de l’archéologisme, condamné par Mediator Dei : « Il n’est pas sage ni louable de tout ramener en toute manière à 1’Antiquité. De sorte que, par exemple, ce serait sortir de la voie droite de vouloir rendre à l’autel sa forme primitive de table, de vouloir supprimer radicalement des couleurs liturgiques le noir, d’exclure des temples les images saintes et les statues, de faire représenter le divin Rédempteur sur la Croix de telle façon que n’apparaissent point les souffrances aiguës qu’il a endurées… Une telle façon de penser et d’agir ferait revivre cette excessive et malsaine passion des choses anciennes qu’excitait le Concile illégitime de Pistoia, et réveillerait les multiples erreurs qui furent à l’origine de ce faux Concile et qui en résultèrent, pour le plus grand dommage des âmes, erreurs que l’Église, gardienne toujours vigilante du ‘dépôt de la foi’ à elle confié par son divin Fondateur, a réprouvées à bon droit ».
Ensuite en l’espère (in specie), d’abord, le personnage n’était pas sans complexité : il s’opposa violemment au pape Zéphyrin et Calixte Ier au point de passer pour un antipape même s’il mourut sans doute martyr avec Pontien en Sardaigne. Il était imbu de sa caste (refusant les mariages entre esclaves et patriciens) et de son éducation. Ensuite, son texte fut tronqué en 1969 supprimant le passage où le Christ se livra volontairement à la souffrance : « pour détruire la mort, briser les liens du démon, fouler aux pieds l’enfer, éclairer les justes ». Sa liturgie ne fut peut-être jamais employée ou alors comme modèle d’improvisation, contre le canon romain comme l’admet le moderniste vice-président du CNPL, le P. Aimon-Marie Roguet, OP (Pourquoi le canon de la messe en français ? Paris, Cerf, 1967, p. 23).
Le Bref examen critique affirme : « cette ‘Prière eucharistique II’ peut être employée en toute tranquillité de conscience par un prêtre qui ne croit plus ni la transsubstantiation ni au caractère sacrificiel de la Messe : cette prière eucharistique peut très bien servir pour la célébration d’un ministre protestant » (ch. VI).
Devant le tollé soulevé par le Bref examen critique induisant un soupçon d’hérésie sur la nouvelle messe, on modifia cet article 7 de l’Institutio Generalis mais le simple ajout par une seule occurrence des mots ‘transsubstantiation’ et ‘propitiatoire’ ne saurait régler le problème puisque rien n’a été modifié dans le missel qu’elle introduit !
M. l’Abbé Cyrille Debris
[1] Cela rappelle « Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles » (He 4, 12).
[2] Lehmann Schlink, Das Opfer Jesus Christi und seine Gegenwart in der Kirche, Herder, 1983, p. 223.
[3] Michael Davies, Liturgical Revolution, Pope Paul’s New Mass, Augustine Publishing Company, Devon, 1981, p. 505) et L’Osservatore Politico de Mino Pecorelli (12 septembre 1978), Panorama 538 (10 août 1976).