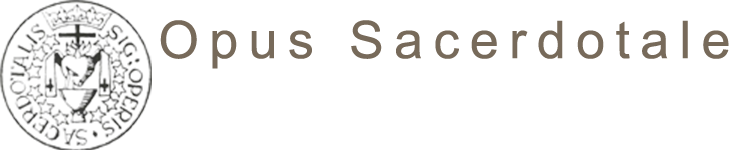G. Cuchet Comment notre monde a cessé d’être chrétien
La déchristianisation par l’Église

Guillaume Cuchet, professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-Est Créteil, a analysé la déchristianisation de la France dans Comment notre monde a cessé d’être chrétien. Anatomie d’un effondrement, Seuil, Paris, février 2018. Ce texte majeur doit nous inspirer pour, a contrario, espérer relancer une nouvelle évangélisation en apprenant des erreurs du passé.
I) Description : le grand effondrement de 1965
1) Méthode pour mesurer la déchristianisation
Le catholicisme d’une population se mesure extérieurement à sa pratique dominicale hebdomadaire qui manifeste et entretient un attachement à l’Église et à sa doctrine. À défaut de cette pratique, une culture chrétienne peut persister un certain temps, mais par la force des choses disparaîtra.
L’effondrement se mesure précisément en comparant les statistiques très professionnelles et systématiques du sociologue, le chanoine Fernand Boulard, sur un projet initial de Gabriel Le Bras. De 1947 à 1962, les « cartes Boulard » distinguaient les régions chrétiennes (grand Ouest, Pays Basque, Sud, Sud-Est du Massif Central, liséré Est des Alpes à l’Alsace, Nord) avec au moins de 45% de pascalisants ou de fidèles assistant au moins 1 fois sur deux à la messe de précepte et les « pays de mission », là où 20% des enfants n’étaient ni baptisés ou catéchisés (p. 49-50).
La « déchristianisation », terme inventé par Mgr Dupanloup, évêque libéral d’Orléans désignait une action politique volontaire visant à faire reculer l’influence sociale du catholicisme puis un état de la société résultant de cette action. Mais le principal problème est que cette ultime phase de déchristianisation a été provoquée par l’Église même avec son clergé.
Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire dans l’Histoire religieuse de la France contemporaine (Privat, 1988), prouvèrent une laïcisation progressive de la société par une longue courbe constamment descendante depuis la Révolution française. Malgré ses limites et les critiques, « la déchristianisation n’est pas un mythe ni le recul du christianisme, une opération blanche pour les sociétés occidentales, comme celles-ci voudraient peut-être se le faire croire » (p.31-32). Notons les permanences puisque se retrouvent les régions ayant accepté la constitution civile du clergé en 1791, qui servit de « referendum grandeur nature sur la politique religieuse de la Révolution ». 52 à 55% du clergé français prêta serment et la condamnation par Pie VI ne provoqua pas tellement de rétractations mais ramena la proportion à une égalité 50/50 (p. 79). Le clergé jureur fut plus touché par les vagues de déprêtrisation de l’an II et les mariages forcés. Les régions réfractaires reconstituèrent plus rapidement leur clergé après la folie révolutionnaire et l’Église gallicane puis ultramontaine du XIXe s. se voulut l’héritière de cette seule frange contre-révolutionnaire. « La politisation de la question religieuse a été, en France, pour toute une partie de la population, un facteur de longue durée de dévitalisation religieuse » (p. 80).
Certes, cette courbe n’est pas linéaire mais la tendance lourde est constante et entraîne dans les abysses actuels (p. 187). Parmi la série de flux et de reflux, notons les hautes eaux vers 1760 ; un reflux considérable de la Révolution jusque vers 1810 ou 1840 passant de 40.000 paroisses à 27.000 et à un taux de pratique de 66% à 75%, (p. 177) ; une remontée très notable jusqu’à l’installation de la Troisième République en 1875 si bien qu’au dernier recensement religieux d’État, 98% des Français se déclaraient catholiques romains (p. 50) ; un déclin à l’époque des lois anticléricales, qui cessa vers 1910 ; une nouvelle remontée, enfin, qui culmina en 1960 (p. 181-182), où on recueillait les fruits d’un réseau dense d’œuvres catholiques, d’un moindre anticléricalisme, d’une immigration italienne et polonaise pratiquante, d’un investissement considérable du clergé dans les patronages, écoles, œuvres de jeunesse. La transmission catholique était assurée : les jeunes devenant adultes pratiquaient dans la même proportion que leurs parents et même légèrement mieux.
2) La rupture de 1965
Ce qui fait que la chute fut d’autant plus marquée après le tournant de 1965. Si la pratique dominicale, juste avant le Concile, s’élevait à 37% en moyenne dans les années 1946-1964, elle passe à 25% des Français en 1966-1972 (soit une chute du tiers ou du quart (p. 96)) et aujourd’hui à 2%, soit les taux les plus faibles enregistrés dans les milieux ouvriers des années 1950 (p. 83). Elle est même très exactement à 1,8% (enquête Ipsos pour La Croix, 12 janvier 2017), soit une division des effectifs par presque 14 fois. Et là-dessus, combien encore se confessent-ils ? En mars 1975, entre bien d’autres études et sondages, une enquête révélait une chute de 47% de la pratique dans le diocèse de Paris depuis 1954. En 1974, à Lille, un tiers des pratiquants avait disparu depuis les dernières années.
Autrefois, le gros des contingents était constitué des enfants puisque 80% d’entre eux faisaient leur communion solennelle. Non seulement ils pratiquaient mais étaient catéchisés jusqu’à l’âge de 12 ans au moins (p. 99). Or, ce sont les 15-24 ans qui massivement désertèrent : « Il constatait un décrochement des taux de l’ordre de 40 à 50% par rapport à 1954 et de 35 à 40% par rapport à 1962, en six ou sept ans ! » (p. 94-95). En Vendée, dans le canton de Saint-Fulgent, les taux passent de 92,9% de pratique en 1956 à 55,5% en 1979, même si les pascalisants restent encore 84,5%. Mais chez les jeunes de 20 à 34 ans, la pratique est tombée encore plus drastiquement, de 93% à 24,1%, soit une division par quatre du taux de départ (p. 112). Ce décrochage affectait tout particulièrement les jeunes de familles pratiquantes du baby-boom. Autrement dit, la génération de catholiques qui arrivait à 20 ans en1965, pour la première fois dans l’histoire, n’a pas bénéficié de la transmission de l’héritage catholique.
Et bien entendu, ce fait colossal allait désormais se démultiplier.
Aujourd’hui, les hommes pratiquent aussi peu que les femmes. Toutes les provinces, les villes comme les campagnes sont désormais à égalité, à ceci près que la société française s’est considérablement urbanisée et que les assemblées dominicales des villes sont numériquement plus importantes que celles des chefs-lieux de cantons où est encore célébrée la messe le dimanche.
Dans l’Église, il est de bon ton de prétendre qu’il valait mieux « privilégier le qualitatif (présumé) sur le quantitatif et (à) considérer que la pratique (théoriquement toujours obligatoire) n’avait plus la même importance qu’autrefois » (p. 89) « Le déclin du catholicisme volontiers qualifié de ‘sociologique’ n’était pas considéré comme une grande perte, mais plutôt comme une opération vérité, voire une mesure d’assainissement nécessaire que d’aucuns ont pu comparer à l’époque de la ‘déjudaïsation de l’Église au Ier siècle’ » (p. 90-91).
« Le fait que cette rupture ait eu lieu (…) en 1965 (…) est fondamental. Il signifiait que la rupture avait eu lieu avant Mai 1968 (…). Avant Humanæ vitæ aussi, puisque la fameuse encyclique de Paul VI qui rappelait l’interdiction de la contraception date de juillet 1968. Elle coïncidait en revanche avec le concile Vatican II et les débuts de l’application de la réforme liturgique (le texte, adopté en décembre 1963, ayant commencé à produire ses effets dès 1964, bien avant la fin du concile, en décembre 1965) » (p. 98). Au pire, ces deux autres éléments ont accentué le phénomène (p 142) mais ne l’ont certainement pas provoqué.
Autre indicateur sûr, les vocations sacerdotales et les départs du séminaire : « les ‘cours’ (promotions) 1967 et 1968 ont connu un taux de perte vertigineux de 80%, alors qu’il tournait autour de 20% dans les années 1950, à une époque où régnait pourtant déjà un certain malaise » (p. 105). « De 1945 à 1964, le nombre annuel de prêtres quittant le sacerdoce (séculiers et réguliers confondus) oscillait entre vingt-sept et soixante et un (…). Le chiffre des départs s’envole cependant à partir de 1965, et il culmine en 1972 avec, cette année-là, deux cent vingt-cinq cas (contre soixante et onze en 1965) » (p. 235).
Le sommet du nombre de prêtres dans l’histoire contemporaine fut atteint en 1871-1875 avec 56.500 prêtres, soit 1 pour 639 habitants, l’un des taux de couverture sacerdotale les plus élevés au monde (augmentation de 40% depuis 1830 contre 17% pour la population générale. Les ¾ des missionnaires dans le monde au début du XXe siècle étaient français). En 1950, il était toujours de 51.000 prêtres, soit 1 pour 1.000 habitants. Aujourd’hui, il reste environ 14.000 prêtres en France, soit environ 1 pour 4.800 habitants (qui ne sont certes plus tous catholiques !). Plus de la moitié seront morts d’ici 10 ans.
Le maximum des ordinations fut quant à lui atteint en 1830, sous la Restauration, avec 2.357 ordinations (p. 190-192). En 2018, selon l’Abbé Barthe, il y eut entre 67 et 82 ordinations (selon les sources) au titre des diocèses et communautés assimilées. Dans le même temps 800 prêtres décèdent par an. 58 diocèses (sur 104) n’avaient eu aucune ordination cette année-là. Il ne reste plus que 17 séminaires actifs en France mais plusieurs vont fermer. Toutefois, raison d’espérer, les ordinations traditionnelles représentent 20 % de ces ordinations.
II) Les causes : Vatican II
1) Vatican II, « événement déclencheur » (p. 130)
« Une autre raison probable de cette difficulté à penser la rupture en temps réel est ce qu’il faut bien appeler la sanctuarisation idéologique du concile Vatican II (…). On a voulu éviter d’apporter de l’eau au moulin intégriste ou traditionaliste en admettant qu’il ait pu avoir raison au moins sur la chronologie (…). La génération du concile qui a vécu l’événement comme un progrès majeur dans sa conception du christianisme, a eu le plus grand mal à admettre qu’il puisse avoir joué un rôle dans la crise et, pour être plus précis, dans le décrochage de la pratique » (p. 90). Boulard a dû s’y rendre nolens volens bien qu’il eût « manifestement fait beaucoup d’efforts pour ne pas y penser et chercher des explications alternatives » (p. 91). Bien peu ont l’honnêteté intellectuelle du jésuite belge Roger Mols (p. 91-92). Pourtant, « sa conviction ancienne que les phénomènes religieux avaient des causes avant tout religieuses, et plus précisément pastorales, pouvait s’avérer un peu délicate à mettre en œuvre dans ce contexte puisqu’elle aurait pu le conduire à rechercher des responsables, et pourquoi pas des coupables, à la situation qu’il découvrait » (p. 129).
Or, le concile est marqué du sceau moderniste : « En termes sociologiques, on peut le définir comme une entreprise de modernisation de l’Église conforme aux aspirations des milieux avancés du catholicisme occidental, et même plus précisément ouest-européen » (p. 131).
« La thèse traditionaliste ou intégriste qui consiste à dire que l’Église des années 1960-1970 aurait sacrifié une partie (la plus désagréable) de son message sur l’autel de sa réconciliation avec le monde moderne, soit parce qu’elle avait cessé elle-même d’y croire, soit parce qu’elle a cru qu’en abaissant ses exigences et en se rendant plus aimable elle séduirait plus de monde (…). Laquelle de ces deux thèses est la bonne du point de vue historique ? La part de vérité de la thèse conservatrice me paraît être que le catholicisme français a effectivement connu, à la faveur du concile et de la crise qui a suivi, un accès de rousseauisme collectif, dont les origines étaient anciennes mais qu’il s’était efforcé jusqu’alors de contenir en en adoptant progressivement les contenus à doses plus homéopathiques. Dans le déménagement général dont le concile a donné le signal, il s’est débarrassé sans phrase de pans entiers de l’ancienne doctrine auxquels il ne croyait plus guère ou qui lui sont soudain apparus comme des vieilleries théologiques et dévotionnelles inutiles et coûteuses. Toute une partie de l’ancien catéchisme a ainsi été remisée aux hangars des vieilles lunes, dans une sorte d’opération de démythologisation qui ne disait pas son nom et dont le jugement, l’enfer, le péché mortel, Satan, ont plus ou moins fait les frais. Comme il fallait bien s’expliquer malgré tout leur longue présence dans l’ancien catholicisme, on les a volontiers mis alors sur le compte du cléricalisme d’antan, d’une pastorale mal inspirée, voire de mystérieuses infiltrations ‘jansénistes’ (…). La part de vérité de la thèse conciliaire, en revanche, est que la crise en question était probablement inévitable et qu’elle se serait produite de toute façon un jour ou l’autre, bien qu’elle eût probablement pu se faire à moindre coût » (p. 263-265).
« Vatican II semble avoir été en définitive cette réforme (probablement nécessaire) qui a déclenché la révolution qu’elle prétendait éviter, comme jadis les états généraux dans la France de la fin du XVIIIe siècle » (p. 271).
« J’aurais tendance à dire personnellement que le concile n’a pas provoqué la rupture (en ce sens qu’elle n’aurait pas eu lieu sans lui), mais qu’il l’a déclenchée tout en lui donnant une intensité particulière » (p. 272).
2) Vers une Église anormative
Pour G. Cuchet l’« hypothèse est que cette fin de l’insistance pastorale sur le caractère obligatoire de la pratique survenue à la faveur du concile a joué, sur le plan collectif, un rôle fondamental dans la rupture, comparable à la fin de l’obligation civile sous la Révolution, surtout pour les groupes qui restaient particulièrement soumis à cette obligation comme les enfants et les jeunes » (p. 142).
Guillaume Cuchet considère le Concile comme « événement déclencheur » de l’effondrement : « On ne voit pas en effet quel autre événement contemporain aurait pu engendrer une telle réaction. La chronologie montre que c’est n’est pas seulement la manière dont le concile a été appliqué après sa clôture qui a provoqué la rupture. Par sa seule existence, dans la mesure où il rendait soudainement envisageable la réforme des anciennes normes, le concile a suffi à les ébranler, d’autant que la réforme liturgique, qui concernait la partie la plus visible de la religion pour le plus grand nombre, a commencé à s’appliquer dès 1964 » (p. 130). Il évoque Dignitatis Humanæ comme exemple opposé au Syllabus.
Autrefois, « tout l’enjeu pastoral pour le clergé était donc d’insuffler à la génération montante suffisamment de religion dans l’enfance pour qu’il lui en reste assez au jour de la mort pour ‘se reconnaître’ in extremis et basculer du bon côté de l’au-delà. Tout au plus, dans l’intervalle, pouvait-on compter, pour maintenir un état de tension spirituelle minimal, sur quelques piqûres de rappel et menues recharges sacrales survenues à la faveur du mariage, du baptême des enfants, des enterrements, de quelques grandes fêtes, éventuellement d’une mission ou d’un pèlerinage » (p. 99).
Mais tout changeait, notamment « le changement de signification de la pratique religieuse induit par les nouvelles orientations pastorales nées du concile, ou adoptées à sa suite. L’ancienne pastorale insistait beaucoup sur l’obligation de recevoir les sacrements et en particulier d’assister à la messe. La nouvelle, dans la lignée du mouvement liturgique lancée par Pie X au début du siècle, se préoccupait davantage de favoriser la ‘participation active’ des fidèles. L’important était moins désormais d’assister, voire de ‘pointer’ à la messe tous les dimanches, que d’y participer dans un esprit communautaire. Les fidèles devaient cesser d’être ces ‘spectateurs étrangers et muets’ évoqués par la constitution conciliaire sur la liturgie, qui reprenait une formule de Pie XI en 1928. Dans ces conditions, il était légitime de se demander si l’ancienne sociologie pastorale qui reposait sur le principe de l’obligation de la pratique avait encore un sens et si le décrochage des courbes ne reflétait pas plutôt ce changement de régime » (p. 107).
3) Un fait historique : Vatican II a été un point de rupture
Même si G. Cuchet cherche à défendre la lettre du concile comme Benoît XVI avec la théorie de l’herméneutique de la continuité (discours à la curie romaine le 22 décembre 2005) face à l’herméneutique de la rupture, tout le problème n’est pas là. Un texte conciliaire doit être clair. Jusqu’à Vatican II, pour clarifier des exposés dogmatiques, on reprenait les principales affirmations contraires pour les anathématiser. Or, le simple fait que les textes eussent été ambigus – bien sûr à dessein – et donc soumis à une possible interprétation différente, montre qu’ils sont mauvais. Qu’on le veuille ou non, G. Cuchet prouve que les textes de la période conciliaire ont été interprétés comme une rupture. L’histoire est aussi maîtresse de vérité. Pourquoi vouloir en sauver alors à tout prix la lettre en accusant la mise en pratique, comme sauver l’héritage léniniste ou au moins marxiste en accusant Staline de mauvaise application de prétendues bonnes idées ? L’ambiguïté fait partie du dessein moderniste car il ne peut pas s’opposer frontalement à ce que l’Église affirmait il y a peu. Il s’agit donc d’ouvrir des brèches, de changer de point de vue et perspective. En l’occurrence de plaire aux hommes plutôt qu’à Dieu (Ga 1, 10 : « Maintenant, est-ce par des hommes ou par Dieu que je veux me faire approuver ? Est-ce donc à des hommes que je cherche à plaire ? Si j’en étais encore à plaire à des hommes, je ne serais pas serviteur du Christ »).
Avec un rejet du « juridisme », l’Église a renoncé à faire respecter les propres normes qu’elle avait elle-même émanées. Prenons l’exemple des abus dans la messe moderne. Même le cardinal moderniste Lercaro, à la tête du Consilium chargé de la mettre en place, dénonçait en 1965 des « fantaisies » et autres initiatives « déplorables » : « à travers le monde, on a vu certains réciter tout le canon à haute voix, d’autres le réciter avec le peuple dans la langue du pays. Ailleurs, on distribue la communion en déposant l’hostie entre les mains ouvertes des fidèles ». Dans cette même ligne, la Congrégation pour le Culte Divin publia le texte Memoriale Domini le 29 mai 1969. « D’une part, elle défendait avec différents arguments (théologiques, spirituels et pratiques) la façon traditionnelle de recevoir la communion sur la langue et, s’appuyant sur une enquête menée auprès des évêques du monde entier, elle affirmait qu’elle doit rester la norme ‘parce que c’est une tradition multiséculaire’ et ‘parce qu’elle exprime le respect des fidèles envers l’Eucharistie’. Mais dans une seconde partie plus brève, l’instruction concédait que ‘là où s’est déjà introduit un usage différent’, les Conférences épiscopales pouvaient l’autoriser ». Alors permis ou pas ? Ne sont-ce pas ceux qui respectent les normes de l’Église qui sont pourtant systématiquement mis en accusation et doivent se justifier de faire ce qui est de droit ? Finalement, la désobéissance semble primer et même être récompensée ?
« Le concile a ouvert la voie à ce qu’on pourrait appeler une ‘sortie de la culture de la pratique obligatoire sous peine de péché mortel’ » (p. 135) alors même qu’elle était encore mieux enracinée au XIXe et début XXe siècles que sous l’Ancien Régime (où l’on assistait au moins à un dimanche sur trois) pour les fidèles du commun. L’ancienne culture reposait sur la pratique des six premiers commandements de l’Église, « un ensemble d’obligations strictes intériorisées par beaucoup » (p. 137) :
1) Les fêtes tu sanctifieras, qui te sont de commandement.
2) Les dimanches, messe entendras. Et les fêtes pareillement.
3) Tous tes péchés confesseras, à tout le moins une fois l’an.
4) Ton Créateur tu recevras, au moins à Pâques humblement.
5) Quatre temps, vigiles jeûneras, et le Carême pareillement.
6) Vendredi chair ne mangeras, ni jours défendus mêmement.
« Les obligations canoniques ont été, pour une part, maintenues ; elles ont cependant été assouplies et parfois sérieusement relativisées dans la pratique. Pour l’historien, le phénomène est un peu difficile à saisir parce qu’il ne correspond à aucune consigne expresse de la part du concile, du pape ou des évêques, même s’il est partout palpable dans la documentation » (p. 138). G. Cuchet l’illustre avec l’assouplissement du jeûne eucharistique. En janvier 1953 (Christus Dominus), Pie XII maintenait l’obligation du jeûne depuis minuit mais estimait que la prise d’eau ne le romprait plus désormais. En mars 1957 (Sacram communionem), le jeûne fut réduit à 3h pour la nourriture solide et 1h pour les liquides. En novembre 1964, Paul VI décréta qu’une heure suffirait pour les deux (p. 138-139 repris p. 219). La suppression du maigre le vendredi (abstinence de viande) en janvier 1967 ou « la messe anticipée du dimanche » autorisée à partir de janvier 1969 ont aussi affaibli ans la conscience des catholiques le socle des obligations à respecter.
« Le clergé a ‘désinstallé’ volontairement l’ancien régime de normes qu’il s’était donné tant de mal à mettre en place » (p. 140). « Une partie du clergé a pris conscience tardivement qu’elle avait peut-être été un peu imprudente en sciant si allègrement la branche sur laquelle elle était assise » (p. 141).
III) « On nous a changé la religion ! »
1) Les changements liturgiques et catéchétiques
« Dans le domaine de la piété, des aspects de la réforme liturgique qui pouvaient paraître secondaires, mais qui ne l’étaient pas du tout sur le plan psychologique et anthropologique, comme l’abandon du latin, le tutoiement de Dieu (comment un père pourrait-il damner ses fils ? cf. p. 261), la communion dans la main, la relativisation des anciennes obligations, ont joué un rôle important. De même que les critiques de la communion solennelle qui se sont multipliées à partir de 1960 et surtout de 1965, ainsi que la nouvelle pastorale du baptême (à partir de 1966) et du mariage (en 1969-70) qui avait tendance à hausser le niveau d’accès aux sacrements en exigeant des candidats davantage de préparation et d’investissement personnel » (p. 134). En décembre 1965 les évêques français imposèrent des engagements pour le catéchisme mais aussi une préparation au sacrement, voire des délais pour le baptême pour tester le sérieux de la demande. « Cette pastorale du délai, censée permettre de tester la foi des candidats, était en franche rupture avec l’ancienne insistance sur la nécessité de faire baptiser les enfants au plus tôt (quam primum) dans les seules limites de la validité canonique elle-même largement entendue » (p. 139).
Outre que changeait les rituels allant tous vers un affadissement de la foi en particulier touchant les fins dernières : « avec la déflation des exorcismes dans le nouveau rituel et la nette sourdine mise sur le péché originel, dont il était censé délivrer pour assurer la vie éternelle. Plus encore celle de l’extrême-onction, rebaptisée ‘sacrement des malades’ (…). Participe de la même évolution l’épuisement de la pratique des indulgences, notamment celle qui était donné in articulo mortis, après les derniers sacrements (…) d’autant que le nouveau concile œcuménique, en particulier le dialogue avec les protestants, ne leur était pas favorable (…). On peut en dire autant des limbes des enfants » (p. 254-255).
De même, la jeune génération a décroché, elle qui allait à la messe au moins durant la période 7-12 ans jusqu’à la communion solennelle. La communion privée avait été instaurée dès l’âge de 7 ans pour respecter les normes émanées par S. Pie X dans Quam singulari (1910) mais les évêques, ne voulant pas perdre les bénéfices pastoraux du rite de passage, avaient maintenu la communion solennelle qui était l’objet de réjouissances familiales (cf. Directoire sur la pastorale des sacrements d’avril 1951). Elle pratiquait même sans ses parents, rejoignant les camarades au catéchisme de communion. Son remplacement par la profession de foi (et l’usage de l’aube, au contraire de petits mariés avant, était censée être plus démocratique pour éviter les dépenses somptuaires), l’absence de contrôle de la pratique par un bulletin dûment poinçonné avec obligation de confession mensuelle n’ont pas aidé (p. 148).
La variation de l’enseignement conciliaire ne fut pas comprise par les humbles qui « en déduisent que, si l’institution s’est ‘trompée’ hier en donnant pour immuable ce qui avait cessé de l’être, on ne pouvait pas être assuré qu’il n’en irait pas de même à l’avenir. Toute une série de ‘vérités’ anciennes, liées notamment à la pastorale des ‘fins dernières’, sont tombées brutalement dans l’oubli, comme si le clergé lui-même avait cessé d’y croire ou ne savait plus qu’en dire, après en avoir si longtemps parlé de façon si dramatique » (p. 135).
« La ‘crise catholique’ des années 1965-1978 fut d’abord une crise du clergé et des militants catholiques. L’abandon de la soutane (dès 1962) et de l’habit religieux, la politisation (à gauche généralement) du clergé, les départs des prêtres, de religieux et de religieuses, parfois suivis de leur mariage, sont apparus à beaucoup comme une véritable ‘trahison des clercs’ sans équivalent depuis les ‘déprêtrisations’ de la Révolution, qui a eu les mêmes effets déstabilisants » (p. 135).
2) La fin de la confession ?
« La crise d’un sacrement qui fut, dans les années 1960-1970, si brutale et si profonde que certains ont pu imaginer qu’il avait été tout bonnement supprimé par le concile Vatican II » (p. 199).
En 1952, 51% des adultes baptisés déclaraient se confesser une fois par an, généralement à Pâques, comme il était d’obligation de le faire depuis le concile de Latran IV (1215) réaffirmé au concile de Trente. Parmi eux, 15% se confessaient au moins 1 fois par mois dont 2% une fois par semaine, ce qui représentait plus que le nombre de religieux, séminaristes qui y étaient tenus par le droit (CIC 1917, c. 125, 595 et 1367). Bref, plus on était chrétien et plus on se confessait. En 1974, ils étaient 29%, presque la moitié en moins, 14% en 1983. Les pénitents fréquents avaient quant à eux quasi disparu passant de 15% à 1%, plancher identique pour les sexes, alors qu’il était marqué par un dimorphisme de 1 à 3 auparavant (7% contre 23%). « Ces statistiques ont quelque chose de fascinant pour l’historien en ce qu’elles donnent à voir, ni plus ni moins, une véritable explosion nucléaire du catholicisme français », surtout en son cœur ou force de frappe sociale (p. 204-206).
« La confession était le régulateur par excellence de cette ancienne culture qui avait eu tendance à se durcir au XXe siècle. Beaucoup de Français d’un certain âge en ont gardé un vif souvenir dans lequel un certain amusement le dispute souvent à une forme d’incrédulité rétrospective sur le mode du ‘Comment a-t-on pu nous raconter des choses pareilles ?’ et du ‘Comment a-t-on pu y croire ?’. C’est un phénomène fondamental qui fait sentir partout ses effets dans notre documentation et qui, sans correspondre à aucune consigne officielle particulière, relève surtout des effets d’ébranlement indirects du concile. Le fait est que l’on assiste alors, dès 1963-1964, à une dépénalisation tout à fait nouvelle au sein du catholicisme de l’abstention religieuse, considérée désormais comme secondaire au regard des ‘vrais’ critères de christianisme que seraient la sincérité des consciences, l’engagement militant ou le service de la cité et des pauvres. Les pratiques religieuses – ce qu’on appelait jadis, dans les anciens catéchismes, les ‘commandements de l’Église’ – ont alors cessés d’être présentées comme des devoirs impérieux dont il fallait s’acquitter, bon gré mal gré, parce que c’était l’habitude, que le clergé le demandait et qu’il en allait du salut. Désormais, au contraire, la pratique religieuse devait être d’abord volontaire, et mieux valait à la limite s’en abstenir si l’on ne s’en acquittait que pour de ‘basses’ raisons, comme obéir à de vieilles habitudes ou par crainte de Dieu » (p. 214). Évidemment la confession en fit la première les frais car c’était la pratique « la plus coûteuse et la plus problématique » (p. 214).
D’autant que le clergé lui-même a voulu s’abstenir de s’astreindre à de larges plages horaires pour les confessions. On est loin des martyrs des confessionnaux (p. 220-223) comme les saints Jean-Marie Vianney, Léopold Mandić ou Padre Pio ! D’autant que la parution tardive du nouveau rituel (février 1974) faisait « qu’en attendant, les fidèles ne savaient plus très bien comment se confesser, ni même si était toujours nécessaire de le faire » (p. 224). La désaffection du confessionnal n’aida pas non plus (p. 227-231) puisque maintenant on assiste à des déballages relevant plus de la psychanalyse bien installés sur un fauteuil pour une conversation en face à face dans une casemate de verre. Il faut dire que le commentaire du nouveau rituel fait par Mgr Bunigni, secrétaire de la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements allait en ce sens : « Si le sacrement de la pénitence conféré individuellement doit conduire à un renouveau de vie, il doit se dérouler sous forme d’un dialogue serein et tranquille entre le prêtre et le pénitent, accompagné de prière et, lorsque cela est possible, de lecture de la parole de Dieu, dans un cadre adapté, également du point de vue matériel et sans être pressé par le temps » (p. 230).
Le cas de la contraception était aussi vérifié autrefois (Casti Connubii en décembre 1930 par Pie XI exigeait des confesseurs qu’ils interrogeassent les pénitents sur ce point, sous peine de prévarication (p. 225). « Nul doute que la gestion chaotique du dossier (par l’Église durant le concile avec une commission à part constituée puis des fuites dans la presse au printemps 1967 qui laissaient supposer un changement de la discipline, finalement maintenue par Paul VI en juillet 1968) a pesé fortement sur la crédibilité de l’institution dans les sociétés occidentales ». Sans parler de la confusion voulue par l’épiscopat qui, par conférences épiscopales entières, prétendait le contraire de la saine doctrine rappelée par le pape au prix de tant d’atermoiements.
« Il est probable que l’aller et retour magistériel dans la question des ‘célébrations pénitentielles’ avec absolution collective a aggravé la crise en ajoutant à la confusion » (p. 231). Le Magistère se ridiculise en disant tout et son contraire : « en juin 1972 (…) la congrégation pour la doctrine de la foi juge nécessaire de rappeler que la confession auriculaire devait rester la voie ordinaire de la pénitence (…). ‘Il faut réprouver la pratique qui s’est introduite récemment çà et là, par laquelle on prétend satisfaire au précepte de la confession sacramentelle des péchés mortels en vue d’obtenir l’absolution par la seule confession générale ou accomplie, comme on dit, de façon communautaire’ » tandis qu’en 1974 le nouveau rituel donnait parmi trois possibilités ce même abus ! (p. 231).
3) Le silence sur les fins dernières
« La peur de l’enfer (…) a été, pendant longtemps, un des principaux moteurs de la confession. Le motif était considéré comme normal, même si des raisons plus positives, telles que l’amour désintéressé de Dieu, étaient jugées préférables. Le clergé faisait certes bien la différence entre ‘l’attrition’ et la ‘contrition’, la ‘crainte filiale’ et la ‘crainte servile’, mais il considérait qu’à tout prendre, mieux valait aller à Dieu par la voie de la peur que de ne pas y aller du tout (…). Dans le manuel de l’abbé Chanson, dont la première édition date de 1948 et qui a été largement diffusé dans les séminaires et les presbytères français des années 1950, il était encore bien précisé que la croyance en l’existence du ‘Dieu rémunérateur’, ‘qui récompense les bons au Ciel et punit les méchants en Enfer’ était ‘de nécessité de moyen’ pour être sauvé » (p. 215).
« Le clergé a cessé assez brutalement de parler de tous ces sujets délicats, comme s’il avait arrêté d’y croire lui-même, en même temps que triomphait dans le discours une nouvelle vision de Dieu, de type plus ou moins rousseauiste : le ‘Dieu Amour’ (et non plus seulement ‘d’amour’) des années 1960-1970 » (p. 216).
Finie la route étroite et sinueuse, vive l’autoroute du salut empruntée par tous ! « ‘Les curés ont goudronné la route du ciel’ résumait, au début des années 1970, une vieille paysanne bretonne (née en 1892) dans un entretien avec le sociologue Fanch Élégoët » (p. 216). Autant appeler les choses par leur nom, ce que n’ose faire G. Cuchet : osons dire que le clergé a apostasié en abandonnant comme de vieilles lunes des pans entiers de la vraie foi dont ils font partie intégrante : « En réalité, il s’agissait bien d’un problème de foi et de doctrine, et d’un malaise partagé entre le clergé et les fidèles. Tout se passe en fait comme si, soudainement, au terme de tout un travail de préparation souterrain, des pans entiers de l’ancienne doctrine considérés jusque-là comme essentiels, tels le jugement, l’enfer, le purgatoire, le démon, étaient devenus incroyables pour les fidèles et impensables pour les théologiens » (p. 244-245).
Auparavant, « l’Église apparaissait comme l’arche en dehors de laquelle le salut était, sinon exclu, du moins assez incertain. Certes, il était bien précisé qu’elle avait un ‘corps’ et une ‘âme’ et que les deux ne se recouvraient pas totalement, de sorte qu’on pouvait être du premier sans être de la seconde (par exemple, quand on avait commis un péché mortel), ou même l’inverse (dans le cas des justes non catholiques). Mais on sentait que cette dernière hypothèse était assez exceptionnelle et concernait surtout les catéchumènes qui s’apprêtaient à entrer dans l’Église et qui n’auraient pas eu le temps, pour une raison accidentelle, d’aller au bout de leur initiation. D’où, pour chacun, l’urgence de la conversion et, pour l’Église, celle de la mission » (p. 247-248).
« Là encore, le concile Vatican II me paraît avoir provoqué de manière indirecte l’évanouissement d’un système qui était probablement, au demeurant, sérieusement miné de l’intérieur ». « L’essentiel réside plutôt dans les effets d’ébranlement indirects du concile, au double sens de ce qu’il a mis en crise et en mouvement dans le catholicisme du temps, pas toujours volontairement » (p. 256).
« En premier lieu, la volonté d’ouverture dont il a fait montre à l’égard des non-catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, croyants de tous types et autres incroyants ‘de bonne volonté’ (…). Vatican II a été, de ce point de vue, le théâtre d’une sorte de nuit du 4 août dans l’au-delà qui a mis fin aux privilèges des catholiques quant au salut. Désormais, l’Eglise ne se concevrait plus que comme l’instrument du salut pour tous, sans discrimination ni privilège, même si les fidèles qu’on avait formés jusque-là dans une tout autre théologie risquaient de s’en trouver un peu déstabilisés et de s’interroger, dans ces conditions, sur les bénéfices réels de l’affiliation » (p. 257).
« On a vu, par ailleurs, que la consécration de la liberté de conscience par le concile a souvent été interprétée dans l’Église, de manière imprévue au départ, comme une liberté nouvelle de la conscience catholique, l’autorisant implicitement à faire le tri dans les dogmes et les pratiques d’obligation. La notion même de dogme (comme croyance obligeant la conscience) est alors devenues problématique. Cette décision majeure du concile, couplée à la notion de ‘hiérarchie’ des vérités, paraît avoir fonctionné dans l’esprit de beaucoup comme une sorte de dépénalisation officielle du ‘bricolage croyant’ qui contrastait grandement avec le régime antérieur, où les vérités de la foi étaient à prendre en bloc et sans droit d’inventaire. Il était à prévoir que les plus désagréables d’entre elles, ou les plus contre-intuitives pour le sens commun, en feraient les frais, ce qui n’a pas manqué de se produire » (p. 257-258). Autrement dit c’était le triomphe du subjectivisme et donc du relativisme où chacun se croyait autorisé à se faire sa propre foi maison.
Ce qui explique cette apostasie par l’abandon de pans entiers de la vraie foi s’explique par une accusation inversée (au lieu que ce soit le pécheur qui s’accuse en confession, c’est Dieu sommé de se justifier de ne pas accepter tous les hommes en son Paradis). À la place du salut individuel, avec les compagnons de route du communisme, on imagina une dimension essentiellement collective et aussi qu’il fallait essayer de mettre en œuvre dès ici-bas le Royaume. On note aussi « l’évolution de l’image de Dieu dans le sens d’une accentuation croissante de sa dimension miséricordieuse » (p. 251) à la suite de S. Thérèse si diffusée dans les tranchées de la première guerre. Enfin, « l’univers concentrationnaire » (David Rousset, 1946) traumatisa les gens au point qu’on osait plus parler des souffrances de l’enfer
La mort est le meilleur allié du prédicateur vraiment catholique. « (L’Église) considérait comme étant de l’ordre de sa mission de briser sans relâche dans l’Histoire, pour chaque génération, ce tabou ‘naturel’ de l’humanité. Pour lui permettre, en substance, de ne pas rater sa sortie et de conserver le sens plénier de son existence » (p. 259), alors même que ce tabou de la mort triomphe aujourd’hui socialement, au lieu de celui sur le sexe, par l’hospitalisation systématique qui vous fait mourir seul au lieu de veillées d’agonisants, l’euthanasie, l’incinération. On ‘part’, ‘s’envole’, ‘disparaît’, ‘décède’ au maximum, mais on ne meurt plus !
Conclusion :
En abandonnant une morale claire avec des devoirs obligatoires à accomplir pour être sauvé, on a vu l’influence néfaste du protestantisme se répandue depuis le dernier et funeste concile. En effet, la pratique dominicale s’inscrit dans la logique la plus primaire des bonnes œuvres réclamées par l’Écriture, n’en déplaise à Luther qui avait du coup décidé de ranger l’épître de Jacques dans les écrits non canoniques puisque l’apôtre avait l’affront d’oser dire le contraire de lui : « Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Toi, tu crois qu’il y a un seul Dieu. Fort bien ! Mais les démons, eux aussi, le croient et ils tremblent. Homme superficiel, veux-tu reconnaître que la foi sans les œuvres ne sert à rien ? » (Jc 2, 17-20).
Il est de bon temps d’insister aujourd’hui sur les pauvres. Mais ce sont les pauvres qui furent les premières victimes du modernisme et qui, partant, ont le plus de chance de se perdre en enfer. Dans l’enquête menée à Paris « ce sont les arrondissements populaires qui ont connu la plus forte baisse, c’est-à-dire ceux qui présentaient déjà au départ le niveau le plus bas. La baisse était de 28% pour les VIe, VIIe, VIIIe et XVIe arrondissements, contre 43% pour les IIe, IIIe, Xe, XIe, XIIIe, XVIIIe, XIXe et XXe » (p. 119 ; cf. p. 130). Pourquoi critiquer la « pratique sociologique » pour une prétendue meilleure qualité ? Laissons parler le chanoine Boulard : « J’ai souvent l’impression (…) que nous sommes, au niveau du christianisme populaire français, villes et campagnes, devant une pratique religieuse souvent plus sociologique qu’une conviction personnelle. Il ne faut pas mépriser ce fond sociologique parce qu’il permet à des pauvres, au sens humain du terme, de rester fidèles au Christ. Ce n’est pas rien, puisque le Seigneur qui a voulu que l’homme soit dépendant de son milieu social » (p. 161). Sans même parler de la renonciation de la Sainte Église a une place privilégiée dans les États chrétiens par un système de concordats la reconnaissant comme religion d’État qui favorisait pourtant les pauvres, le philosophe Théodore Jouffroy disait déjà au XIXe siècle, dans un texte célèbre, que « la variation de l’enseignement officiel rendait sceptique les humbles ».
Alors que ne devrions-nous craindre de la confusion systématiquement jetée par le pape François sur les enseignements traditionnels de l’Église (autorisation de facto de la communion aux ‘divorcés-remariés’ (sic), condamnation de la peine de mort, ordination d’hommes mariés). Le premier service à rendre aux pauvres est l’accès à la vérité pérenne de Dieu car « Jésus Christ, hier et aujourd’hui, est le même, il l’est pour l’éternité » (He 13, 8) et sa parole ne passera pas (Mt 24, 35).