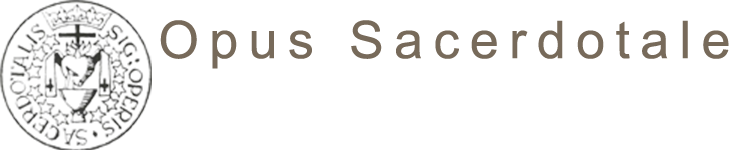Mariage africain et mariage chrétien : retour à une théorie fondamentale du droit du mariage – par M. l’Abbé Jacque-Yves Pertin
Abbé Jacques-Yves PERTIN
Avocat à la Rote romaine
Régulièrement, l’idée qu’il faudrait « repenser la théologie du mariage africain » et qu’il faudrait du même coup reconsidérer la nécessité du mariage dit « chrétien » en Afrique nous est reproposée soit par l’intermédiaire des interventions du SCEAM (Symposium des Conférences d’Afrique et de Madagascar) soit par l’intermédiaire de thèses doctorales comme celle de Jean-Désiré Kabxit Mbind de l’Université de Montréal[1]. Le but pastoral de leur réflexion consisterait à «éviter la superposition de trois types de mariage célébrés par la même personne : mariage coutumier, mariage civil et mariage dans le Seigneur en présence du prêtre » (32).
A la base de la conception particulière du mariage africain on trouve le plus souvent une exaltation de la vie qui a comme première conséquence une vision immanentiste de Dieu : le bien suprême serait la vie qui est Dieu[2]. Tous les être possèdent en effet la vie comme dénominateur commun [3].
L’exaltation de la vie a pour deuxième conséquence une conception naturaliste de la vie humaine, mettant surtout l’accent sur ce qu’on appelait il n’y a pas si longtemps la fin primaire du mariage. La stérilité, par exemple, « constitue pour l’africain un dérèglement incompréhensible de l’ordre social ou familial »[4]. Bien évidemment, cette conception implique le recours à la polygamie non limitée à 4 épouses comme en Islam, qui intervient « lorsque la jeune épouse a failli à sa mission conjugale »[5] ou à des fins plus utilitaristes.
Dans cette logique, pour que chacun puisse subsister, la vie du clan (famille élargie) est essentielle, d’où une conception communautariste et clanique de la société africaine ayant des conséquences non indifférentes sur la conception du consentement matrimonial : « Dans la conception africaine, le mariage est une alliance sacrée non seulement entre deux personnes, mais aussi entre deux lignages ou deux clans (…). Selon les traditions négro-africaines, le mariage africain implique, de soi, l’alliance entre le clan du fiancé et le clan de la fiancée, de telle sorte que, d’un point de vue vital et pratique, le « mariage in facto esse » (état d’union des époux), n’est épanouissant que dans la mesure où est donné aussi le consentement de leurs « ayant-droits » respectifs » (…). L’aspect communautaire est à comprendre dans le sens où, dans son vécu, l’Africain est un « être-avec » les siens et aime se sentir protégé par son entourage, par les siens, par la communauté. Fragile et limité, il manifeste le désir de se sentir soutenu par les membres de sa communauté. (…) La vie d’un couple n’est jamais à considérer comme une affaire des seuls deux conjoints » (135).
Si en raison de la stabilité du clan le divorce n’est pas souhaitable pour la société africaine, les lois coutumières permettent souvent le remariage.
De tout cela, il résulte que le mariage coutumier africain est très fortement fondé sur une dialectique profonde : « la lutte contre la mort pour faire triompher la vie »[6]. Cela est parfaitement cohérent dans un milieu finalement rude où la subsistance et la lutte pour la vie ont façonné ce peuple sans l’apport surnaturel de la Grâce du Christ.
La problématique du sujet de la thèse citée s’articule sur plusieurs notions qui ne sont pas toujours bien définies malgré certaines tentatives.
Pour commencer, le titre lui-même évoque l’une de ces notions qui serait le « mariage dit chrétien» confronté à un autre notion le « mariage africain » dont on vient à peine de tracer les grandes lignes. L’auteur explique en particulier son appellation du mariage « dit chrétien » : « dans le cadre de notre étude, nous avons opté pour le vocable mariage dit « chrétien ». À notre entendement, l’église n’a ni créé, ni institué un mariage. Il s’agit d’un mariage déjà existant qui, sans être supprimé, reçoit une force spirituelle par l’acte du Christ. Il ne s’agit pas d’un autre mariage mais d’un mariage naturel auquel le Christ accorde des grâces divines. Ce mariage existe dans toutes les cultures » (19). Il y aurait donc pleine identification entre tous les mariages existant dans toutes les cultures et le mariage naturel. Ainsi l’auteur assume l’opinion extrême du Cardial Malula « le mariage apparait comme une institution socioculturelle dont le modèle est propre à chaque peuple »[7]. Cette conception, qu’il me soit permis de le dire, relève d’une vision positiviste du droit matrimonial et du droit canonique tout court, puisque ce serait au fond à la coutume de dire de façon extrinsèque ce qu’est le droit naturel.
Si la loi naturelle (ou ce qu’on appelle encore jugements déontologiques naturels) tirait son origine de facteurs culturels cela voudrait dire que la loi naturelle serait en d’autres termes le produit de la culture, un phénomène psychologique créé par la société[8]. Or ceci est absolument impossible parce que chaque fait de culture s’appuie nécessairement sur un présupposé naturel. Il ne s’agit pas d’une théorie mais bien d’un fait d’expérience : notre raison, en effet, ne considère pas de manière indifférente toutes les actions humaines qui peuvent être réalisées mais indépendamment des lois données par la société ; elle émet de jugements à caractère obligatoire. De fait, l’homme est naturellement moral car son esprit possède une structure psychologique capable de lui faire percevoir qu’il existe des choses moralement bonnes et des choses moralement mauvaises (choses à faire/à éviter). Jamais la culture n’aurait le pouvoir de produire une telle structure en l’homme puisqu’il s’agit d’un fait qui concerne sa nature ontologique, ce que la culture ou la société est incapable de lui donner. La seule chose que la culture ou l’influence sociale peut faire percevoir à l’individu est ce qui est sociologiquement normal ou anormal et donc de s’adapter à ce qui est normal mais elle ne peut absolument pas produire l’idée que « on doit faire cela ». La conscience du devoir dépend nécessairement d’une structure naturelle de la raison pratique.
Si, de fait, les jugements qui étaient produits ne devaient se référer qu’à quelque chose d’externe à l’homme, ces jugements ne seraient alors que des jugements de convenance : « je ne dois pas mentir à mon professeur de droit canon sinon il va m’expulser de l’université ». Ce jugement est un jugement de convenance. En revanche si je dis « je ne dois pas mentir car c’est le propre de l’homme de dire la vérité car l’intelligence humaine a pour objet la vérité », ce jugement n’est plus un jugement de convenance mais bien un jugement déontologique de loi naturelle.
Par ailleurs, si les cultures devaient précéder le droit naturel, au lieu d’une vision universelle et transcendante du droit naturel, on aurait aussi une vision dialectique entre les cultures, cliché qui n’a pas été évité dans cette thèse où il est affirmé que l’union conjugale kisi « est culturellement aussi valable que celles célébrées et vécues dans d’autres cultures » entendons une vision qualifiée ailleurs d’occidentale voire importée par la Colonisation, vision dont on trouve le paradigme dans les propos du Cardinal Malula : « le mariage dit chrétien relève de la culture occidentale », vision destinée à « attirer l’attention de tous ceux qui, au plan de la discipline par exemple, seraient tentés d’universaliser et d’implanter partout un modèle unique du mariage »[9].
Pour en finir avec cette vision dialectique qui ne fait rien d’autres qu’exagérer les différences culturelles sans saisir ce qui est en fait leur fondement commun, il faut dire que la mesure de l’agir humain est nécessairement la structure fondamentale de son être. La loi naturelle étant la loi de l’agir humain, les actions humaines ne sont pas dépourvues de sens mais bien au contraire ordonnées aux fins naturelles de l’homme[10]. Ainsi, les fins de l’homme donnent sens et plénitude à la vie humaine. La loi naturelle n’est donc pas un ensemble de prescriptions de la raison sans fondement sur la nature humaine. C’est au contraire la manifestation sous forme de devoirs de l’être humain, de la nature humaine en rapport avec sa fin propre. Nous savons en bon philosophe que c’est la cause finale qui donne un sens à l’existence d’une chose. Une conséquence importante est que, ni les passions ni les différents mouvements spontanés et empiriquement observables, ne font partie de la loi naturelle mais seulement les inclinations qui manifestent une tendance vers les fins de l’homme. Ceci, pour ne pas nous égarer vers une espèce d’immanentisme subjectiviste qui viendraient à faire considérer certaines pratiques désordonnées de l’être humain comme des pratiques naturelles. De fait, « la connaissance de la loi naturelle n’est pas innée (…) ce qui est inné c’est la syndérèse et les inclinations naturelles d’où jaillit la connaissance facile et sure des préceptes fondamentaux de la loi naturelle. Ainsi les préceptes de la loi naturelle sont œuvre de la raison. Toutefois, il peut s’avérer difficile de connaitre les préceptes qui dérivent des préceptes fondamentaux et commettre des erreurs dans le raisonnement pour les connaitre parce que la raison humaine n’est pas infaillible »[11].
La loi naturelle est inhérente à toute homme et transcende évidemment toute culture en obligeant tout homme indifféremment. La loi naturelle est, pour ainsi dire, la mesure de toute culture ou coutume et en est sa condition[12]. C’est donc une loi universelle dans l’espace et le temps puisque la nature humaine et ses fins ne peuvent varier. La loi naturelle dérivant de la nature humaine n’est pas dépendante de la dimension historique de la personne humaine. La loi qui dépend de la dimension historique est la loi positive et les coutumes dont se pourvoit l’être humain : l’évolution historique est en effet le domaine d’action de la loi humaine. La loi naturelle est la loi de la nature de l’homme, c’est pourquoi, nous pouvons dire, sans entrer dans des discussions qui ne nous intéressent pas ici, qu’elle est immuable à l’instar de la nature humaine elle-même. La coutume est soumise au changement, et anticipons quelque peu, en disant qu’elle peut être malheureusement soumise aussi à toutes les déviations.
Il n’est pas dans notre propos d’énumérer tous les contenus de la loi naturelle, disons simplement, pour ce qui nous occupe, que l’inclination à l’union conjugale entre un homme et une femme pour former ensemble la première communauté de l’espèce humaine ordonnée à la génération et à l’éducation des enfants fait partie de ce contenu primordial de la loi naturelle.
Ainsi lorsqu’on parle de mariage en droit canonique, on parle essentiellement de cette réalité qui se rapporte au droit naturel et non à la coutume. Je ne parle même pas ici des différences entre le mariage coutumier et le mariage naturel, je dis simplement qu’il n’y a qu’une seule nature du mariage est que celle-ci répond au droit naturel.
Ceci étant posé, il nous faut nous pencher maintenant sur une autre notion qui, dans cette thèse pose également problème et que nous avons volontairement évité de développer jusque-là. Je veux parler du mariage qualifié de « chrétien ». S. Thomas d’Aquin distingue à cet égard 3 moments dans l’histoire de l’humanité au cours duquel le mariage, dit-il, a été institué : en tant qu’il a pour fin la génération des enfants qui était nécessaire déjà avant le péché originel, le mariage a été (premier temps) institué dans l’état d’innocence : ce mariage n’existe plus en tant que tel aujourd’hui car le péché originel a blessé l’homme dans les choses naturelles : vulneratus in naturalibus; ensuite comme remède contre la blessure du péché, son institution a été postérieure au péché, et a eu lieu au temps de la loi naturelle dit S. Thomas (deuxième temps) ; c’est la loi de Moïse qui l’a institué selon certaines déterminations ; mais en tant qu’il représente le mystère de l’union de Jésus-Christ avec l’Église, il n’a reçu son institution que sous la loi nouvelle (troisième temps) et c’est ce qui en fait un sacrement du Nouveau-Testament. On parle alors de mariage sacramentel. St.Thomas dit enfin que le mariage a d’autres avantages, tels que l’amitié réciproque des époux et les services qu’ils se rendent et, sous ce rapport, la loi civile lui a donné une sorte d’institution ». Il va de soi que la loi civile ne peut réglementer la substance du mariage qui est en dehors et au-dessus de la sphère civile. Chacune de ces institutions a conféré au mariage des caractéristiques qui lui sont propres (Supp., XLII, 2).
Ainsi l’élévation du mariage naturel au rang de sacrement n’a pas changé fondamentalement la nature profonde et les finalités du mariage naturel. La grâce, en effet, ne change pas la nature mais la présuppose et surtout la perfectionne. On connait tous cette citation de Familiaris Consortio « le sacrement de mariage a ceci de spécifique parmi tous les autres : d’être un sacrement d’une réalité qui existe déjà dans l’économie de la Création, d’être le même pacte conjugal institué par le Créateur » (Jean-Paul II, Exhortation apostolique Familiaris Consortio, 68). Le Pape ne dit pas dans ce texte que la réalité naturelle est déjà sacrement : S. Thomas explique en effet qu’il n’a pas été institué comme sacrement avant Jésus-Christ mais plutôt « comme une fonction naturelle. Il signifiait néanmoins l’union future de Jésus-Christ et de son Église, de même que tout ce qui a précédé le Christ l’a figuré » (ST, III, 61/3 ad 3um). Le mariage sacrement n’a été en effet institué comme sacrement « qu’après le péché », car avant le péché, il n’y avait pas de difficultés particulières à surmonter (ad 1um).
C’est pourquoi il est important de bien souligner que « les questions juridiques matrimoniales et familiales qui intéressent l’Église relèvent (…) essentiellement du domaine des relations humaines naturelles sur lesquelles ultimement est construite la dimension salvifique surnaturelle »[13].
Ainsi l’expression « mariage chrétien » même si elle peut convenir dans un sens large et dans l’expression courante pour englober la réalité matrimoniale naturelle élevée au rang de sacrement, il me semble qu’elle est inadéquate, trompeuse et ambigüe au moment où l’on doit se pencher sur des coutumes particulières : en effet, soit l’on parle de mariage naturel c’est-à-dire conforme au droit naturel, soit l’on parle de mariage sacramentel, de ce mariage naturel qui est sacramentel chez les baptisés qui y consentent validement. Chez les baptisés, en effet, le baptême ne leur permet plus d’accéder à un mariage purement naturel (il ne s’agit pas d’une interdiction, bien évidemment, mais d’une impossibilité ontologique). Pour eux, mariage naturel et mariage sacramentel n’est qu’une seule et indissociable réalité (can. 1055, § 2). On peut en tirer ainsi cette conséquence et ce principe qu’entre deux baptisés si le mariage est valide sur le plan naturel il est alors sacrement. C’est sur ce principe qu’est fondée par exemple la possibilité d’examiner pour l’Église la nullité matrimoniale. Toutefois, si les époux baptisés voulaient quand même un mariage dépourvu de sa dimension sacramentelle, on serait en droit de se poser la question de leur volonté matrimoniale tout court, ce qui pourrait faire l’objet d’un procès en nullité.
Il me semble que pour venir à bout du malentendu entretenu par cette thèse, il aurait fallu se référer à une saine théorie fondamentale du droit. En effet, si on ne le fait pas, on risque de passer à côté de la véritable nature du droit canonique en en faisant une suite de prescriptions positives à la portée de n’importe quel législateur. L’Église, en effet, non seulement affirme sa juridiction sur les mariages des baptisés (can. 11, can. 1059, 1401, 1671) mais aussi sur ceux des non-baptisés soit par la dissolution du lien en faveur de la foi (can. 1143-1150), soit par l’empêchement de disparité du culte (can. 1086), soit encore par la nullité matrimoniale que l’Église traite en raison de sa mission magistérielle donnée par le Christ au service de toutes les âmes et de toutes les consciences (Dignitas connubii, art. 4, § 2). Notons à ce propos que, lorsque l’Église exerce sa juridiction sur des mariages entre non-catholiques, ce n’est pas sans oublier le droit divin et les principes de droit naturel (can. 22).
Pour revenir à ce qui nous occupe principalement, on ne voit pas comment le mariage coutumier africain pourrait simpliciter être considéré comme un mariage naturel. Que certains éléments de nature soient présents comme l’échange des consentements, pourquoi pas ?[14] Mais il reste aussi beaucoup d’éléments corrompus s’opposant au bonum fidei, au bonum prolis et même au bonum coniugum, faussant gravement l’objet du consentement notamment à cause de la pratique de la polygamie et de la possibilité du divorce et de toutes ses conséquences.
Il nous faut dire maintenant quelques mots sur le sujet plus spécifique de la polygamie, sujet pratiquement ignoré dans cette thèse. S. Thomas qui a l’art de la distinction nous apprend que celle-ci « est contraire, non pas aux premiers préceptes de la loi naturelle, mais aux préceptes secondaires qui sont comme des conclusions découlant des premiers » (S. Thomas d’Aquin, Somme Théologique, Suppl. 65/2). Et il précise : « la loi qui prescrit de n’avoir qu’une seule épouse n’est pas une loi humaine, mais une loi divine ; jamais elle n’a été donnée verbalement ni par écrit, mais elle est imprimée dans le cœur, comme tout ce qui tient en quelque manière à la loi naturelle. Aussi Dieu seul a-t-il pu en dispenser » (65/2).
« La pluralité des épouses ne supprime pas complètement, ni même n’empêche en quelque façon, la fin première du mariage, puisqu’un seul mari suffit pour féconder plusieurs épouses et élever leurs enfants. Par contre, si elle n’est pas un obstacle absolu à la fin secondaire du mariage, elle en gêne cependant considérablement la réalisation » (Suppl. 65/1). En effet l’amour parfait tend à la donation totale qui ne peut se réaliser qu’entre 2 personnes ; de plus, l’amour conjugal étant un amour d’amitié, il sous-entend un amour exclusif ; cette amitié sous-entend enfin une dignité égale entre l’époux et l’épouse or la pluralité d’épouse réduit l’épouse à une condition inférieure (S. Thomas, S. c. Gent. IV, 124)[15].
A ce propos, on peut très bien se demander pourquoi tant de personnes n’obéissent pas à loi naturelle si elle est si naturelle que cela. C’est au fond le constat de beaucoup de pasteurs d’âmes qui, au nom d’une théorie pastoraliste du droit, souhaiteraient une pleine reconnaissance du mariage coutumier pour aller à la rencontre de tant de couple chrétiens qui restent éloignés des sacrements. C’est certainement un problème très douloureux et qui est fortement souligné dans cette thèse. Devant ce constat que l’on ne nie pas, un élément de réponse consiste à dire que la loi naturelle est la loi de la réalité morale de l’homme dans le contexte de l’agir de l’homme qui est libre (…). En effet si on ne pouvait pas lui désobéir, il s’agirait d’un instinct ou d’une loi physique. Que beaucoup y désobéissent est le risque de la liberté… Que certains soient convaincus jusqu’à défendre des conduites opposées à la loi naturelle ou jusqu’à sembler totalement l’oublier est la conséquence de cette même liberté humaine qui, par erreur de raisonnement, par manque de domination des passions ou par ce que l’on pourrait qualifier d’ingénierie sociale finit par tordre la raison, la conscience et provoquer ignorance et erreur. Le problème du mariage africain se situe justement, à mon sens, dans le contexte précis de l’erreur. Or le sujet est totalement ignoré. Pourtant il est capital.
On sait que l’erreur concernant l’unité ou l’indissolubilité n’a pas de soi le pouvoir de vicier le consentement matrimonial puisque la nature du mariage en tant que loi naturelle reste profondément enracinée dans la nature humaine sauf si une erreur en venait à entrainer la volonté à ne pas vouloir le mariage sur le plan naturel[16]: ce qu’on appelle l’erreur déterminante (can. 1099)[17]. Le point de vue du Code, notons bien, est individuel. L’erreur dont il s’agit concerne le consentement hic et nunc des personnes concernées et ne porte pas un jugement d’ordre général sur les coutumes humaines déviantes…Toutefois il est évident que certaines coutumes risquent aussi de façonner les volontés individuelles au point de mettre en péril chez les futurs époux l’objet exact du consentement. Et cela n’est pas spécifique au contexte africain puisque nous souffrons aujourd’hui de cela en Europe. Le Pape François lui-même, faisait remarquer dans son discours à la Rote de 2015 que c’est « sur le contexte humain et culturel [que] se forme l’intention matrimoniale », en tout cas qu’elle en subit malheureusement les influences, qu’on le veuille ou non (Pape François, Discours à l’occasion de l’inauguration de l’année judiciaire du Tribunal de la Rote Romaine, 23 janvier 2015). Le Pape citait dans le même discours le cas « d’un grand nombre de fidèles en situation irrégulière, dont l’histoire personnelle a été fortement influencée par la mentalité mondaine diffuse » et il concluait que « le manque de connaissance des contenus de la foi [et on pourrait ajouter le rejet des contenus de la nature elle-même] pourrait conduire à ce que le Code appelle une erreur déterminant la volonté (cf. can. 1099) » (Cf. Relatio Synodi, octobre 2014, n. 10, 24). C’est à ce propos que le Pape concluait que « cette éventualité ne doit plus être considérée exceptionnelle comme par le passé, étant donné justement la prédominance fréquente de la pensée mondaine sur le magistère de l’Église » (ibid.).
Je signale également que la conversion de l’Occident au Christianisme a permis d’éradiquer la pratique de la polygamie qui existait chez certaines civilisations barbares. On affirme parfois que la polygamie a continué à subsister chez les rois de France. À part le fait que la polygamie suppose la conclusion d’un mariage avec chaque épouse (ce qui n’a jamais existé chez les Rois de France), il est assez significatif (une rapide recherche sur internet suffit pour le constater) que l’argument de ladite polygamie des rois de France est présenté comme un argument en faveur de la polygamie tout court par certains activistes islamistes voulant démontrer à l’Occident qu’il s’agit d’une pratique naturelle. Il faudrait reproposer S. Thomas… Il est également significatif que l’on a vu poindre à nouveau la polygamie en Occident à partir du moment où l’on a commencé à remettre en cause l’ordre surnaturel et plus spécifiquement l’ordre de la Grâce par l’entremise de la Réforme protestante[18]. Luther a en effet enseigné la polygamie comme licite sous la loi nouvelle : il permet par exemple à Philippe de Hesse d’avoir une deuxième épouse[19]. Cela montre en filigrane à un quel point la conversion à Notre-Seigneur a le pouvoir de restaurer en nous la loi naturelle souvent défigurée par le vieil homme.
Si on laisse un instant de côté le point de vue de l’objet du consentement et que l’on s’attarde maintenant sur le thème de la forme canonique qui serait un obstacle pour les catholiques africains, la question n’est pas si simple et mériterait d’être abordée de manière approfondie.
La législation actuelle prévoit au canon 1148 que si un polygame non baptisé (homme ou femme) qui a plusieurs conjoints non baptisés reçoit le baptême, il peut choisir celui des conjoints avec lequel il souhaite rester, se séparant des autres, sans être obligé de rester avec le premier conjoint. Cette dernière référence au « premier conjoint » est intéressante car cela semblerait indiquer que, pour l’ordonnancement ecclésiastique, l’unique mariage valide (naturel ?) serait le premier. Je pense pouvoir dire que cette incise est une survivance de la législation précédente. Effectivement, le canon 1126 du Code de 1917 allait dans ce sens lorsqu’il affirmait qu’en cas de conversion d’un polygame le mariage sacramentel contracté avec l’épouse de son choix avait comme conséquence de dissoudre ipso iure le mariage avec la première épouse « in infidelitate contracti ». Ce qui est encore plus remarquable c’est que l’Église ne demandait pas le renouvellement du consentement comme elle l’impose aujourd’hui au can. 1148, § 2. Cette prescription ne figurait en effet pas dans le code de 1917. Le canon 1125 de ce Code se contentait de renvoyer aux différentes constitutions des Papes du 16ème siècle. Si on cherche la raison de cette pratique c’est que la conversion impliquait dans la pensée de nos anciens le rejet des erreurs du paganisme et, par une fiction juridique, ils admettaient sans difficulté la validité sacramentelle d’un tel mariage in favorem fidei. Cela montre, et c’est assez paradoxal, à quel point l’Église de l’époque du décret Tametsi (qui a introduit la forme canonique), n’était pas si formaliste[20] !
Comme on vient de le dire, l’Église aujourd’hui impose l’obligation de contracter un mariage selon la forme légitime. Les sources de cette prescription légale nous font remonter à une réponse du Saint-Office datant seulement du 30 juin 1937 et faisant suite à différentes facultés décennales de plusieurs nations[21]. Notons que, pour certains canonistes contemporains, dans le cas où le polygame choisirait sa première épouse, « ce nouveau consentement dans la forme légitime [ne serait] pas en soi nécessaire puisque le consentement peut avoir été naturellement suffisant et persister encore »[22]. Les consulteurs du Code de 1983, qui, semble-t-il, admettaient eux-aussi que la réitération du consentement n’était pas nécessaire, ont tout de même préféré la maintenir « comme meilleur moyen de faire le constat de la volonté du baptisé en ce qui concerne le choix du conjoint » (ibid., Comm. 10 [1978] p. 114-116, 34 [2002] p. 276-278). Bien évidemment, en cohérence avec ce que l’on vient de dire, si ces derniers arguments avaient été professés par les Papes du 16ème siècle, cela aurait impliqué l’obligation pour les pasteurs un lourd travail de vérification de l’intention matrimoniale des contractants qui n’a jamais été préconisé du fait que ces papes contemplaient ici non la question du consentement comme fait séparé de la conversion mais au contraire en lien profond avec celle-ci. Tout cela pour dire que la proposition en fin de compte de type juridiciste qui consisterait ou de retenir le mariage coutumier comme forme canonique ou de dispenser de celle-ci ne résout rien car ce qui compte, et la pratique séculaire de l’Église nous l’a démontré, c’est une réelle conversion au Christ qui implique un respect de la loi naturelle telle que l’a voulue le Créateur. La forme canonique, en ce sens, ne se limite pas, comme cela est affirmé aussi, à résoudre la question des mariages clandestins, elle célèbre dans notre législation canonique le fait de se soumettre à la loi divine, toujours plus attaquée. La réticence que certaines populations peuvent manifester par rapport au mariage sacramentel peut effectivement poser question. C’est pourquoi lorsque l’auteur affirme que sa thèse : « n’étudie pas comment le mariage se célèbre en Afrique subsaharienne. Elle consiste à déterminer si ce qui se célèbre dans ce continent est un mariage ou un péché public. Ce qui se célèbre peut-il être appelé sacrement ? » est une question faussée tant que l’on ne revient pas à une saine théorie fondamentale du droit concernant le mariage. En un mot ce sont aux cultures à s’inculturer au Christ et pas l’inverse. Il me semble que repenser la « théologie du mariage africain » devrait en passer par là.
[1]J.D. Kabwit Mbind, Repenser la théologie du mariage africain ; La célébration du mariage dit « chrétien », est-elle nécessaire en Afrique? Institut d’études religieuses – Faculté des arts et des sciences ; Thèse présentée à la Faculté des études supérieures et postdoctorales en vue de l’obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph.D.) en théologie, 2019. Elle se trouve en ligne.
[2] L. Thomas. & R. Luneau., Les Sages dépossédés, Univers magiques d’Afrique Noire, Paris, 1977, p. 22.
[3] F. Kabasele Lumbala, Renouer avec ses racines. Chemins d’inculturation, Paris, 2005, p. 260
[4] J. Zacka, La dot, défi du mariage chrétien en Afrique, Paris, 2016, p. 25.
[5] E. Vangu Vangu, Sexualité, Initiatives et étapes du mariage en Afrique, Paris, 2012 p. 22.
[6] E. Vangu Vangu., op. cit., p. 24.
[7] J. Malula, Mariage et famille en Afrique : intervention du cardinal Malula au Congrès de Yaoundé, in Documentation Catholique, 81 (1984), pp. 872.
[8] Dans ces quelques lignes, on reprend pêle-mêle des passages d’Hervada dans son Introduzione critica al diritto naturale, Milano, 1990, p. 139 et suiv.
[9] Ibid.
[10] « L’expression “droit naturel” a plusieurs acceptions. Tout d’abord, on appelle droit naturel, en raison de son principe, celui qui est établi par la nature. C’est la définition qu’en donne Cicéron lorsqu’il écrit : « Le droit naturel est celui qui n’est pas le produit de l’opinion, mais qu’une force innée a mis en nous ».
Dans l’ordre de la nature, on appelle naturels certains mouvements, non parce qu’ils proviennent d’un principe intrinsèque, mais parce qu’ils proviennent d’un principe supérieur jouant le rôle de moteur. C’est ainsi qu’Averroès appelle naturels les mouvements qui, dans les éléments, proviennent de l’influence des corps célestes. Pour le même motif, on range dans le droit naturel ce qui est de droit divin, puisque cela provient de l’action et de l’influence d’un principe supérieur qui est Dieu. C’est ainsi que l’entend S. Isidore lorsqu’il dit que le droit naturel est celui qui est contenu dans la loi et l’Évangile.
Le droit naturel peut enfin tirer son nom, non seulement de son principe, mais aussi de la nature, lorsqu’il a pour objet les choses naturelles. Puisque la nature se distingue par opposition de la raison qui donne à l’homme sa caractéristique propre, si l’on prend l’expression de droit naturel dans son sens le plus strict, on n’appellera pas droit naturel ce qui concerne uniquement les hommes, lors même que cela serait dicté par la raison naturelle. On réservera ce nom à ce que dicte la raison naturelle touchant ce qui est commun à l’homme et aux autres animaux. On aboutit alors à la définition déjà donnée le droit naturel est ce que la nature a appris à tous les animaux » (S. Thomas d’Aquin, Somme Théologique, Suppl. 65/1,4).
[11]J. Hervada, Cos’è il diritto, Roma, 2013, p. 113.
[12] « L’homme contemporain se montre très sensible à l’historicité et à la culture, et cela amène certains à douter de l’immutabilité de la loi naturelle elle-même et donc de l’existence de « normes objectives de la moralité » valables pour tous les hommes actuellement et à l’avenir, comme elles l’étaient déjà dans le passé : est-il possible d’affirmer que sont universellement valables pour tous et permanentes certaines déterminations rationnelles établies dans le passé, alors qu’on ignorait le progrès que l’humanité devait faire par la suite ? On ne peut nier que l’homme se situe toujours dans une culture particulière, mais on ne peut nier non plus que l’homme ne se définit pas tout entier par cette culture. Du reste, le progrès même des cultures montre qu’il existe en l’homme quelque chose qui transcende les cultures. Ce « quelque chose » est précisément la nature de l’homme : cette nature est la mesure de la culture et la condition pour que l’homme ne soit prisonnier d’aucune de ses cultures, mais pour qu’il affirme sa dignité personnelle dans une vie conforme à la vérité profonde de son être. Si l’on remettait en question les éléments structurels permanents de l’homme, qui sont également liés à sa dimension corporelle même, non seulement on irait contre l’expérience commune, mais on rendrait incompréhensible la référence que Jésus a faite à « l’origine », justement lorsque le contexte social et culturel du temps avait altéré le sens originel et le rôle de certaines normes morales (cf. Mt 19, 1-9). Dans ce sens, l’Église « affirme que, sous tous les changements, bien des choses demeurent qui ont leur fondement ultime dans le Christ, le même hier, aujourd’hui et à jamais ». C’est lui le « Principe » qui, ayant assumé la nature humaine, l’éclaire définitivement dans ses éléments constitutifs et dans le dynamisme de son amour envers Dieu et envers le prochain » (Jean-Paul II, Veritatis Splendor, 53).
[13] C.J. Errázuriz, Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa II, I beni giuridici ecclesiali, Milano, 2017, p. 284.
[14] Le versement de la dot tient lieu souvent de consentement et assure la stabilité de l’union dans les mariages coutumiers : « Le mariage n’est valable que si la dot a été versée » (66).
[15] « la loi qui prescrit de n’avoir qu’une seule épouse n’est pas une loi humaine, mais une loi divine ; jamais elle n’a été donnée verbalement ni par écrit, mais elle est imprimée dans le cœur, comme tout ce qui tient en quelque manière à la loi naturelle. Aussi Dieu seul a-t-il pu en dispenser, par une inspiration intérieure. Cette inspiration a été reçue surtout par les patriarches et par leur exemple elle s’est communiquée aux autres hommes, à l’époque où il fallait ne pas observer ce précepte de la nature pour favoriser la multiplication des enfants destinés au culte de Dieu. Toujours, en effet, il faut rechercher la fin principale avant la fin secondaire. La fin principale du mariage étant le bien des enfants il a fallu, à l’époque où leur multiplication était nécessaire, négliger momentanément l’obstacle qui pouvait gêner l’obtention des fins secondaires, obstacle dont la suppression est précisément, comme nous l’avons vu, le but de la loi qui interdit la polygamie » (S. Thomas d’Aquin, Somme Théologique, Suppl. 65/2). « Cette dispense, cependant, n’est pas contraire aux principes que Dieu a inscrits dans la nature, mais les transcende, puisque, nous l’avons vu, ces principes ne sont pas destinés à trouver toujours leur application, mais seulement dans la plupart des cas » (65/2,2). « L’avènement du Christ inaugure l’ère de la plénitude de sa grâce, par laquelle le culte de Dieu s’est répandu dans toutes les nations par une propagation spirituelle. Il n’y a donc plus la même raison de dispenser qui existait avant la venue du Christ, alors que le culte de Dieu se multipliait et se conservait par la propagation charnelle » (65/2,4).
[16] Cf. Allocution à la Rote Romaine, 30 janvier 2003, n. 8.
[17] L’erreur en tant qu’acte de l’intelligence (erreur simple) n’a pas d’effet sur la validité du consentement qui est lui, un acte de la volonté car il peut arriver en effet comme le dit une sentence coram Pinto qu’une erreur sur les propriétés essentielles « manet in intellectu quin voluntatem moveat » (sent. diei 6 novembris 1972, RRDec., LXIV). Ce que le code vise, ce n’est pas un « mere assensum mentis in falsum » mais « in dimensione omnino practica seu agendi, concitando et movendo propensiones et inclinationes voluntatis in obiectum falso iudicio rationis designatum. Nam ratio practica iudicat et sententiat de agendis quia non solum est directiva exteriorum actuum, sed etiam inferiorum passionum » (S. Thomas, ST, I-II, q.74/6-7 ; cf. c. Bottone, sent. diei 18 iunii 2008, ibid. vol., C, p. 97, n. 7). Du coup, on peut appliquer les dictons juridiques des anciens Romains : « errantis voluntas nulla sit » (ibid.) ; « non consentiant qui errent : quid enim tam contrarium consensui est quam error » (Ulp. Dig. 2, 1, 5). Pour vérifier la nullité d’un consentement matrimonial que l’on soupçonne d’avoir été vicié par une erreur déterminante, le Pape recommande de chercher pour l’erreur l’ « intensité telle qu’elle conditionne l’acte de volonté, déterminant ainsi la nullité du consentement » (Ioannes Paulus II, Allocutio ad Rotam Romanam diei 29 ianuarii 1993, AAS [1993], 1259).
[18] « le premier homme fut établi par Dieu dans la possession de la science concernant toutes les choses dont l’homme peut être instruit : tout ce qui existe virtuellement dans les premiers principes immédiatement connus, c’est-à-dire tout ce que les hommes peuvent naturellement connaître. D’autre part, pour gouverner sa vie personnelle et celle des autres, on a besoin de connaître non seulement ce qui peut être connu naturellement, mais aussi les choses qui dépassent la connaissance naturelle, car la vie de l’homme est ordonnée à une fin surnaturelle » (S. Thomas, op. cit. I, 94/3).
[19] Philippe, landgrave de Hesse, l’un des plus ardents protecteurs de Luther, avait épousé Catherine de Saxe ; mais cette femme, quoique belle et sage, ne put jamais lui plaire. Après avoir, pendant plusieurs années, adressé ses vœux à différentes beautés, il s’attacha d’une manière plus constante à Marguerite de Staal. Une maladie grave dont il eut beaucoup de peine à se guérir, lui inspira quelques craintes sur le résultat de sa conduite ; il résolut donc de mettre sa conscience en repos.
Pour y parvenir, il adressa un mémoire à Luther, où, s’appuyant sur l’Ancien Testament, il demandait la permission d’avoir deux femmes à la fois : l’une qui, dans son palais, serait traitée publiquement comme princesse et comme épouse ; l’autre qui, sans scandale, deviendrait légalement sa concubine. Quoique le prince supplie les docteurs de lui accorder cette grâce, il les menace de s’adresser soit à l’empereur, soit au pape, s’il n’obtient pas ce qu’il désire : ensuite il leur fait les plus belles promesses. « Qu’ils m’accordent donc, au nom de Dieu, dit ce prince, ce que je leur demande, afin que je puisse plus gaiement vivre et mourir pour la cause de l’Evangile, et en entreprendre plus volontiers la défense ; je ferai de mon côté tout ce qu’ils m’ordonneront selon la raison, soit qu’ils me demandent les biens des monastères ou d’autres choses semblables. »
Cette singulière négociation fut confiée à Buter, qui ne négligea rien pour la faire réussir. Les docteurs protestants furent embarrassés : d’un côté, ils craignaient de discréditer leur doctrine par une complaisance aussi excessive ; de l’autre, ils ne voulaient pas perdre un protecteur dont ils avoient besoin. Enfin, Mélancton, leur meilleur écrivain, rédigea une consultation qui fut approuvée par eux. Voici quelques morceaux de celte pièce peu connue.
Elle est faite avec beaucoup d’adresse : les théologiens établissent, d’après l’Evangile, que l’homme ne doit avoir qu’une seule femme ; ils font sentir au prince quel désordre règnerait, si cette loi fondamentale de la société était détruite ; enfin ils lui représentent que la princesse, son épouse, est un modèle de vertus, qu’elle lui a donné plusieurs enfants, etc.
« Mais enfin, ajoutent-ils, si Votre Altesse est entièrement résolue d’épouser une seconde femme, nous jugeons qu’elle doit le faire secrètement, c’est-à-dire qu’il n’y ait que la personne qu’il épousera et peu d’autres personnes fidèles qui le sachent, en les obligeant au secret sous le sceau de la confession. Il n’y a point ici à craindre de contradiction, ni de scandale véritable ; car il n’est point extraordinaire aux princes de nourrir des concubines, nihil enim est inusati principes concubinas alere : et quand le même peuple s’en scandaliserait, les plus éclairés se douteront de la vérité, et les personnes prudentes aimeront toujours mieux cette vie modérée que l’adultère et les autres actions brutales. L’on ne doit pas se soucier beaucoup de ce qui s’en dira, pourvu que la conscience aille bien : nec curandi aliorum sermones, si recte cum conscientia agatur. C’est ainsi que nous l’approuvons, et dans les seules circonstances que nous venons de marquer : car l’Evangile n’a ni révoqué, ni défendu ce qui avait été permis dans la loi de Moïse, à l’égard du mariage, etc. »
Cette approbation est signée de huit docteurs : Luther, Mélancton, Bucer, Corvin, Adam, etc. Le 4 mars de l’année suivante (1540) Philippe de Hesse épousa Marguerite de Staal, dans le château de Rothembourg. Le contrat de mariage n’est pas moins curieux que la consultation :
« Comme l’œil de Dieu, y est-il dit, pénètre toute chose, et qu’il en échappe peu à la connaissance des hommes, Son Altesse déclare qu’elle veut épouser Marguerite de Staal, quoique la princesse, sa femme, soit encore vivante, et pour empêcher que l’on n’impute cette action à l’inconstance ou à la curiosité, pour éviter le scandale, et conserver l’honneur de cette fille, et la réputation de sa parenté, Son Altesse jure ici devant Dieu et sur son âme et conscience, qu’elle ne la prend pour femme, ni par légèreté, ni par curiosité, ni par aucun mépris du droit ou des supérieurs, mais qu’elle y est obligé par de certaines nécessités, si importantes et si inévitables, de corps et de conscience, qu’il lui est impossible de sauver sa vie et de vivre selon Dieu, à moins que d’ajouter une seconde femme à la première.
« Que Son Altesse s’en est expliquée à beaucoup de prédicateurs doctes, dévots, prudents et chrétiens, et qu’elle les a là-dessus consultés ; que ces grands personnages, après avoir examiné les motifs qui leur avaient été représentés, ont conseillé à Son Altesse de mettre son âme et sa conscience en repos par un double mariage. Que la même cause et la même nécessité ont obligé la sérénissime princesse Christine, duchesse de Saxe, première femme de Son Altesse, par la haute prudence et par la dévotion sincère qui la rendent si recommandable, à consentir de bonne grâce qu’on lui donne une compagne, afin que l’âme et le corps de son très cher époux ne courent plus le risque, et que la gloire de Dieu en soit augmentée, comme le billet écrit de la main de cette princesse le témoigne suffisamment».
Une permission plus étendue a été accordée dans le siècle dernier, par des docteurs calvinistes, à Frédéric Guillaume, père du roi de Prusse régnant. Ce prince eut en même temps trois femmes, Elisabeth de Brunswick, la princesse de Hesse, et la comtesse d’Euhof. L’autorisation des docteurs était fondée, comme celle de Luther, sur ce qu’il valait mieux contracter un mariage illégal que de courir sans cesse d’erreurs en erreurs cf. 7 décembre 1539 : autorisation donnée par Luther au Landgrave de Hesse, d’avoir deux femmes à la fois (france-pittoresque.com).
[20] « errores quos hactenus observarunt, penitus ab eorum mentibus et cordibus abiecerint…» (Constitution de Paul III Altitudo, Doc. VI, CIC 1917). Voir aussi la Constitution Romani Pontificis de S. Pie V du 2 août 1571.
[21] E. de Bekker and G. Taylor, Parish Priest and marriage cases, Bangalore, ed. de 1978, p. 36. L’auteur rapporte l’exemple de la faculté décennale des missionnaires en Inde n°18 (1971-1980 donc avant le code de 1983) qui affirme : « 10. To allow, for a grave reason, non-christians having several wives to retain after baptism the one they prefer provided she is also baptized, without making interpellation to the first wife. The matrimonial consent must be renewed ».
[22] C. Peňa García, Mariage et causes de nullité dans le droit de l’Église, Paris, 2023, p.440, note 875.