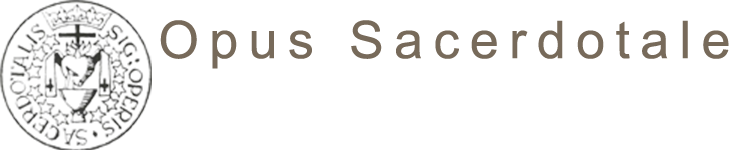Res Novæ – décembre 2022
Res Novæ décembre 2022
Pour commencer la transition liturgique :
célébrer vers le Seigneur
Le fait, pour un curé de paroisse, de célébrer à nouveau vers le Seigneur et non plus vers le peuple est chose minime en comparaison de ce que serait l’adoption par ce prêtre du rite ancien, mais elle est cependant déjà en soi énorme. Tout le monde comprend en effet qu’on tire ce faisant sur le fil d’une pelote, celle de la réforme liturgique, laquelle va dès lors tout entière se dévider.
Voilà pourquoi le retournement de la célébration est l’acte premier et décisif de ce que l’on appelle la réforme de la réforme, laquelle est, comme nous avons eu occasion de le dire, un processus de transition[1]. Dans un livre d’entretiens que nous avions publié dans cette perspective en 1997, Reconstruire la liturgie[2], la plupart des intervenants disaient qu’en effet la reprise de la célébration vers l’Orient liturgique était le premier acte à accomplir[3].
Par qui devra être lancé ce processus ? À terme, par un pape et des évêques qui voudront se consacrer à cette reconstruction. Dans un temps plus rapproché, par des évêques diocésains ou non diocésains, mieux encore des cardinaux, qui lanceront de manière décidée ce processus, entraînant à leur suite – et soutenant dans les difficultés considérables qu’ils vont rencontrer – le plus grand nombre possible de prêtres de paroisse.
Un débat historique tranché
Les archéologues s’interrogent sur la place de l’autel à l’intérieur de l’édifice dans l’Antiquité chrétienne. Mais où qu’ait été l’autel, le fait que la prière antique (messe, offices divers) ait été orientée pour manifester l’attente vigilante du retour du Christ à la fin des temps est puissamment attestée[4] : « Car, comme l’éclair part de l’Orient et apparaît jusqu’à l’Occident, ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme » (Mathieu 24, 27).
Joseph Andreas Jungmann, un des acteurs majeurs du Mouvement liturgique, avait en outre observé, qu’à l’époque patristique, la position du célébrant face à l’est se trouvait plus fortement attestée, en Syrie par exemple, là où la dimension sacrificielle de l’Eucharistie était la plus explicitée par les Pères. Et il remarquait : « L’affirmation souvent répétée que l’autel de l’Église primitive supposait toujours que le prêtre soit tourné vers le peuple, s’avère être une légende[5]. » D’ailleurs, dans l’Église anglicane, au XIXe siècle, pour un certain nombre de membres du Mouvement d’Oxford, note Uwe Lang, une des manières de restaurer l’héritage catholique et de souligner l’expression du caractère sacrificiel de l’Eucharistie a été de retrouver l’orientation du culte.
C’était par traditionalisme rigoureux qu’à Saint-Pierre de Rome et à Saint-Jean de Latran, où l’abside est à l’ouest, le pape avait conservé l’habitude de célébrer vers l’Orient géographique et pas seulement liturgique, se tournant ainsi vers la nef.
Le face au peuple, anticipation et symbole de la réforme
Il s’agissait là, et en quelques autres endroits, d’un versus populum de fait. En revanche, le versus populum intentionnel, apparu dans le cadre du Mouvement liturgique, avait, sous prétexte (erroné) de retour à l’antique, valeur œcuménique. C’était en réalité un emprunt au protestantisme (au moins calviniste, car le culte luthérien était volontiers orienté). On vit ainsi se développer des expériences de face au peuple dès avant la seconde guerre mondiale, sur des autels aménagés pour la circonstance, dans les haltes de pèlerinages, dans les activités champêtres des mouvements de jeunesse, spécialement au sein du scoutisme, mais aussi dans quelques paroisses « avancées ».
Bien connue est la réaction de Paul Claudel, dans un article du Figaro littéraire du 29 janvier 1955, protestant contre « l’usage qui se répand en France de plus en plus de dire la messe face au public », et dont la paroisse Saint-Séverin, à Paris, donnait l’exemple. Lors de grands rassemblements, comme celui de la JAC, en 1950, au Parc des Princes, on prit l’habitude de placer l’autel au centre de l’assemblée. De même, dans la basilique souterraine Saint-Pie-X à Lourdes, consacrée en 1958, l’autel avait été édifié au milieu de la nef, ce qui instaurait nécessairement une célébration face au peuple pour la moitié de l’assistance.
Mais c’est au début des années soixante que les célébrations face au peuple devinrent, en France, en Allemagne, en Belgique, plus nombreuses. Elles devinrent progressivement quasi universelles à partir de 1964, début de la réforme liturgique. On peut d’ailleurs parler ici d’un processus de transition[6], inverse de celui que nous préconisons. Si bien que les textes qui promulguèrent la réforme n’eurent même pas besoin d’évoquer le sens de la célébration : il était acquis que la nouvelle messe se célébrait normalement face au peuple.
Les obstacles à lever pour un retour
Ainsi, même si, à strictement parler, le face au peuple n’est pas obligatoire dans le cadre de la réforme, il reste que, selon la perception commune, la messe nouvelle a deux caractères saillants : elle est dite en langue vulgaire et célébrée face au peuple. De sorte que toute tentative de revenir, sur le terrain des paroisses, à la célébration vers le Seigneur, est immédiatement combattue avec la dernière énergie par les défenseurs de la réforme. On l’a vu lors de la tentative du cardinal Sarah, dont traite Philippe Maxence dans la présente livraison de Res Novæ. En outre, ce processus de retournement se heurte à la résistance d’un certain nombre de fidèles due à plus de cinquante ans d’habitude opposée.
Ce qui ce passe actuellement au Kerala, au sud de l’Inde, au sein de l’Eglise syro-malabare (la plus importante Église orientale unie à Rome après l’Eglise gréco-ukrainienne), est à cet égard instructif. Au terme d’une long combat entre anciens et modernes, le synode syro-malabar avait opté pour un compromis et décidé, en 1999, que les prêtres feraient face à l’assemblée jusqu’à la prière eucharistique et seraient ensuite face à l’autel durant celle-ci, ceci récemment approuvé par le pape François. Mais même cette transaction a paru insupportable aux tenants du tout face au peuple, qui tentent, non sans violence, de faire barrage avec cet argument : « La messe face aux gens est notre tradition ». La querelle des anciens et des modernes à fronts renversés…
Ce qui est au fond un avantage : la réintroduction progressive d’une liturgie traditionnelle dans les paroisses aura l’attrait d’une nouveauté, d’une nouveauté non pas démagogique, celle fois, mais de grande qualité spirituelle.
Abbé Claude Barthe
[1] Imaginer une sortie de crise pour l’Église – Res Novae – Perspectives romaines.
[2] Claude Barthe, Reconstruire la liturgie, François-Xavier de Guibert.
[3] Voir également deux titres contraposés pour une même visée : Levatois Marc, La messe à l’envers, Editions Jacqueline Chambon, 2009 ; Claude Barthe, La Messe à l’endroit, L’Homme nouveau, collection Hora Decima, 2010.
[4] Voir entre autres : Uwe Michael Lang Se tourner vers le Seigneur. L’orientation de la prière liturgique, Ad Solem, novembre 2006.
[5] « Der neue Altar », dans Der Seelsorger, 37, 1967, 374-381.
[6] Paul VI avait donné de sa personne pour cette transition en célébrant lui-même une messe en italien et face au peuple, à Rome, dans l’Église de Tous les Saints, le 7 mars 1965.
————–
Pas de restauration de la liturgie sans volonté réelle
Par Philippe Maxence
Il n’y aura pas de restauration de l’Église possible, sans envisager une période de transition liturgique. Outre que celle-ci agira sur une amélioration de la liturgie en elle-même, elle aura aussi des conséquences sur une réappropriation par le peuple chrétien de la doctrine et des mœurs catholiques. Non par un coup de baguette magique, mais par une imprégnation permanente. Lex orandi, lex credendi. Reste que cet effort liturgique, qui s’insère dans une visée plus large, de véritable réforme de l’Église, nécessite des hommes pour l’accomplir. Des prêtres, des évêques, un pape ! Encore faudra-t-il que les artisans de ce « retour » aient la volonté décidée de l’accomplir malgré tous les obstacles qu’ils rencontreront.
Or, que constatons-nous ? Depuis un peu plus de quarante ans, cette volonté a manqué aux hommes d’Église, alors même qu’ils auraient pu amorcer ce « retour » et qu’ils en parlaient. Plus exactement, ils se sont contentés de vouloir – et encore faiblement – un encadrement de la réforme. Benoît XVI a théorisé cette tentative, qui s’applique notamment à la liturgie, en la qualifiant d’« herméneutique de la réforme dans la continuité », qu’on pourrait aussi qualifier d’herméneutique de conservation des acquis du concile, dans une perspective modérée.
La liturgie nouvelle rectifiée selon Jean-Paul II
Il est clair que Jean-Paul II, puissamment aidé par le cardinal Joseph Ratzinger, a voulu imposer une troisième voie entre la réaction traditionaliste et la marche en avant progressiste. En ce qui concerne la liturgie, il s’agissait alors de mettre en application une interprétation de la réforme liturgique en tentant de la placer, dans une certaine mesure, dans le fil de la tradition liturgique. La parole officielle consistait alors à affirmer que la réforme liturgique constituait la dernière étape d’une réforme organique de la liturgie romaine, à l’instar des réformes antérieures de saint Pie X, Pie XII ou Jean XXIII. Une parole officielle qui avait pourtant quelques difficultés à entrer dans les esprits tant le fossé séparant la liturgie traditionnelle de la nouvelle liturgie semblait abyssal à tout spectateur honnête qu’il préfère d’ailleurs l’une ou l’autre de ces liturgies.
À vrai dire, la difficulté ne venait pas seulement de la compréhension intellectuelle de ces liturgies que de la pratique elle-même de la nouvelle liturgie. D’où la multiplication des textes pontificaux pour à la fois célébrer la réforme liturgique issue du Concile et pour en corriger les mauvaises interprétations.
Cependant, cette volonté de corriger les abus et de donner une interprétation correcte de ce qu’est « la vraie liturgie » issue du Concile trouvait une première limite dans la pratique liturgique du pape lui-même, notamment de Jean-Paul II. Malgré tout, peut-être sous l’influence de son très bugninien maître de cérémonies, Mgr Piero Marini, le pape de la « restauration », qui était aussi le pape d’Assise, a présidé des Eucharisties dont le moins que l’on puisse dire est qu’elles s’éloignaient de l’interprétation que le même pape et les organes curiaux compétents en la matière tentaient de faire passer par ailleurs. De la même manière, la célébration d’un rite dit zaïrois en la basilique Saint-Pierre ne s’est pas déroulée la première fois sous le pontificat de François mais sous celui de Jean-Paul II. Il faut dire que Jean-Paul II, qui avait des dons incontestables d’acteur, était parfaitement à l’aise dans la liturgie nouvelle où la part de « jeu » du célébrant est très importante.
Cette distorsion entre la parole et la pratique signale déjà un premier échec d’inscrire la liturgie réformée – certains diraient « révolutionnée » – dans la Tradition.
La liturgie nouvelle traditionalisée, selon le rêve de Benoît XVI
L’intérêt de Benoît XVI pour la liturgie et sa piété personnelle plus sensible aux fastes liturgiques auraient pu modifier durablement la donne. Son motu proprio Summorum Pontificum redonnait une visibilité à la liturgie traditionnelle et reconnaissait qu’elle n’avait jamais été interdite. Même s’il n’a pas ensuite beaucoup défendu son texte pour que les évêques laissent les curés l’appliquer, la liturgie traditionnelle en a profité, puisque de 2007 à 2017, le nombre des messes traditionnelles célébrées dans le monde a doublé.
Cependant en créant la notion de deux formes – l’une ordinaire ; l’autre extraordinaire – du même rite romain, Benoît XVI tentait encore d’inscrire la liturgie réformée dans le sillage des livres liturgiques antérieurs tout en reconnaissant que deux formes subsistaient. Personne ne fut dupe de la tactique adoptée pour faire avaler la couleuvre d’une reconnaissance d’un droit à l’existence de l’ancienne liturgie.
En fait, cette coexistence des « deux formes » devait d’ailleurs conduire, dans l’esprit du pape, à une correction de l’une par l’autre, opération baptisée « enrichissement mutuel », laquelle devait déboucher à terme sur une « réforme de la réforme » en vue du retour à une forme liturgique unique, inscrite intégralement et véritablement dans la Tradition. Comme le comte de Chambord avait déclaré jadis qu’il fallait reprendre le mouvement de réforme arrêté par 1789, Benoît XVI entendait visiblement reprendre le cours des réformes organiques, passant sans la nier toutefois au-dessus des années de transgressions liturgiques. Le succès de ce dessein ne fut pas plus heureux que pour le successeur des rois de France.
L’idée de l’enrichissement mutuel n’était pas complétement nouvelle chez Benoît XVI. Il l’avait déjà exprimée alors qu’il était encore le cardinal Ratzinger lors du colloque liturgique de Fontgombault (2001) et il avait déclenché alors la réaction de son ami Robert Spaemann qui ne voyait vraiment pas en quoi ni comment l’ancienne liturgie pouvait être enrichie. En réalité, c’est essentiellement la liturgie nouvelle que Benoît XVI voulait « enrichir », c’est-à-dire transformer, mais sans avoir à le dire, ni surtout à l’imposer par des actes de gouvernement…
Toujours est-il que durant son court pontificat, Benoît XVI a certes remis à l’honneur certains objets liturgiques anciens, mais il n’a jamais célébré, pas même en la fête de saint Pie V, l’usus antiquior, pourtant remis à l’honneur par ses soins, ni même corrigé la dite « forme ordinaire », ni appliqué les quelques éléments avancés par lui-même naguère pour la « réforme de la réforme ». Il s’est contenté de donner personnellement la communion sur les lèvres lors des célébrations qu’il présidait.
Une fois encore – et de manière plus décevante que sous Jean-Paul II, parce que le dessein était plus clair et les circonstances plus favorables –, la distorsion entre la parole et la pratique a été l’une des marques de ce pontificat et indique en quelque sorte l’échec (comment le qualifier autrement ?) du conservatisme liturgique, ce dernier terme étant entendu comme la volonté de maintenir la réforme liturgique tout en tentant de conserver le plus possible l’idée d’une continuité liturgique, consubstantielle à toute vraie réforme, de vouloir sans vraiment vouloir, de dire sans faire. Le moins que l’on puisse dire est que François a tranché radicalement et qu’il a, pour sa part, mis en conformité parole et pratique.
L’occasion manquée du cardinal Sarah
Aujourd’hui, le cardinal Sarah semble être l’un des meilleurs représentants de ce courant qui voudrait accommoder le nouveau à l’ancien. Homme d’une grande piété, et même d’une piété toute traditionnelle, ayant passé avec courage par les fourches caudines d’un pouvoir persécuteur, il a été, ratzinguérien déclaré, cependant nommé au Culte divin dans la première partie du pontificat de François, encadré il est vrai de collaborateurs qui ont systématiquement bridé toutes ses tentatives de correction de la réforme.
Il a ainsi œuvré avec une entière fidélité à la fois au pape régnant et à la benoîte idée d’une conciliation entre ancien et nouveau rite. Il ne cesse donc de défendre la nécessité de respecter les normes liturgiques, de remettre à l’honneur le sacré et de retrouver ce sens vrai de la liturgie qui consiste à rendre d’abord et avant tout un culte à Dieu plutôt que d’exprimer les états variants d’une assemblée, celle-ci fût-elle eucharistique. Comment ne pas saluer ce souci, ce rappel de tant de choses vraies et justes, surtout venant d’un prélat à la parole souvent forte et qui est certainement un véritable saint ?
Certes, le cardinal Sarah, comme l’avait fait plus souvent encore Joseph Ratzinger quand il était cardinal, a célébré à plusieurs reprises selon l’usus antiquior, apportant ainsi le renfort de sa notoriété et de sa piété exemplaire, à la réhabilitation pratique de la messe traditionnelle.
Mais sa tentative avortée d’engager au retournement de la célébration vers le Seigneur a été particulièrement décevante, en ce sens qu’il l’a lancée, puis ne l’a pas soutenue.
Lors du congrès Sacra Liturgia, tenu à Londres en avril 2016, le cardinal Sarah, alors Préfet de la Congrégation pour le Culte divin, en présence de Mgr Rey, évêque de Fréjus-Toulon, a appelé à un retour massif de la célébration ad orientem, en suggérant aux prêtres qui le souhaitaient de commencer dès le premier dimanche de l’Avent 2016 à célébrer de la sorte.
Mais il fut immédiatement contredit par l’archevêque de Westminster, le cardinal Nichols, qui a écrit aux prêtres de son diocèse pour leur déconseiller de suivre son conseil. S’ensuivirent un communiqué du directeur de la Salle de Presse vaticane, le 11 juillet 2016, expliquant que « de nouvelles directives liturgiques (n’étaient) pas prévues », puis une convocation du cardinal par le pape pour une entrevue au cours de laquelle il semble que le sujet fut à peine abordé, mais qui fut considérée par les médias comme une mise en garde du pape au cardinal.
Manifestement douché par ces difficultés tout de même prévisibles, le cardinal s’abstint de mettre en pratique lui-même l’invitation qu’il avait faite aux prêtres : dans ses nombreux voyages, y compris lors de circonstances qui l’eussent permis sans difficulté (à Lourdes, où Mgr Brouwet attendait un tel geste ; plus récemment, dans une église de Paris, entouré des plus classiques des clercs qui espéraient cet encouragement), il célébra et célèbre toujours invariablement face au peuple. Ici encore, paroles mais pas gestes.
* * *
Ce que l’histoire a retenu comme étant la réforme grégorienne, du nom du pape saint Grégoire (VII), est en fait le résultat de l’action de plusieurs pontifes, avant Grégoire et après celui-ci, même si ce dernier en a été le principal acteur. Reste qu’elle a été portée par des hommes qui ont voulu réformer l’Église et qui ont posé les actes nécessaires à sa concrétisation. Pour sortir du système autobloquant, incarné par la réforme liturgique aux effets bien plus larges que le simple domaine liturgique, les évêques doivent et peuvent poser le premier pas, le plus visible, le plus parlant, le plus symbolique : la célébration face à Dieu. Ce faisant, ils ne poseront pas seulement le premier acte d’une réforme, mais ils honoreront Dieu comme ils le doivent.
Philippe Maxence
————–
De l’inculturation liturgique dans une anti-culture
L’accélération des évolutions culturelles et sociales dans les pays occidentaux pose avec plus d’acuité une question lancinante depuis la réforme de la liturgie : celle, désirée voire demandée par le concile Vatican II, de son inculturation.
L’impossible inculturation dans une culture en mutation
Les essais ont été nombreux, dès avant le dit Concile. Ainsi, dans le cadre des mouvements d’Action catholique, avant la seconde guerre mondiale et surtout après, on vit s’organiser des processions d’offrandes, où les instruments de travail ainsi que leur produit, étaient présentés avec le pain et le vin qui feraient la matière du sacrifice eucharistique. Si l’on s’interrogea alors sur le bien-fondé de présenter ces objets comme matière « associée » du sacrifice alors que c’en sont plutôt des fruits, fruits d’une vie chrétienne œuvrant dans la création et la société, le moins que l’on puisse dire est que, nonobstant la solution à l’objection liturgique et théologique soulevée, la démarche a définitivement tourné court. Ne restent que des dessins d’enfants ou, dans les « messes des peuples », des danses et des fruits bien exotiques pour un européen. On est assez loin d’une ambitieuse incarnation de la liturgie dans la vie moderne, de son inculturation… Mais l’aurait-on poursuivie, qu’est-ce qu’une telle procession, après l’automatisation du travail, la désindustrialisation, la tertiarisation et actuellement son ubérisation, pourrait aujourd’hui apporter qui représente « le fruit de la terre et du travail des hommes » ? Le monde du travail a profondément changé, et change encore, rendant illusoire l’idée d’en tirer une symbolique durable.
Le langage a lui aussi changé et surtout, exerçant sur lui leur influence, les mœurs. Au risque de choquer quelque lecteur, mentionnons cette assemblée d’adolescents gloussant et se regardant goguenards en entendant le prêtre parler de la « vierge »… Plus profondément et surtout institutionnellement, la parole féministe a conduit à l’intégration aussi dans le langage liturgique de formules qui, si elles sont plus explicites, sont moins élégantes et alourdissent une rhétorique dont, en monde latin, on louait auparavant la finesse et la concision : « frères et sœurs… celles et ceux… », etc. Ces deux exemples illustrent ce à quoi la célébration en langue vernaculaire ne peut manquer d’être confrontée, car, dans ses mots, elle est inévitablement et immédiatement interprétée à l’aune de la langue telle qu’elle est parlée ici et maintenant. On peut certes, pour pallier les difficultés, aller de périphrases et de lourdeurs sémantiques en circonlocutions explicatives. Néanmoins, le processus ne s’annonce-t-il pas sans fin, et ne s’opère-t-il pas au détriment d’une langue liturgique qui a été l’honneur de l’Église latine ? Elle se meurt d’ailleurs, cette langue liturgique ; ne reste que le langage de tous les jours, qu’une certaine pastorale exige d’ailleurs, puisque « tout le monde » doit pouvoir comprendre…
L’impossible inculturation dans une société en déconstruction
Les sociétés modernes et postmodernes sont donc en décalage, grand et grandissant, par rapport à la foi et à son expression liturgique. Ce constat suffit-il, satisfait-il ? Ne doit-on pas, pour manifester davantage le rouet auquel l’inculturation de la liturgie se trouve mise, se demander si nos sociétés sont simplement capables d’être le lieu d’une inculturation ?
Prenons l’exemple simple et parlant de l’agenouillement et de la communion sur la langue. Ils ont été remplacés par la station debout et la communion dans la main : telle est l’attitude de l’homme moderne, du chrétien adulte, ont prôné les chantres de ces changements.
Qui ne voit la disparition de l’adoration qui en a découlé ? Comprenons bien de quoi il s’agit, en partant d’une parole papale récente : Le pape François, dans l’exhortation apostolique Desiderio desideravi, a dénoncé un sacré étranger au mystère chrétien, où l’on s’égarerait. Il lui a opposé, non pas un profane banal, mais l’Incarnation et la Présence réelle et, pour le croyant, l’émerveillement. En illustration de celui-ci, il a cité la belle exclamation eucharistique de saint François d’Assise contenant ces mots : « L’humanité entière tremble, l’univers entier tremble et le ciel se réjouit, quand sur l’autel, dans la main du prêtre, le Christ, le Fils du Dieu vivant, est présent. Ô hauteur admirable et valeur stupéfiante ! Ô sublime humilité ! Ô humble sublimité !… humiliez-vous aussi, afin d’être élevés par Lui. »
Dès lors, si l’on concède bien volontiers que l’hommage du vassal devant le seigneur féodal n’est plus d’actualité, on ne peut que tenir – s’appuyant sur toutes les autorités possibles, jusqu’à celle mentionnée à l’instant – que l’adoration est consubstantielle du culte de l’Église. Elle s’exprimait – et s’exprime encore – extérieurement par l’agenouillement, qui peut également signifier la pénitence. Dans une société qui achève la déconstruction de toutes les autorités, même moribondes ou évanescentes, en quelle réalité ou attitude actuelle, en quel sentiment communément connu et reconnu aujourd’hui pourrait-on couler, « inculturer » l’adoration, l’humilité, l’émerveillement du fidèle lorsque « le Seigneur de l’univers, Dieu et Fils de Dieu s’humilie au point de se cacher, pour notre salut, sous un petit semblant de pain » ? (François d’Assise à nouveau)
En fait, au milieu d’essais infructueux, il y a une dimension de notre société dans laquelle la liturgie réformée s’est aisément insérée, dont elle s’est inspirée : la mentalité démocratique. La participation des fidèles demandée par le concile, mais comprise selon une modalité extérieure et sensible, a effectivement trouvé en elle un modèle : convivialité sincère ou de commande (les messes « festives »), multiplication des interventions et des intervenants, partages en petits groupes se substituant à l’homélie, adaptation au plus près des caractéristiques de l’assistance et de ses supposées attentes… Peut-être l’échec partout ailleurs explique-t-il que cette inculturation-là soit si prégnante. Les autres – et les plus importants – aspects du culte butent contre une réalité « culturelle » qui ne se prête absolument pas à la rencontre, qui n’en est pas capable, voire s’y oppose en ses principes. Cette unilatéralité même force et dévie la prière publique de l’Église : souvent – les papes n’ont cessé de le dénoncer, sans beaucoup d’effet -, dans de telles assemblées, l’autocélébration de la communauté le disputant à la créativité et à l’émotivité, la cérémonie ne relève plus vraiment du culte, de la liturgie, puisqu’il n’y a plus alors ni rite, ni orientation vers Dieu.
L’impossible inculturation d’une liturgie déstructurée
Nombreux sont les prêtres et les fidèles qui rechignent à la démocratisation du culte. Fréquemment, si ce n’est toujours, ils se tournent alors, soit explicitement vers le vetus ordo, soit plus indistinctement vers les usages et les coutumes antérieurs à la réforme pour combler les trous et les silences du novus ordo. La marche vers le monde moderne et l’inculturation s’en trouve ralentie ou stoppée, à la mesure de l’ampleur de ces emprunts.
Ce fait-là amène une question subsidiaire à notre problème d’ensemble : inculturation, soit… mais que veut-on inculturer ? Quelle liturgie ?
L’inculturation, si l’on en admet la possibilité – et on ne saurait la refuser par principe – implique la rencontre de deux organismes, en quelque manière vivants et complexes, fruits d’une élaboration lente et en partie mystérieuse, de doctrines et de règles, de coutumes et de pratiques, de symboles et de mœurs, etc. (une forêt de symboles, selon le titre d’un ouvrage de l’abbé Barthe) ; rencontre lente elle aussi, faite d’ajustements et de transformations réciproques, que la coutume entérinera ou rejettera, que l’autorité permettra ou sanctionnera. Il y faut, de part et d’autre, de la santé, de la vigueur…
Or, lorsque le Concile demanda, en vue d’une réforme de la liturgie, qu’on distinguât entre éléments essentiels, intangibles et éléments qui, eux, pouvaient changer, cela se traduisit par une rapide, très rapide (en quelques courtes années) désarticulation du rite romain ancien, supprimant des cérémonies (les vertus qui les commandaient se trouvant alors sans expression ni support cérémoniel), simplifiant d’autres, ajoutant de nouvelles, qu’elles fussent extirpées de l’antiquité ou créées de toutes pièces. Un nouvel ensemble, où la pluralité de choix est posée en principe, fut ainsi proposé, le nouvel ordo, dont on peut justement se demander s’il mérite, au même titre que l’ancien, le titre d’ordo.
Éclairons la parenthèse ci-dessus : on a déjà parlé de l’adoration et de l’humilité ; signalons deux autres vertus essentielles du culte, la dévotion et la révérence : la suppression de la précision des rubriques concernant la célébration par le prêtre laisse ces vertus sans support concret et aisément repérable, non que ces vertus soient absolument attachées à tel geste ou tel moment (ce serait une forme de rubricisme), mais l’âme du prêtre se trouvait – se trouve – favorisée dans son attention et son élévation par ces mentions. Il en va de même du rôle des servants, des attitudes des fidèles dans l’assemblée. Si rien n’est dit, pourquoi, quand et comment faire quelque chose ? Ne finira-t-on pas par ne faire que ce que le cœur nous en dit ? On ne saurait se satisfaire de cela.
* * *
Au terme de cette rapide analyse, la gageure de l’inculturation, non seulement du côté d’une culture qui n’en est plus une, mais aussi du côté d’un rite incomplet et fluide, paraît bien aventureuse.
Abbé Jean-Marie Perrot
————–
Crise et avenir du christianisme selon Andrea Riccardi
Le présent article a été initialement publié sur le site de L’Homme nouveau.
Le livre d’Andrea Riccardi, L’Église brûle. Crise et avenir du christianisme[1], considère l’incendie de Notre-Dame de Paris comme une parabole de la situation du catholicisme. L’auteur se souvient de « l’optimisme et de la passion [qui] ont marqué les années qui ont suivi le Concile ». C’était l’époque du rêve. Mais aujourd’hui la réalité est là, violente : certains (Emmanuel Todd, Hervé Le Bras, Jérôme Fourquet) ont cru pouvoir parler de « crise terminale » du catholicisme.
Andrea Riccardi n’est pas un intervenant secondaire au sein du catholicisme italien et mondial. Il est le principal fondateur et la première personnalité de la puissante et influente Communauté de Sant ’Egidio, fondée en 1968 (définitivement en 1973), établie dans l’église Sant ‘Egidio, à Rome, quartier du Transtevere. Cette Communauté vouée au service des plus pauvres, est montée en puissance dans les années 1980 en s’engageant dans le dialogue interreligieux et le travail pour la paix, jusqu’à exercer une action diplomatique internationale. Présente dans 70 pays, on la qualifie d’« ONU du Vatican », avec ses 50.000 adhérents dont les plus actifs sont dits les « caques blancs » du pape. L’historien Émile Poulat, ami de Riccardi, et créateur du Fonds Émile et Odile Poulat-Sant ’Egidio-France, aimait à dire qu’elle représentait un des canaux de « la diplomatie de l’ombre » du Saint-Siège. Ainsi, entre autres, a-t-elle joué un rôle efficace de médiation dans les négociations entre le gouvernement du Mozambique et le parti de la résistance armée, mais aussi au Burundi, au Guatemala, au Liban, en Côte d’Ivoire, au Libéria. Bref, Andrea Riccardi, qui a d’ailleurs été ministre de la Coopération internationale dans le gouvernement Monti, est une personnalité politique et religieuse (en Italie c’est encore possible) de poids.
C’est au point que, lors des dernières élections à la présidence de la République italienne, qui a vu finalement Sergio Mattarella porté au Quirinal, il était considéré comme un quirinabile très sérieux. Cet homme, qui n’est assurément pas de droite mais s’est très bien accommodé des papes Wojtyla et Ratzinger et qui se veut inclassable – on le dirait en France de centre-gauche – passe en revue l’état moribond ou très inquiétant selon les cas du catholicisme en divers pays, France, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, Pologne et Slovaquie où il résiste encore, Hongrie et Tchéquie où il décline rapidement. Riccardi, sans apprécier le moins du monde le modèle du « national-catholicisme » qui réapparait à l’Est, tant catholique qu’orthodoxe (national-orthodoxe, si on veut), remarque d’ailleurs que François, pape complexe, manifeste une certaine convergence avec le patriarche Kirill de Moscou rencontré à La Havane. Mais si le « national-catholicisme » appartenait au passé après le Concile, la démocratie chrétienne, qui était alors le présent majuscule, appartient aujourd’hui au passé.
Le constat de faillite est impressionnant : effondrement du monde des religieux et des religieuses, phénomène dont on minimise l’importance en se focalisant sur la crise des séminaires et l’évanouissement de la pratique ; rupture profonde que constitue la dévaluation du caractère normatif du magistère (emblématiquement, la norme d’Humanæ vitæ, annihilée dès que promulguée en 1968) ; la dévalorisation de la mémoire imprudemment orchestrée par le « néo-tridentinisme conciliaire » des clercs de l’après-Vatican II qui méprisaient la sensibilité « retardataire » peuple chrétien (Riccardi, tout en précisant qu’il n’a aucune nostalgie pour la liturgie ancienne, donne l’exemple de la réforme de Paul VI).
Mais alors, quel avenir ? Andrea Riccardi reste dans l’ordre de généralités par lesquelles il tente de se raccrocher à « l’enthousiasme » – un mot qui revient souvent sous sa plume – de ses jeunes années postconciliaires. De Jean-Paul II, qui a finalement échoué, il faudrait retrouver « la capacité à être charismatique » ; de Benoît XVI, dont le pontificat semble se résumer à l’échec manifesté par sa renonciation, on devrait conserver les réflexions sur les « minorités créatrices » ; de François, pour lequel « de nombreux catholique sont passés de l’enthousiasme à la désillusion », il conviendra de retenir l’affirmation que l’Église doit être l’Église des pauvres [ce qui est, pour le coup serait une affirmation très traditionnelle si le discours bergoglien n’inclinait vers ce qu’on pourrait appeler un démago-catholicisme]. On notera au passage cette information assassine : le cardinal Martini, ex-cardinal jésuite de Milan, figure emblématique du catholicisme ouvert, s’était dit défavorable à l’élection de son confrère jésuite de Buenos-Aires au cours d’une conversation avec Riccardi (tenue vraisemblablement en 2005).
Au traditionalisme et à leurs alliés conservateurs, auxquels A. Riccardi, spécialiste des jeux d’influence, reconnaît « une certaine importance », il reproche ce qu’il considère comme une erreur : « mettre l’accent sur l’élection du pape » et essayer d’influencer le futur conclave (il donne l’exemple de deux livres portant tous deux le même titre The Nex Pope, des Américains Edward Pentin et George Weigel), ce qui est selon lui une « naïve simplification face à des dynamiques plus complexes ». Mais la preuve qu’il donne, à savoir le fait que l’élection de Paul VI a été finalement obtenue par le report de voix conservatrices comme celle d’Ottaviani, montre que c’est plutôt ce point en effet décisif qu’est l’élection du pape qui résulte d’une dynamique complexe.
En conclusion : « Il faut avoir le courage de libérer des énergies constructives et créatives en communiquant l’Évangile, de les susciter, de donner confiance et d’apporter son soutien à des réalités ecclésiales différentes, même imparfaites » [c’est nous qui soulignons] Riccardi pense spécialement aux néo-catéchumènes, qui ne sont pas exactement sa tasse de thé, comme on dit. La solution ne viendra pas « de la seule initiative des évêques », mais il faut que ceux-ci « accompagnent, suscitent et fassent grandir ».
Riccardi se place ainsi dans la ligne de ce programme informel et réaliste pour un prochain pontificat, sur laquelle semble se positionner une partie de ceux qui se sont retrouvés sous la bannière bergoglienne : accompagner tout ce qui manifeste encore vie et vigueur et fédérer ces « énergies » dans une « communion » apaisante et libérale. On ne peut pas ne pas penser à l’alter ego ecclésiastique d’Andrea Riccardi, le cardinal Matteo Zuppi, archevêque de Bologne, aujourd’hui Président de la Conférence épiscopale italienne, pour lequel François, le faisant cardinal en 2019, eut l’attention de créer un nouveau titre cardinalice… celui de l’église Sant ‘Egidio au Transtevere. Matteo Zuppi qui, au nom de cette ligne en quelque sorte libérale et fédérative, a pris récemment le risque d’ouvrir le pèlerinage Summorum Pontificum à Rome. Les cardinaux conservateurs, qui regardent le cardinal Zuppi avec des sentiments très mélangés, plaisantent : « Si Zuppi est pape, Riccardi sera le vrai Secrétaire d’État ». Raison de plus pour lire attentivement son livre. On ne sait jamais.
Abbé Claude Barthe
[1] Cerf, 2022, 328 p. 22€. Édition italienne : La Chiesa bruscia, Laterza, “Tempi nuovi”, 2021.