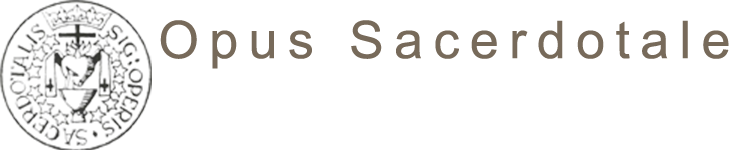Res novæ – septembre 2021 – Traditionis Custodes dernières cartouches conciliaires – Vatican II – le calvaire de l’Église
Traditionis custodes : les dernières cartouches conciliaires ?
La non-réception du concile Vatican II s’est concentrée de manière concrète sur le refus de la réforme liturgique, même si un certain nombre de pratiquants de la messe ancienne affirment leur adhésion aux intuitions conciliaires « bien interprétées ». En tout cas, l’existence de la liturgie traditionnelle est un phénomène persistant et même croissant de non-réception. Marginal ? Le pape Bergoglio, qui veut être le pape de la pleine réalisation de Vatican II, a fini par être convaincu que le phénomène était suffisamment important pour qu’il faille s’employer à l’éradiquer. Avec cette conséquence que le possiblement marginal est devenu certainement central : la messe tridentine est consacrée comme le mal à abattre ; les séminaires formant des prêtres pour la dire, comme des chancres à éliminer. Et ce, toutes affaires cessantes.
Un retour à la violence originelle de la réforme liturgique
Elle est donc de nouveau proscrite, comme sous Paul VI. La Lettre qui accompagne Traditionis custodes explique sans ambiguïté le but ultime du texte pontifical : faire en sorte « qu’on revienne à une forme de célébration unitaire », la liturgie nouvelle. La décision est brutale et péremptoire : le pape décide tant la fin de la messe traditionnelle que celle du monde traditionnel, qu’il accuse – et lui seul ! – d’attenter à l’unité de l’Église.
Vatican II, dont le grand dessein – une ouverture au monde moderne en sa modernité pour être mieux entendu des hommes de ce temps – est une sorte d’entre-deux entre orthodoxie traditionnelle et hétérodoxie (en l’espèce, un relativisme néo-moderniste). L’adoption de quelques propositions ambiguës permet, par exemple, d’affirmer qu’un chrétien séparé peut comme tel, comme séparé, être cependant en une certaine communion avec l’Église : selon Unitatis redintegratio, Luther, qui pensait avoir rompu avec l’Église du pape restait en réalité un catholique « imparfait » (UR 3).
Le pape François, depuis son élection, avance sur cette apparente ligne de crête aussi loin que possible : il transmue la collégialité en synodalité, dépasse Nostra ætate et la Journée d’Assise par la déclaration d’Abou Dhabi, mais il se garde de passer le seuil au-delà duquel on tomberait – ou on tomberait plus vite – dans ce néant où basculent déjà les plus audacieuses des théologies progressistes. Comme Paul VI, il reste fidèle au célibat ecclésiastique et au sacerdoce masculin, mais en contournant la discipline traditionnelle par la voie des ministères laïcs qu’avait ouverte le pape Montini (institution de ministres qui tiennent des rôles cléricaux sans être des clercs, pour arriver probablement au ministère de diaconesse voire de présidente d’eucharistie non formelle), et en confiant à des laïcs, hommes et femmes, des charges quasi-juridictionnelles (postes toujours plus élevés dans les dicastères romains).
Autrement dit, François conserve suffisamment d’institution, mais en continuant à la vider de sa substance doctrinale. Selon son expression, il abat les murs :
- Humanæ vitæ et un ensemble de textes dans la suite de cette encyclique avaient préservé la morale conjugale de la libéralisation que le Concile avait fait subir à l’ecclésiologie. Amoris lætitia a renversé cette digue : des personnes vivant dans l’adultère public peuvent y demeurer sans commettre de péché grave (AL 301).
- Summorum Pontificum avait reconnu un droit à ce conservatoire de l’Église d’avant qu’est la liturgie ancienne avec la catéchèse et le personnel clérical qui y sont attachés. Traditionis custodes a balayé cette tentative de « retour » : les nouveaux livres liturgiques sont la seule expression de la lex orandi du rite romain (TC, art. 1).
Il reste que le pape et ses conseillers ont pris de gros risques en prenant ces dispositions aussi violentes que hâtivement rédigées. Les commentateurs stupéfaits parlent de méconnaissance du terrain ecclésial occidental par le pape latino-américain ; ils soulignent le désaveu cinglant de l’œuvre majeure de Benoît XVI ; ils pointent du doigt les contradictions d’un gouvernement chaotique, qui écrase les traditionnels « de l’intérieur » alors qu’il accorde des facultés revenant à une semi-reconnaissance aux traditionnels « de l’extérieur », ceux de la FSSPX ; ils s’étonnent enfin, alors que le feu du schisme est en Allemagne et la tranquille hérésie partout, qu’on s’en prenne à une pratique liturgique innocente de l’un et de l’autre.
Mais on imagine que le pape et son entourage n’ont qu’un haussement d’épaule à l’énoncé de ces critiques. La justification de l’assaut répressif qu’ils ont déclenché est pour eux déterminante : la messe tridentine cristallise ainsi l’existence d’une Église dans l’Église car elle représente une lex orandi anté et donc anti-conciliaire. On peut transiger avec les dérives de l’Église Allemande qui sont au pire trop conciliaires, on ne saurait tolérer la liturgie ancienne qui est anti-conciliaire.
Vatican II avec ce qui en relève ne se discute pas ! De manière très caractéristique, la Lettre qui accompagne Traditionis custodes infaillibilise le Concile : la réforme liturgique découle de Vatican II ; or, ce concile a été un « exercice du pouvoir collégial de façon solennelle » ; douter que le Concile est inséré dans le dynamisme de la Tradition c’est donc « douter de l’Esprit-Saint lui-même qui guide l’Église ».
Une répression qui vient trop tard
Sauf qu’en 2021, on n’est plus en 1969, lors de la promulgation fraîche et joyeuse du nouveau missel, ni en 1985, lors de L’Entretien sur la foi et de l’assemblée du Synode qui faisait un bilan déjà inquiet des fruits de Vatican II, ni même en 2005, où l’apparition de l’expression d’« herméneutique de réforme dans la continuité » ressemblait fort à une tentative de recomposition laborieuse d’une réalité qui échappait de plus en plus. Aujourd’hui, il est trop tard.
L’institution ecclésiale est comme énervée, la mission éteinte et, en Occident au moins, la visibilité en prêtres et fidèles évanouie. Andrea Riccardi, personnage principal de la Communauté de Sant‘Egidio, tout le contraire d’un conservateur, dans son dernier livre, La Chiesa brucia. Crise e futuro del cristianesimo, L’Église brûle. Crise et futur du christianisme[1], considère l’incendie de Notre-Dame de Paris comme une parabole de la situation du catholicisme, et analyse pays par pays, en Europe, son effondrement. Son discours est caractéristique de celui des bergogliens déçus, qui deviennent des conciliaires déçus.
Comment s’étonner que des auteurs, bien plus dégagés que lui de l’appareil ecclésiastique, lancent des cris d’alarmes et n’hésitent pas à dire d’où vient le mal. Ainsi l’académicien Jean-Marie Rouart dans Ce pays des hommes sans Dieu[2], qui pense que la bataille de la société occidentale devant l’islam est perdue d’avance, alors que seul pourrait nous sauver un « sursaut chrétien », c’est-à-dire une radicale marche arrière : l’Église, écrit-il, « doit procéder à l’équivalent d’une Contre-Réforme, revenir à cette réforme chrétienne qui lui a permis au XVIIe siècle d’affronter victorieusement un protestantisme qui la mettait en cause »[3]. Ou encore Patrick Buisson dans La fin d’un monde[4], qui consacre deux parties de son gros ouvrage à la situation du catholicisme : « Le krach de la foi » et « Le sacré massacré ». « De façon à la fois déconcertante et brutale, écrit-il, le rite tridentin, qui avait été le rite officiel de l’Église latine depuis quatre siècles, fut, du jour au lendemain, décrété indésirable, sa célébration proscrite et ses fidèles pourchassés[5] ». On est sorti du catholicisme pour aller « à la religion conciliaire ».
Qui plus est, en 2021, le rapport de force est très différent de celui des années 1970 entre ceux qui avaient « fait le Concile » et ceux qui le subissaient. Andrea Riccardi fait comme tout un chacun ce constat réaliste : « Le traditionalisme est une réalité de quelque importance dans l’Église, aussi bien dans l’organisation que dans les moyens ». Le monde traditionnel pour être minoritaire (en France, 8 à 10% des pratiquants) est partout en croissance, notamment aux États-Unis. Il est jeune, fécond en vocations – au moins par rapport à la fécondité du catholicisme des paroisses –, capable d’assurer la transmission catéchétique, attirant pour le jeune clergé et pour les séminaristes diocésains.
C’est d’ailleurs ce que le pape Bergoglio, arrivant d’Argentine, a mis du temps à comprendre, jusqu’à ce que les évêques italiens et les prélats de la Curie lui aient mis sous les yeux l’accroissement insupportable du monde traditionnel, d’autant plus visible qu’il se produit au sein de l’effondrement général. Il fallait donc appliquer les « remèdes » adéquats, les mêmes qu’on a administré au séminaire florissant de San Rafael, en Argentine, à la congrégation des Franciscains de l’Immaculée, au diocèse d’Albenga en Italie, au diocèse de San Luis en Argentine, etc.
Pour une sortie « en avant » de la crise
Pour autant, l’Église conciliaire n’est pas revitalisée et la mission n’a cessé de s’étioler. Une batterie de documents ont traité de la mission : Ad Gentes, le décret conciliaire de 1965, l’exhortation Evangelii nuntiandi de 1975, l’encyclique Redemptoris missio de 1990, le document Dialogue et Annonce de 1991, les exhortations apostoliques qui reprennent inlassablement le thème de la nouvelle évangélisation, Ecclesia in Africa, 1995, Ecclesia in America, 1999, Ecclesia in Asia, 1999, Ecclesia in Oceania, 2001, Ecclesia in Europa, 2003. Un Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Évangélisation a été créé. Les colloques se sont multipliés parlant de la mission qui doit s’articuler au dialogue, de l’évangélisation qui ne doit pas être prosélytisme, etc. Jamais on n’a autant parlé de mission. Jamais on n’a aussi peu converti.
François Mitterrand disait à propos de la résorption du chômage, « on a tout essayé ». De même pour sauver l’Église d’après Vatican II : la tentative qu’a représentée l’élection du pape Bergoglio, celle d’une maximalisation du Concile, a fait long feu ; comme avait finalement échoué, il faut le reconnaître, la tentative qu’avait représentée l’élection du pape Ratzinger, celle d’un assagissement du Concile. Alors, un retour en arrière ? Oui, mais à la manière d’une sortie « en avant ».
Nombreux sont ceux, y compris parmi les soutiens d’hier au pape Bergoglio, qui jugent indéfendable la répression brutale du monde traditionnel, pour la seule raison, en définitive, qu’il est trop vivant. Peut-on imaginer, avec un prochain pontificat, une mise entre parenthèses de Traditionis custodes ?Assurément, et même mieux, nous semble-t-il : une liberté donnée à ce qu’il est convenu d’appeler les « forces vives » dans l’Église. Concernant cette force essentielle, puisqu’elle représente la tradition multiséculaire, on peut raisonnablement envisager la négociation d’un compromis qui serait plus favorable pour l’Église que n’a été le compromis de Summorum Pontificum. Il faut viser désormais une levée de tout encadrement, autrement dit une franche liberté pour la liturgie ancienne et pour tout ce qui va avec elle. Et ceci, au nom du bon sens. De même qu’un certain nombre d’évêques dans le monde ont laissé se développer dans leurs diocèses toutes ces « forces vives », les communautés, fondations, œuvres, qui portent des fruits missionnaires, de même, au niveau de l’Église universelle, doit venir le temps de la liberté laissée à tout « ce qui marche ».
Summorum Pontificum peut s’analyser comme une tentative de coexistence des catholiques qui ne reçoivent pas la liturgie de Vatican II avec un monde conciliaire modéré. Une nouvelle tentative pourrait s’établir avec un monde conciliaire apparemment plus « libéral » que celui de Benoît XVI, mais qui prend désormais conscience de l’échec irrémédiable de l’utopie embrassée il y a cinquante ans.
Abbé Claude Barthe
[1] Tempi nuovi, 2021.
[2] Bouquins, 2021.
[3] Op. cit, p. 64.
[4] Albin Michel, 2021.
[5] Op. cit., « La trivialiation du sacré », p. 124.
Vatican II et le Calvaire de l’Église
Récemment, le débat sur l’interprétation correcte du Concile Vatican II a été ranimé. Il est vrai que chaque concile pose des problèmes d’explicitation et en suscite très souvent de nouveaux au lieu de résoudre les précédents. Le mystère comporte toujours une tension entre ce qui est dit et ce qui est indicible. Il suffit de rappeler que la consubstantialité du Fils avec le Père qui fut affirmée contre Arius par le concile de Nicée (325) ne fut nettement déclarée que soixante ans plus tard avec le concile de Constantinople (381), lorsque la divinité du Saint-Esprit a également été définie. À notre époque, environ soixante ans après le Concile Vatican II, nous n’avons pas vu de clarification de la doctrine de la foi, mais son obscurcissement grandissant. La Déclaration d’Abu Dhabi (4 février 2019) prétend établir avec une certitude absolue que Dieu veut la pluralité des religions de la même manière qu’Il veut la diversité de couleurs, de sexes, de races et de langues. Comme l’a dit le Pape François sur le vol de retour après la signature de ce document: « Du point de vue catholique, ce document n’a pas dépassé d’un millimètre le Concile Vatican II. » Il y a plutôt un lien « symbolique » avec « l’esprit du Concile » dont se fait l’écho le texte de la « Déclaration sur la fraternité humaine ». Et pourtant, c’est bien un lien, et ce n’est certainement pas le seul qui existe entre Vatican II et l’Église d’aujourd’hui. Ce qui montre qu’entre le concile de Nicée et Vatican II il y a une différence qui doit être prise en considération.
Cet étrange concile, qu’il faut toujours interpréter
L’herméneutique de la continuité et de la réforme nous a donné l’espoir de pouvoir lire le nouvel enseignement de Vatican II en continuité avec le magistère précédent, au nom du principe de base de tout concile, que s’il se déroule selon les exigences canoniques, il est assisté par le Saint-Esprit. Ainsi, si l’orthodoxie n’est pas immédiatement perceptible, on la recherche. En attendant, cependant, il y a déjà ici un problème qui n’est nullement secondaire. Avoir besoin d’herméneutique pour résoudre le problème de la continuité est déjà un problème en soi. In claris non fit interpretatio, dit un adage bien connu, qui fait que c’est parce que la continuité a besoin d’être démontrée par l’interprétation, qu’il faut une herméneutique. Dans l’état actuel des choses, la continuité [de Vatican II avec la Tradition] n’est pas évidente mais doit être démontrée ou plutôt interprétée. Dès qu’on a recours à une herméneutique, on entre dans un processus toujours croissant d’interprétation dans la continuité, un processus qui, une fois engagé, ne s’arrête pas. Tant qu’il y aura des interprétations, il y aura un processus d’interprétation sans fin, et il y aura donc la possibilité que toute interprétation puisse être confirmée ou niée parce qu’elle apparaît adéquate ou préjudiciable aux yeux de l’interprète suivant.
L’herméneutique est un processus interminable; tel est celui de la modernité qui pose l’homme comme existant et l’enferme dans les limites de son existence présente, ici et maintenant. Cela se voit dans le Concile, qui essaie de dialoguer avec le monde moderne, qui à son tour implique lui-même un processus existentiel difficile à résoudre dans les cercles herméneutiques. Si nous nous appuyons sur l’herméneutique seule pour résoudre le problème de la continuité, nous courons le risque de nous enfermer dans un système qui suppose la continuité (ou, au contraire, la rupture) mais qui en fait ne réussit pas à la trouver. Et il ne semble pas que nous l’ayons trouvée du tout aujourd’hui, près de soixante ans après Vatican II.
Il y a besoin non d’une herméneutique qui nous garantisse la continuité, mais d’un premier principe qui nous dise si l’herméneutique utilisée est valide ou non: ce principe est la Foi de l’Église. Il n’est pas étonnant qu’à une telle distance de Vatican II, nous discutions encore selon l’herméneutique de la continuité, sur la continuité d’un concile avec les précédents et avec la Foi de l’Église, alors que la Foi elle-même nous a quittés depuis déjà de nombreuses années et ne montre aucun signe de retour.
Depuis qu’elle a été proposée, l’herméneutique de la continuité semblait avoir quelques failles; récemment, il semble que même Joseph Ratzinger s’en soit quelque peu éloigné. Dans ses notes relatives aux causes des abus sexuels dans l’Église (publiées seulement en italien dans le Corriere della sera, le 11 avril 2019), le Concile Vatican II est à plusieurs reprises remis en question. Avec plus de liberté théologique et non plus à titre officiel, Benoît XVI désigne une sorte de biblicisme qui a son origine dans Dei Verbum comme la principale source doctrinale de la crise morale de l’Église. Dans la lutte engagée lors du Concile, on a tenté de se libérer du fondement naturel de la loi morale afin de fonder la morale exclusivement sur la Bible. L’influence de la Constitution sur la Révélation divine, qui n’a pas voulu évoquer le rôle de la Traditio constitutiva, même si Paul VI a contrôlé sa rédaction, se retrouve dans la formulation du décret Optatam Totius 16 [sur la formation sacerdotale], qui a en fait été rejeté par la suite parce qu’on soupçonnait que sa moralité était trop « préconciliaire », et qualifiée avec mépris de « trop scolaire » parce qu’elle reposait sur la loi naturelle. Les effets néfastes d’un tel « repositionnement » n’ont pas tardé à se faire sentir et sont toujours sous nos yeux étonnés. Dans les mêmes notes de Ratzinger, on lit aussi une dénonciation de la prétendue « conciliarité » qui était devenue le critère déterminant de ce qui était vraiment acceptable et admissible, au point même d’amener certains évêques à réfuter la Tradition Catholique. Dans les différents documents postconciliaires qui cherchaient à corriger cette tendance, en fournissant une interprétation correcte de la doctrine, on n’a jamais sérieusement examiné le problème de théologie fondamentale inauguré par le principe de « conciliarité ». En fait, la « conciliarité » est la porte ouverte à tous les autres abus, et à un esprit qui brode librement autour du texte et s’en détache, et qui se détache surtout de l’Église. On en a parlé lors du Synode des évêques de 1985, mais cette discussion n’a pas abouti à une déclaration claire qui la réfute.
Des doctrines nouvelles, mais « pastorales »
Le problème herméneutique de Vatican II ne s’arrêtera jamais si nous n’affrontons pas une question centrale et radicale dont dépend la compréhension claire des doctrines et leur interprétation magistrale. Vatican II s’est présenté comme un concile ayant un but admirablement pastoral. Mais bien sûr, tous les conciles précédents étaient pastoraux dans la mesure où ils affirmaient la vérité de la Foi et luttaient contre des erreurs. Vatican II a choisi une nouvelle méthode pour ce but pastoral: la « méthode pastorale » qui est devenue un véritable programme d’action. Dans des déclarations répétées, mais sans jamais donner de définition de ce que l’on entend par « pastoral », Vatican II s’est présenté différemment des autres conciles. C’est le « concile pastoral » qui, plus que tout autre concile, a proposé de nouvelles doctrines, mais n’a choisi ni de définir de nouveaux dogmes ni de réitérer aucun dogme de manière définitive (sauf peut-être la nature sacramentelle de l’épiscopat, mais là-dessus il n’y a pas d’unanimité). La « pastoralité » prévoyait l’absence de condamnations et de définition de la Foi, offrant à la place une « nouvelle façon » de l’enseigner pour le temps présent: une « nouvelle façon » qui a influencé la formation de nouvelles doctrines et vice-versa. Ce défaut se fait encore sentir avec toute sa virulence aujourd’hui quand on préfère laisser la doctrine de côté pour des motifs pastoraux, ce qui pourtant ne peut se faire sans enseigner en fait une autre doctrine.
La « méthode pastorale » (et c’était vraiment une méthode) a joué un rôle de premier ordre dans le Concile. Elle a dirigé l’ordre du jour conciliaire. Elle a établi ce qui devait être débattu, et a dirigé la reformulation de plusieurs schémas centraux parce qu’ils étaient prétendus « non pastoraux ». Cela a conduit à négliger des doctrines très répandues parce qu’elles étaient encore contestées (comme par exemple celles des limbes et l’insuffisance matérielle des Écritures, répétées par le magistère ordinaire des catéchismes) et à embrasser l’enseignement de « nouvelles doctrines » qui n’avaient été débattues théologiquement d’aucune manière (comme par exemple la collégialité épiscopale et la restauration du diaconat permanent d’hommes mariés). En effet, la « pastorale » s’est élevée au rang de constitution avec Gaudium et Spes (nous étions habitués à des constitutions seulement sur la foi), un document si pitoyable qu’il a même fait dresser les cheveux de Karl Rahner, qui a conseillé au cardinal Döpfner de déclarer, dès le début, l’imperfection du texte, principalement en raison du fait que l’ordre créé ne semblait pas avoir Dieu pour sa fin. Et pourtant, Rahner était le promoteur d’un accompagnement pastoral « transcendantal ».
Ainsi, le Concile a posé en lui-même un problème d’interprétation qui n’a pas commencé par une interprétation fausse avec la réception d’après le Concile, mais dès les discussions dans l’aula conciliaire. Comprendre le degré de signification théologique des doctrines conciliaires n’a pas été facile même pour les Pères conciliaires eux-mêmes, qui ont demandé à maintes reprises des éclaircissements au Secrétariat du Concile. La « pastoralité » est alors également entrée dans la rédaction du nouveau schéma sur l’Église. Pour de nombreux Pères conciliaires, le mystère de l’Église (dans son aspect invisible) ne se bornait pas à sa manifestation historique et hiérarchique (son aspect visible), au point qu’ils posaient la non-coextensivité du Corps mystique du Christ avec l’Église catholique romaine. Y avait-il deux Églises juxtaposées? Une « Église du Christ » d’un côté et « l’Église Catholique » de l’autre? Ce risque ne provenait pas du flou verbal du « subsistit in » mais, fondamentalement du renoncement à la doctrine des membres de l’Église (en passant du de membris au de populo) afin de ne pas offenser les Protestants, membres imparfaits. Aujourd’hui, il semble que presque tout le monde appartient à l’Église. Si nous devions poser la question « Est-ce que les Pères conciliaires soutenaient que le Corps mystique du Christ est l’Église Catholique? », comment la plupart des gens répondraient-ils? De nombreux Pères du Concile ont dit non, et c’est pourquoi nous sommes arrivés là.
L’esprit du Concile, règle relative d’une mesure absolue
« L’esprit du Concile » est ainsi né au sein même du Concile. Il plane sur Vatican II et ses textes; c’est souvent le reflet d’un « esprit pastoral » qui n’est pas clairement définissable, qui construit ou démolit au nom de la « conciliarité », qui signifiait souvent simplement le sentiment théologique du moment, celui qui avait le plus de prise parce que la voix de celui qui parlait était la plus forte, non seulement dans la presse mais aussi dans l’aula du concile et dans la Commission doctrinale. Une herméneutique qui ne comprend pas cette question fondamentale finit par être dépassée par un problème qui n’est toujours pas résolu aujourd’hui: Vatican II est traité comme un « absolu » de la Foi, comme si c’était l’identité même du chrétien, comme le passe-partout dans l’Église « post-conciliaire ». L’Église est divisée parce qu’elle dépend du Concile et non l’inverse. Cela entraîne à son tour un autre problème.
D’abord le Concile considéré comme autorité absolue de la Foi, puis le Pape comme autorité absolue de l’Église, sont en fait les deux faces d’une même médaille ; c’est la même erreur d’absolutiser d’abord l’un puis l’autre, en oubliant que l’Église vient en premier, puis le Pape et son magistère pontifical, puis le Concile et son magistère conciliaire. L’erreur actuelle de considérer le pape comme un maître absolu résulte de l’idée que le concile soit ab-solutus et cela est dû au fait que « l’esprit du Concile », l’esprit d’un « événement » qui était supérieur aux textes et surtout au contexte, a été présenté comme le critère déterminant qui sert de règle de mesure. Est-ce une coïncidence si ceux qui cherchent à imposer le magistère de François font appel continuellement à Vatican II, accusant quiconque critique François de rejeter Vatican II? Le fait est que le lien entre François et Vatican II est plus un lien symbolique, dans l’esprit, plutôt que dans la lettre. Les papes du Concile et de l’après-concile sont des saints (ou le seront rapidement) tandis que l’Église languit, plongée dans un désert silencieux.
Serafino M. Lanzetta