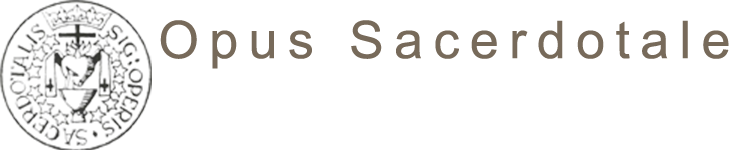Le sacre des rois de France – résumé de Patrick Demouy par M. l’Abbé Cyrille Debris
Le sacre des rois de France
Pour écouter l’exposé, cliquez ici
Résumé du livre Patrick Demouy, Le sacre du roi, éd. La nuée bleue, Strasbourg, 2016.
En France, la république n’a qu’une histoire récente de seulement 150 ans depuis son installation en 1870 (sans parler de la majorité monarchique qui préluda au septennat jusqu’en 1875 et de l’État français). Les deux précédentes tentatives se soldèrent par des échecs sanglants établissant un empire napoléonien (1792-1799 et 1848-1851) qui réduit encore la durée (1848-51). Par contre, à partir de Pépin le Bref en 751 jusqu’à Charles X en 1825, 76 sacres furent organisés en France, dont 30 reines. Pour moitié ils se déroulèrent à Reims, les autres se partagèrent entre Saint-Denis, Paris, Soissons, Compiègne etc… Bien que le baptême de Clovis en 496 fût le modèle du sacre, le premier véritable remonte à 751 et fut utilisé par les Carolingiens pour renforcer l’élection d’un nouveau roi : Pépin le Bref qui n’est pas du sang fondateur de Clovis. Il avait préparé l’opinion et son argument était « est indigne de régner un roi qui ne fait rien », autrement dit un roi fainéant (fait néant), ce qui colla à la mémoire des derniers mérovingiens. Il fallait pour cette rupture de la fidélité due au roi une caution du pape, une absolution préventive. Le pape Zacharie fut sondé par Fulrad, abbé de Saint-Denis et Burchard, évêque de Wurzbourg. La réforme de l’Église, les largesses aux monastères, la parenté sainte (saintes abbesses et saint évêque Arnoul de Metz) l’incitèrent spirituellement à aller en ce sens, ainsi que la menace lombarde et l’impossibilité d’être protégé par son suzerain officiel, Constantin V, un empereur byzantin iconoclaste. « Mieux valait appeler roi celui qui avait la potestas royale que celui qui restait sans potestas royale ; pour ne pas perturber l’ordre, il ordonna de par l’autorité apostolique que l’on fît roi Pépin ». L’Auctoritas vint au secours de la potestas. Il ne restait plus qu’à être élu par les grands, ce qui advint à Soissons en novembre 751. Childéric III, tonsuré, fut relégué à Saint-Bertin de Saint-Omer et son fils Thierry à Fontenelle (= Saint-Wandrille). Pépin reçut aussitôt après l’élection l’onction du saint-chrême des évêques présents. Auparavant, les mérovingiens s’imposaient comme chefs de guerre, illustrée par leur chevelure longue (d’où la tonsure !) et élevés sur le pavois puis le trône, acclamés mais sans que les clercs n’investissent ce rituel guerrier.
La sainte ampoule
Sources manuscrites
Un certain silence entoure les origines de la sainte ampoule. Les sources les plus anciennes sur le baptême de Clovis (lettre de saint Avit et récit de Grégoire de Tours) ne la mentionnent pas. Mais Hincmar écrivit bien plus tard dans sa Vie de saint Remi : « Comme ils étaient arrivés au baptistère, le clerc qui portait le chrême se trouva empêché d’avancer par le peuple, au point qu’il ne pouvait parvenir jusqu’à la cuve. C’était la volonté divine que le chrême fît défaut pour la sanctification de la cuve. Et parce qu’à cause de la foule amassée, le saint évêque ne pouvait plus ni entrer ni sortir de l’église, il leva les yeux au Ciel, tendit les mains et se mit à prier en silence en versant des larmes. Et voilà que tout à coup, une colombe plus blanche que neige apporta dans son bec une petite ampoule remplie de saint chrême dont l’odeur étonnante, bien supérieure à tous les parfums qu’on avait pu sentir dans le baptistère, combla tous ceux qui étaient présents de son incomparable douceur. Le saint évêque prit donc cette petite ampoule et la colombe, ou plutôt ce qui avait la forme d’une colombe, disparut »[1]. La plus ancienne représentation, au musée de Picardie à Amiens, est justement une reliure du IXe s. en ivoire de cet ouvrage de l’archevêque.
Les allusions bibliques sont transparentes, à la fois au baptême de Jésus avec la théophanie du Saint-Esprit sous forme de colombe, l’élection du Fils bien-aimé mais aussi à la foule empêchant le pécheur d’accéder à Jésus avec une solution par le ciel (le toit avec le paralytique). Mais plus rien ne transparut sinon quelques reprises d’Hincmar.
Usages dans la liturgie du sacre
Ce n’est qu’en 1131, que l’huile miraculeuse fut utilisée d’après la Chronique de Morigny au sacre de Louis VII par le pape Étienne II qui avait convoqué à Reims un concile général (13 archevêques et 236 évêques) lui donnant une audience toute particulière. Ce roi, père de Philippe II Auguste, enrichit le sacre avec le quasi-adoubement, l’intervention des pairs. Mais il développa surtout la mystique royale (« religion royale » de Jacques Le Goff) avec le lys et la sainte ampoule car il insistait sur la quasi-égalité entre rois et prêtres consacrés à Dieu.
L’ampoule d’avant la révolution était extrêmement modeste en verre ou cristal, de la grosseur d’une figue (4,2 cm de haut, 1,6 cm de large au col et 2,9 cm au fond), avec une liqueur tannée un peu transparente d’après la description de dom Guillaume Marlot en 1630 dans Le théâtre d’honneur et de magnificence préparé au sacre des rois. Contrairement à Froissard, la quantité de ce « fin baume congelé » à l’exquise odeur, diminue (un tiers du flacon vide à cette date). L’archevêque n’en prenait par une aiguille en or qu’une infime partie, de la grosseur d’un grain de froment. L’ordo de saint Louis vers 1230 évoque « la sacro-sainte ampoule » apportée par le Père Abbé de Saint-Remi (célèbre abbaye de Reims) à la cathédrale.
Il est possible que cet objet, très similaire aux fioles à parfums trouvées dans les tombes gallo-romaines, fût trouvé lors d’une translation des os de saint Remi opérée par Hincmar le 1er octobre 852. Toutefois, il ne le mentionna pas, ce qui fragilise l’hypothèse (Francis Oppenheimer). Mais elle était bien conservée dans son tombeau par les moines. Une autre hypothèse (Jean-Jacques Chifflet, Marc Bloch) mentionne les colombes métalliques placées dans les baptistères avec une fiole dans un bec pour évoquer l’effusion au baptême du Christ (certaines servaient même de tabernacle suspendu au XIIIe s. mais aussi pour les saintes huiles).
Quoi qu’il en soit, cette sainte ampoule existe et sa simplicité fut rehaussée par un reliquaire à la fin du XIIe s. : une sorte d’assiette d’argent doré semée de pierreries avec une chaîne en argent pour être portée autour du cou par le père abbé en chape (ou grand prieur avec la commende). Elle enserrait un rectangle de cristal sous lequel l’ampoule était portée par une colombe de 8,5 cm. L’aiguille et la patène pour le mélange avec le saint-chrême de l’année étaient détachables sur l’autel. La procession se faisait de Saint-Remi à la cathédrale sous un dais porté par 4 moines (à pied puis en haquenée blanche), avec escorte de 4 chevaliers otages prêts à mourir pour la défendre. Les vassaux de l’abbaye et le peuple de ses domaines (dont les habitants du village ardennais du Chesne le Populeux qui en étaient très jaloux). L’archevêque jurait de rendre ce bien précieux à l’issue de la cérémonie. Elle ne quitta Reims qu’en 1483 car Louis XI qui nourrissait une grande dévotion à son endroit et qui se mourait à Plessis-les-Tours voulut la vénérer une dernière fois.
Sauvée du vandalisme révolutionnaire et disponible…
Le 7 octobre 1793, le conventionnel Philippe Rühl, fils de pasteur luthérien, la profana : « j’ai brisé en présence des autorités constituées, et d’un peuple nombreux, sous les acclamations répétées de ‘Vive la République une et indivisible !’, le monument honteux créé par la ruse perfide du sacerdoce pour mieux servir les desseins ambitieux du trône. En un mot, j’ai brisé la sainte ampoule, ce hochet sacré des sots, cet instrument dangereux dans les mains des satellites du despotisme a disparu ». « Il ne restait aucun liquide ». La brute vandale ignorait que la veille, le curé de l’ancienne abbatiale devenue église paroissiale saint-Remi, Jules-Armand Seraine, bien que jureur, eût retiré en présence de quelques ouailles, dans la sacristie, la plus grande quantité possible de substance rougeâtre. Le 11 juin 1819, les parcelles de baume sauvées furent replacées dans un coffret en fer-blanc, déposé dans le tombeau du saint. Le nouveau reliquaire commandé par Louis XVIII à Jean-Charles Cahier fut achevé en août 1823. Pour préparer le sacre de Charles X le 29 mai 1825, une semaine avant fut remis le reste de baume et les esquilles de l’ampoule précieusement gardées par les spectateurs de la profanation et broyées et mélangées avec le saint-chrême de l’année.

Le 7 décembre 1906, l’archevêque, futur cardinal, Mgr Louis-Joseph Luçon, 10 jours avant son expulsion du palais du Tau par les lois de séparation de 1905, transféra tout le contenu dans un flacon de verre (8,6 cm x 2,2) bouché à l’émeri et cacheté. Quelques parcelles furent prélevées pour la consécration après les bombardements du maître-autel le 18 octobre 1937 et le reste attend à l’archevêché le prochain roi…
Le roi thaumaturge
D’une croyance ancienne…
Les connaissances renouvelées depuis Marc Bloch par Jean-Pierre Poly ont montré que le fond de l’histoire n’est pas chrétien ni capétien mais fut christianisé progressivement. Les royautés germaniques ou celtiques attribuaient des pouvoirs au roi comme guérisseur. 3 filons narratifs et historiques s’entremêlent.
Flodoard rapporte que le roi Louis IV d’Outremer mourut à la fin de l’été 954. Ayant quitté Laon vers Reims après avoir franchi l’Aisne, crut voir une espèce de loup (quasi lupus) qu’il poursuivit. Il chuta, fut emporté à Reims, y mourut d’éléphantiasis. Or, cette maladie ganglionnaire est confondue avec la tuberculose ganglionnaire appelée écrouelles ou scrofule (le visage tuméfié rendait semblable aux truies : scrofa en latin). On l’associe aussi au lupus, considéré autrefois comme une tuberculose de la peau. Le loup de cette histoire apparaît comme un agent du châtiment divin puisque Louis IV avait usurpé en 938 le domaine de Corbeny que sa belle-mère, la reine Frérone, première épouse de Charles le Simple, avait légué en 917 à l’abbaye Saint-Remi. Il ordonna à son fils sur son lit de mort de le restituer. Mais le « mal du roi », la malédiction du loup, ne cessa pas si vite pour autant. En 986 son fils Lothaire expira par une « peste » aux ganglions de l’aine et son petit-fils Louis V tomba de cheval en 987.
Les moines de Saint-Remi établirent à Corbeny un prieuré dédié à Saint-Marcoul, missionnaire de Basse-Normandie du VIe s. car ses reliques avaient été déplacées là face aux invasions normandes vers 890. Certains y voient un personnage fabuleux : le magicien Marcolf, compagnon du roi Salomon ou l’Anglo-Saxon Marcwulf (loup de la marche : chiens des dieux païens). Saint Marcoul soignait les morsures de loup et le mal royal.
Enfin, Arnoul, ancien chevalier, vivait reclus après la mort de son seigneur le comte de Flandre. Ce colosse avait fait vœu de renoncer aux armes. Les moines de Saint-Médard de Soissons voulurent en faire leur abbé, attirés par sa réputation de sainteté. Il voulut fuir en direction de Laon où il rencontra un énorme loup gris qui chemina à côté de lui jusqu’à Soissons où il accepta finalement l’abbatiat puis l’épiscopat. Il joua un rôle privilégié dans la naissance de Louis VI car Berthe de Hollande, la femme de Philippe Ier, lui avait demandé de prier pour un garçon alors qu’elle ne concevait pas. Vers 1120, ce même Louis VI est réputé soigner des écrouelles par l’abbé Guibert de Nogent-sous-Coucy (à une quarantaine de km de Corbeny). Son père Philippe avait perdu ce pouvoir après avoir été excommunié pour avoir répudié Berthe au profit de Bertrade de Montfort (double adultère). Le premier Louis (VI) des Capétiens rachetait la faute du dernier Louis (IV) carolingien.
…au roi très chrétien thaumaturge
L’Église christianisa ses croyances et les attribua à Saint Marcoul. Le premier roi à faire le pèlerinage de Saint Marcoul à Corbeny était Louis X (le Hutin), fils de Philippe le Bel, en 1315. À partir de Louis XIV, ce furent les reliques qui furent amenées au roi à Reims.
Le roi touchait généralement les écrouelles le surlendemain du sacre en faisant un signe de la croix sur les plaies, accompagné de la formule : « le roi te touche, Dieu te guérit ». Mais les occasions se multiplièrent. Sous saint Louis, le toucher des écrouelles survenait chaque semaine, ce qui impliquait une confession d’autant plus fréquente. En 1528, François Ier toucha au moins 1.326 malades ; 988 en 1529 et 1.731 en 1530. Charles IX battit un record en 1569 avec 2.092 scrofuleux. Bien qu’Henri IV fût sacré à Chartres (avec une huile miraculeuse remise à saint Martin) puisque la Sainte Ligue tenait Reims, les Bourbons demeurèrent fidèles au rite mais surtout aux quatre grandes fêtes de Pâques, Pentecôte, Toussaint et Noël. Mais Louis XIII et Louis XIV y ajoutèrent la Chandeleur, Trinité, Assomption avec toujours autant d’affluence. On placardait à Paris au son de trompettes. C’était très éprouvant pour le roi mais un devoir pour lui. Louis XIV dut reporter à Pâques 1698 à cause d’une crise de goutte : à la Pentecôte, il toucha près de 3.000 scrofuleux ! Aux portes de la mort, il tint encore le 8 juin 1715 à toucher 1.700 malades malgré la chaleur.
Louis XV transposa au subjonctif « le roi te touche, Dieu te guérisse », comme s’il n’y croyait plus vraiment (alors que même son aïeul Henri IV en fut impressionné !) au contraire de la foule car plus de 2.000 malades se pressaient au lendemain de son sacre, le lundi 26 octobre 1722. Il faut dire aussi que ses écarts de conduite matrimoniaux l’empêchaient d’être absous, de communier et donc de toucher les écrouelles car les malades n’étaient guéris que quand le roi était en état de grâce. Il ne communia pas à Pâques 1739 et 1740, à Noël 1744. Les philosophes comme Montesquieu et Voltaire persiflaient. Mais Louis XVI maintint l’usage le lundi 12 juin 1775. Le duc de Croÿ rapporte : « À cause de la chaleur, cela puait et était d’une infection très marquée de sorte qu’il fallait bon courage et force au roi pour faire toute cette cérémonie que je n’aurais pas crue sans l’avoir vue si répugnante. La foi de ces bonnes gens était bien remarquable : ils étaient à genoux, les mains jointes, avec un air de foi et de confiance vive et réellement touchante, de sorte que, ne fût-ce que par l’extrême résolution que cela leur fait, je ne serais pas étonné que plusieurs aient été guéris ». De fait, sur les 2.400 scrofuleux présents, 1 adulte et 4 enfants furent guéris ce jour-là. Le roi se lavait les mains plusieurs fois dans de l’eau vinaigrée, de l’eau de rose et enfin de l’eau bénite. Certains malades emportaient cette eau pour la boire en neuvaine.
Charles X en 1825 hésita, par respect humain, craignant de « fournir un prétexte aux dérisions de l’incrédulité » mais toucha finalement 121 malades dont 5 enfants guérirent. Il ne reproduisit pas ce geste. Les rois eux-mêmes avaient cessé d’y croire.
La cérémonie
Une grande fête mais coûteuse
La cérémonie se passait avec grand concours de peuple. La population de Reims, passée de 12.000 à 28.000 personnes entre les XIIIe et XVIIIe siècles se démultipliait, pour une telle réjouissance populaire. Pour Louis XV, la cavalcade du lendemain aurait réuni dans les 100.000 personnes puisque les tableaux de Pierre-Denis Martin montre des toits démontés pour y asseoir des spectateurs !
Les comptes du XIVe s. font entrevoir une suite d’environ 2.000 personnes (barons et serviteurs) et cela augmenta. Le vassal devant le droit de gîte, l’archevêque payait en général deux nuits et deux repas. Il accueillait au palais du Tau la famille royale et les notables recevaient la cour. En 1223, il dépensa 4.000 £ sur 7.000 £ de revenu annuel. En 1315, cela avait déjà plus que doublé avec 8.800 £ à cause de malversations de fonctionnaires royaux. Si bien que les bourgeois rémois prirent les choses en main. Principal seigneur de la ville dont il avait acquis les droits comtaux, l’archevêque pouvait tailler ses sujets mais les bourgeois râlaient de l’injustice car suivant les quartiers, le seigneur différait (abbaye Saint-Remi, chapitre cathédral). À cette époque, cela représentait 3,3 à 4,5% du capital de ces bourgeois. Mais avec l’inflation du nombre de sacres (4 en quatorze ans de 1315 et 1328) des rois maudits issus de Philippe IV le Bel et l’extinction des Capétiens directs passant aux Valois, cela atteignit 42.000 £ soit 16 à 17% du capital !
40% à 50% passait dans la cuisine, 12 à 14% dans l’échansonnerie (vins : 60.000 l. pour Philippe VI avec fontaine du cerf dans la cour du palais du Tau). Aux alentours de la révolution, le faste des décorations et les frais de déplacement fit qu’on atteignit des sommets : 7 Mio. £ pour Louis XVI (budget annuel de l’État de 600 Mio : 1,2%) et 8 Mio pour Charles X (sur 1 Md : 0,8%).
Le roi dort
Le sacre était normalement fixé un dimanche ou jour de fête solennelle (Ascension, Assomption, Toussaint). Le roi arrivait la veille et faisait sa « joyeuse entrée » depuis l’Ouest. Une députation lui apportait les clés de la ville, des spécialités, discours et tableaux vivants, arcs de triomphe, rues pavoisées de tapisseries et fleurs. Procession des religieux et chanoines au-devant du roi mais l’archevêque attendait à sa cathédrale où il lui tendait l’eau bénite (comme pour l’accueil d’un évêque par son curé). Il se recueillait au chœur puis assistait éventuellement aux vêpres. Il dînait au palais avant de veiller une partie de la nuit, comme pour la vigile de l’adoubement des chevaliers. Il devait se préparer à son ministère, se pénétrer de ses devoirs, demander pardon de ses péchés. Il se confessait. L’absolution était reportée à la communion du lendemain pour qu’il fût immaculé.
Il se reposait quelques heures. À la pointe du jour (les chanoines chantant prime), il se levait. À partir de 1365 et Charles V le Sage, deux pairs ecclésiastiques, les évêques de Laon et Beauvais portant les reliques au col, accompagnés de clercs portant croix, cierges et encensoirs, venaient quérir le roi dans sa chambre (usage germanique et anglais). Cela rappelait le chevalier qui était purifié par un bain avant son adoubement et où le lit faisait office de serviette cérémonielle pour le sécher, les évêques le soutenaient. À partir de 1569 et Charles IX, commença la fiction du « roi dormant », éveillé à une vie nouvelle par les prélats. Ce lit de parade évoque alors les deux corps du roi (Ernst Kantorowicz). La chaîne naturelle des monarques incarnait le ‘corps moral’ du roi, qui ne meurt jamais. « Le roi est mort, vive le roi ! ». Le ‘corps naturel’ de chaque successeur prenait sans discontinuité la place du corps de son prédécesseur, comme si le gisant se relevait. On avait une résurrection (d’un mort à un vivant) ou continuité de l’État. Les gisants royaux de Saint-Denis l’illustrent où les rois sont les yeux ouverts, les plis du vêtement droits comme s’ils étaient debout. Le rituel se fixa sous Louis XIII. Laon frappait à la porte close : « Que voulez-vous ? » demandait de l’intérieur le chambellan ; « Louis XIII, fils de Henri le Grand ». « Il dort ». Nouveau coup frappé, même réponse. À la troisième tentative, l’évêque disait : « Louis XIII, que Dieu nous a donné comme roi » et aussitôt la porte s’ouvrit.
Cela rappelle bien sûr le rituel mortuaire des Habsbourg qui dut s’inspirer de notre usage royal vu le rayonnement sans pareil de la monarchie française. Mais au-delà, il rappelle après la procession suivant l’évangile des Rameaux lu au tout début de la pré-messe, où le prêtre trouvait aussi porte close et frappait de la hampe de sa croix (ou crosse pour l’évêque) la porte d’entrée trois fois et on chantait « Portes, levez vos frontons ; levez-vous, portes éternelles : qu’il entre, le roi de gloire ! ». « Qui est ce roi de gloire ? » répondait une voix de l’intérieur. Au troisième dialogue, l’impétrant ajoutait : « C’est le Seigneur, Dieu de l’univers, c’est lui le roi de gloire » (Ps 23, 9-10).
Le serment
Sous un passage décoré entre le palais et la cathédrale, le roi entrait au son de l’antienne « Seigneur, le roi se réjouit de ta puissance et combien ton secours lui cause d’allégresse (…). Grâce à ta protection, sa gloire est grande, tu l’as comblé de majesté et de magnificence ». L’archevêque en chape devant l’autel lui désignait son fauteuil sous un dais suspendu (axe cosmique symbolique entre Ciel et Terre). Suivait le Veni Creator. Après l’office de tierce, l’archevêque en chape allait accueillir la sainte ampoule à la porte (sans le roi sauf Louis XI) qui rejoignait alors les insignes royaux rapportés de Saint-Denis sur le maître-autel (les deux abbés royaux encadraient l’autel). Pendant sexte, l’archevêque revêtait les ornements pontificaux, le roi se levait (puis sous Charles VIII se rasseyait et à partir de Louis XIV demeurait assis) par révérence puis faisait son serment.
Ce texte inchangé depuis Hincmar était une garantie préalable à l’onction. Cela avait commencé par un simple dialogue pour maintenir les privilèges canoniques aux églises, leur garantir la loi et la justice, les défendre. Sous Philippe Ier (1059), ce fut même mis par écrit. L’ordo rémois (1200) prévoyait un triple « volo » (je le veux) pour ce genre de scrutin à la germanique. Le peuple était interrogé par deux évêques et on chantait le Te Deum. Mais par la suite, cela devint un vrai triple serment (tria precepta) en touchant les évangiles : paix, justice, miséricorde. Le consentement fut réduit aux grands puis « taisible consentement » sous Louis XIII : qui ne dit mot, consent ! Après le concile de Latran IV (1215), le serment s’enrichit d’une clause pour chasser les hérétiques du royaume à partir de saint Louis (1230). Henri II s’abstint pendant les guerres de religion, mais pas Henri IV, soucieux de se montrer bon catholique désormais !
Charles V ajouta le principe d’inaliénabilité, soit de défendre inviolablement la souveraineté, les droits et la noblesse de la couronne de France, après le désastreux traité que son père Jean II le Bon avait signé à Brétigny en faveur des Anglais. Louis XIV jura aussi de respecter les statuts de l’ordre du Saint-Esprit (fondé en 1578 par Henri III) et ses deux successeurs ceux de l’ordre de Saint-Louis (fondé en 1693)et de ne pas absoudre les duellistes.
Le rituel de chevalerie
Le roi se dépouillait (comme pour une prise d’habit religieuse) car il passait de roi par hérédité à roi consacré par l’onction religieuse. Il gardait une simple tunique rouge avec des ouvertures. L’oraison le replaçait dans sa lignée biblique : « Inonde-le de ta bénédiction céleste et de la rosée de ta sagesse, qu’ont reçue le bienheureux David devant son psaltérion et son fils Salomon par un don du ciel. Sois pour lui la cuirasse contre les rangs ennemis, le casque contre les périls (…) le bouclier qui protège éternellement ». Cela rappelle la vêture du prêtre avant la messe avec le casque du salut pour l’amict etc…
Depuis 1179 et Philippe II Auguste, on exaltait l’idéal chevaleresque sans faire stricto sensu un adoubement car le roi pouvait l’être déjà avant (Louis IX) ou dans la cathédrale mais indépendamment (Louis XI et Charles VIII). On lui concédait juste par cette investiture les armes. Les oraisons justifiaient le recours à l’épée, la défense et la protection des églises et du royaume, des veuves et orphelins, la lutte contre l’injustice et les ennemis du Christ. On lui remettait les bas comme à l’évêque pour une messe pontificale, puis le grand chambellan le revêtait de ses chausses ou bottines et le duc de Bourgogne des éperons d’or datant de Philippe Auguste et munis de tête de lion : « Tu écraseras le lion et le dragon » (Ps 90, 13 : ou plutôt le basilic d’après Septante et Vulgate. Ce psaume est aussi gravé sur la cathèdre du pape au Latran). L’archevêque remettait le baudrier et après tout un ballet de remise et dépose, l’épée était confiée au sénéchal qui la tenait pointe en l’air durant toute la cérémonie. Celle qui était utilisée était faussement attribuée à Charlemagne mais est composite. Joyeuse, puisqu’elle porte un nom comme Durandal ou Excalibur remonte au Xe ou XI e s. pour sa partie ancienne, le pommeau mais fut vraisemblablement fabriquée pour le reste pour 1179.
Les onctions et la vêture
Suivaient les prières pour la santé du corps du monarque, la prospérité du royaume, l’abondance de blé, de vin, d’huile, l’opulence de toute récolte, une postérité et qu’il parvienne après une longue vie au Royaume éternel. Venaient ensuite la préparation du saint-chrême, puis les litanies que roi et archevêque écoutaient prosternés devant l’autel avant la prière finale où le second se relevait.

À genoux, le roi recevait la septuple onction par le pouce de l’archevêque : sur la tête comme pour les évêques, sur la poitrine, entre les épaules, sur chaque épaule et aux jointures des bras : « par cette onction d’huile sanctifiée, je te fais roi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Il s’agissait d’investir tous les sièges vitaux de la force d’en-haut pour qu’elle pénétrât jusqu’au cœur. Jadis en effet, la corne d’huile coula de la tête de David sur tous ces membres. Le roi était l’intermédiaire entre Dieu et les hommes par ce chrême miraculeux. L’antienne rappelait le sacre de Salomon et les longues oraisons replaçaient le roi dans la lignée des prêtres, prophètes et rois d’Israël.

Comme un évêque avec tunicelle, dalmaticelle et chasuble, le roi était revêtu par le chambellan de la tunique (sous-diacre), de la dalmatique (diacre) et du manteau fleurdelisé (équivalent de la chape/chasuble de l’évêque mais porté avec un fermail sur l’épaule droite qui s’agrandit jusqu’à devenir une traîne de 5,70 m pour Charles X). Les vêtements furent initialement (funérailles de Lothaire par Richer en 986) pourpres ; puis bleus ou violet semé d’or. Henri II de Germanie, canonisé, portait un manteau étoilé, mêlant intimement Jésus, Marie, les séraphins, les saints, avec le soleil, la lune, le zodiaque, les constellations, représentant le cosmos (Sg 18, 24). Louis VII remplaça par le lys royal à la fin du XIIe s. croissants, étoiles, soleils du manteau comme sur des statues funéraires de Clotaire Ier et Sigebert Ier à Saint-Médard de Soissons. Nombreuses sont les références bibliques au lys pour la même prétention à une domination universelle d’essence christique comme symbole de magnificence (et abandon à la Divine Providence car ils ne filent ni ne tissent, Lc 12, 27) et du choix de l’élu par Dieu (le lys des vallées : Ct 2, 1-2). Le roi est chargé de conduire, comme le prêtre, son peuple vers la Jérusalem céleste où brille le Christ, soleil de justice, orné de la couronne des créatures bienheureuses. Le bleu du fond n’est pas d’abord céleste mais bien la couleur du manteau sacerdotal (Ex 28, 15) d’un bleu violacé (hyacinthe biblique différent du jaune-rouge habituel, comme pour Charles X). Comme pour l’iconographie de la Vierge où le rouge terrestre était recouvert du bleu céleste (inversé chez le Christ par l’Incarnation : bleu recouvert de rouge).

Le roi recevait deux onctions supplémentaires sur les mains. Les prières rappelaient le pontifical lors du sacre des évêques puisque le roi était assimilé à un sous-diacre par certains aspects mais aussi à un « évêque du dehors » : de même qu’à l’intérieur l’évêque est pasteur et recteur des âmes, le roi à l’extérieur était le défenseur de l’Église du Christ et du royaume. On lui remettait donc des gants pour respecter l’onction des mains ou on les lui essayait avec du coton, de la mie et du sel et on les lavait pour ne rien profaner. Les gants et la tunique pourpre du roi étaient d’ailleurs brûlées après la cérémonie par respect. L’anneau était remis comme pour les évêques à l’annulaire droit, signe du mariage avec son peuple « de la sainte foi et de l’intégrité du royaume ».
La remise des insignes
Le sceptre a pour modèle le bâton du berger et le bâton du messager divin comme chez Homère le skêptron. Il évoque encore la verge de Moïse et était fin et court puis s’allongea jusqu’à 1,87 m sous Charles V. La hampe d’origine est perdue (il y avait 2,5 kg d’or à récupérer). Cela rappelle la férule pontificale et crosse épiscopale, d’ailleurs démontable aussi en plusieurs morceaux bien adapté pour les rois enfants. Surmonté d’un fleuron, le lys s’imposa ensuite, évoquant « un rameau sortira de la souche de Jessé (père de David), une fleur de ses racines » (Is 11, 1). C’était bien sûr assimilé à la Vierge portant le Christ. Mais on peut encore y lire le sceptre que tendit Assuérus à Esther pour lui garantir sa protection quand elle osa paraître devant le roi et lui parler pour son peuple en toute paix (Esther 8, 4). Le sceptre de Charles V, le seul qui nous soit parvenu était émaillé de blanc pour le lys et surmonté de Charlemagne trônant avec trois médaillons sur le nœud : apparition de S. Jacques à Charlemagne pour lui ordonner de délivrer l’Espagne ; miracle des lances fleuries pour les chevaliers qui devaient mourir au combat ; intervention de S. Jacques pour arracher l’âme de Charlemagne au démon. Il en développa le culte car il était le second Capétien et premier Valois à relever le nom de l’illustre ancêtre par sa mère Bonne de Luxembourg. Une manière aussi d’affirmer qu’il était « empereur en son royaume ».
La verge, symbolise la vertu et l’équité car le roi devait remettre dans le droit chemin ceux qui s’égaraient, tendre la main à ceux qui étaient tombés, relever les humbles et confondre les orgueilleux comme dans le Magnificat. Au XIIIe s., elle fut surmontée d’une main divine à trois doigts levés en signe de bénédiction (Trinité et double nature du Christ comme chez les orthodoxes ?). Elle faisait 1 coudée (59 cm dont 7 pour la main), mesure biblique. L’étymologie de David serait « main forte » ou « vaillante main » pour S. Isidore de Séville. Mais c’est aussi la virga d’Isaïe ou de l’Apocalypse renvoyant à la punition sévère. À partir de 1461, on la dénomme main de justice, à l’origine en corne de narval (licorne) avec un saphir ornant l’annulaire avec trois cercles de grenats, saphirs, perles. Détruite à la révolution, celle refaite pour Napoléon fut mise à l’envers (main gauche, qui porte malheur = sinistra !), elle servit aussi à Charles X et on sait comment ils finirent ! La France disposait donc de 2 sceptres assez longs mais pas un sceptre court avec l’orbe comme beaucoup d’autres monarchies suivant le modèle impérial. Cela remonte pourtant à l’ère carolingienne puisque Charles le Chauve reçut 2 sceptres du pape en 876. Cela résulte de la lecture biblique associant sceptrum et baculus ou baculus et virga : « Près de moi ton bâton, ta houlette, sont là qui me rassurent » (Ps 22, 4, Vulg.). Même si le roi d’Israël n’avait peut-être pas deux sceptres, l’image davidique s’imposa de la verge de rigueur qui châtie et du bâton consolant qui soutient.
Le roi disposait de deux couronnes : celle de tradition, imposée par l’archevêque et soutenue par les douze pairs, commune à tous les sacres et la sienne propre, plus légère et à la mode, remise après la communion qu’il gardait pour le festin. Cela s’imposait pour les très jeunes rois. Celle de tradition était alors portée sur un coussin. La couronne est la variante barbare du vieux diadème de la royauté sacrée hellénistique (Alexandre le Grand et ses successeurs) et impériale romano-grecque. Elle apparut pour le sacre de Charlemagne en 800 et en 816, le pape amena une couronne de Constantin. Louis VII fixa encore les choses avec le modèle fleurdelisé à coiffe unique qui l’apparentait à une tiare ou mitre, soulignant le caractère épiscopal. Comme la tonsure des clercs appelée aussi corona, elle symbolise l’ouverture sur les réalités d’en-haut, sur la Jérusalem céleste, tandis que le bonnet évoque la royauté sacrée de Melchisédek. Le trésor de Saint-Denis contenait de nombreuses couronnes votives ou reliquaires avec une épine de la vraie couronne du Christ. Elle fut utilisée pour Jean II le Bon (1350) et Louis XI (1461), puis Anne de Bretagne (1492). Particularité unique en Europe, la France disposait d’une paire de couronnes identiques pour le roi et la reine : même forme, même décoration. La seule différence était la taille et le poids (4 kg contre 2,5 kg) et la coiffe rouge semée de douze roses de perles et surmontée d’un rubis gros comme un œuf pour le roi. La « couronne de gloire et de justice » était formée de quatre plaques assemblées par des charnières surmontées d’une large fleur de lys avec 4 émeraudes, saphirs, rubis (= 12 pierres) signifiant la foi, l’espérance et la charité. Les pierres signifiant les vertus dont doit briller le roi pour le mener au céleste Royaume. Elle reflète donc la clarté de l’âme, comme l’auréole des bienheureux du Paradis. Elles sont vraisemblablement datées de Louis VII là encore (offertes par Philippe Auguste à l’abbaye, rachetées par Louis VIII en 1223 puis données de nouveau par Saint Louis en 1260). Mais on l’appela couronne de Charlemagne. Elle disparut en 1590 durant les guerres de religion (elle représentait 30% de la valeur du trésor de Saint-Denis). Les derniers sacres se firent donc avec la couronne de la reine, détruite à la révolution. Napoléon refit une couronne de Charlemagne ornée de camées, réutilisée par Charles X (celle de lauriers était sa couronne personnelle).
Les douze pairs de France venaient alors. Leur nombre se fixa au XIIe s. par analogie avec les apôtres, la table ronde. Ils étaient pour moitié ecclésiastiques : l’archevêque-duc de Reims, les évêques-ducs de Laon, Langres, les évêques-comtes de Beauvais, Chalons et Noyon et pour moitié laïques : les ducs de Bourgogne, Normandie et Aquitaine, les comtes de Flandre, Toulouse et Champagne. Avec l’intégration des grands fiefs à partir du XIIIe jusqu’au XVe s., ils furent représentés par des princes du sang ou de grands seigneurs. Si les pairs avaient incarné au Moyen Âge le gouvernement associant le roi à ses grands barons, les princes du sang incarnaient le principe dynastique de la monarchie absolue. Ils soutenaient la couronne comme les arcs-boutants du trône après que l’archevêque l’eut imposée seul car c’est Dieu qui confère « la couronne de gloire et de justice ».
Enfin l’oriflamme (Montjoie Saint-Denis) n’avait en principe rien à faire à Reims mais était de Saint-Denis. La couleur rouge était celle des martyrs parisiens et la couleur impériale. Il fut « levé » pour la première fois en 1124 pour arrêter l’empereur Henri V. Il était à Bouvines (1214), aux croisades, à proximité du roi.
L’intronisation
Le roi après de multiples oraisons, bénédictions, était intronisé sur son trône dominant le jubé, « sa montagne sainte » (cf. prières au bas de l’autel : « Emítte lucem tuam et veritátem tuam : ipsa me deduxérunt et adduxérunt in montem sanctum tuum, et in tabernácula tua »), entre Ciel et Terre : « Que le médiateur de Dieu et des hommes fasse de toi le médiateur du clergé et du peuple » lui disait l’archevêque avant de l’embrasser et de crier « Vive le roi éternellement ! ». Puis il entonnait le Te Deum. Les pairs répétaient le baiser et l’acclamation puis l’assistance le reprenait au son des trompettes, tambours et hautbois et salves de mousqueterie dehors. Des oiseaux étaient lâchés (700 à 800 moineaux, chardonnerets et autres volatiles pour Louis XIII en 1610 pour le plus grand amusement du petit roi) comme symbole des prisonniers élargis : Louis XIV pour 6.000 ; Louis XV moins de 600 et Louis XVI 112 sur 150 examinés. Là encore, le roi était moins généreux pénalement. La magnificence du roi devait s’exprimer aussi financièrement car Henri II distribua à la foule 1.000 pièces d’or et 10.000 d’argent, comme jetons à son effigie.
À la messe, le roi, comme Melchisédek, portait à l’autel le pain et le vin remplacés lorsqu’on utilisa les hosties par un pain d’or et d’argent ; plus 13 besants d’or, symbolisant son mariage avec son peuple comme l’époux le donnait à son épouse le jour de ses noces. Il recevait l’absolution de la confession de la veille et communiait sous les deux espèces, et pour le sang du Christ, dans le précieux calice de S. Remi (qui dut servir pour la première fois pour Louis VIII et Blanche de Castille en 1223 ou leur fils saint Louis en 1226. Le pape Jean-Paul II l’utilisa pour la messe des 1500 ans du baptême de Clovis le 22 septembre 1996).
La cérémonie durait 6 à 7 h (sauf Charles X en 3h30 car beaucoup de choses étaient supprimées ou allégées) et était suivie d’un festin au palais du Tau.
Le sacre de la reine
Au second sacre de Pépin le Bref avec ses fils Charles (Charlemagne) et Carloman, le 28 juillet 754 par le pape Étienne II, son épouse Berthe aux grands pieds fut aussi sacrée, première de 30 reines. Toutefois, il n’y eut pas d’onction mais une bénédiction sur la mère des futurs souverains, dotée de grâces spirituelles. Pas plus pour les deux femmes de Louis le Pieux le 5 octobre 816 pour Hermengarde par Étienne IV qui lui apporta une couronne et Judith en 819.
L’un des textes fondateurs fut pour le sacre de Judith, fille de Charles le Chauve et Ermentrude, épouse du roi Aethelwulf de Wessex (Saxons de l’Ouest). Cela suivit son mariage, commença par la remise de l’anneau et faisait référence aux grandes femmes de l’Ancien Testament : Sara, Rébecca, Rachel (épouses d’Abraham, Isaac et Jacob) et Anne (mère du prophète Samuel qu’elle consacra à Dieu), Noémie (arrière-grand-mère de David), Esther et Judith qui toutes deux libérèrent leur peuple de l’oppression païenne. Elle était investie d’une mission d’évangélisation chez des gens encore mal convertis. Sa couronne principale devait être ses vertus. La bénédiction des mamelles et du sein (uberum et vulvæ) invoquait sa fécondité. Mais le premier vrai sacre de l’épouse d’un roi date de 866 à Saint-Médard de Soissons par Hérard, archevêque de Tours, pour Ermentrude, mère de Judith, bien qu’elle eût déjà donné 9 enfants en 24 ans de mariage.
Si le modèle du sacre de la reine suivait celui du roi, la sacralité en était moindre, sans remise d’armes ni serment. Deux onctions seulement étaient faites sur la tête et la poitrine, en lien avec la fécondité. L’huile ne provenait pas de la sainte ampoule. Elle recevait le seul manteau rouge et non fleurdelisé car sans la dimension sacerdotale ; sans tunique ni gant ; mais bien l’anneau, la verge mais un sceptre plus petit (peut-être un sceptre consulaire pour le sceptre de Dagobert surmonté d’une boule avec aigle chevauché par un personnage mais volé en 1795 ; puis l’autre tiré de la rose d’or donnée à Louis VII par Alexandre III en 1163 pour son soutien contre le schisme). Associée au souverain par son mariage et son sacre, elle recevait l’image de l’autorité royale mais sans voir l’effectivité de son exercice. Sa couronne était soutenue seulement par des barons et princes. Son trône était plus bas. Elle recevait aussi la communion sous les deux espèces jusqu’en 1492 où Anne de Bretagne (épouse de Charles VIII) fut la première écartée du calice. La reine descendait d’un cran. On avait oublié l’usage antique de la double communion et la sacralisation du roi lié au prêtre exigeait qu’on l’en écartât.
Souvent les rois étant sacrés très jeunes (même du vivant de leur père jusqu’à Philippe Auguste en 1179), ils étaient célibataires. La reine était donc sacrée après son mariage la plupart du temps, à Sens pour Marguerite de Provence, Amiens pour Ingeburge de Danemark, épouses de ce même Philippe Auguste. Mais le plus souvent c’était à Paris dans la cathédrale ou dans la Sainte-Chapelle. Ce n’est qu’aux XIIIe et XIVe s. que se développèrent les sacres doubles à Reims : Louis VIII et Blanche de Castille en 1223 ; Philippe le Bel et Jeanne de Champagne en 1286 ; Louis X le Hutin et Clémence de Hongrie en 1315 ; Philippe V et Jeanne de Bourgogne en 1317 ; Philippe VI de Valois et une autre Jeanne de Bourgogne en 1328 ; Jean II le Bon et Jeanne de Boulogne en 1350 ; Charles V et Jeanne de Bourbon en 1364. Ce fut le dernier sacre d’un couple. D’Anne de Bretagne (1492) au dernier, Marie de Médicis (1610), tous les derniers furent distincts et à Saint-Denis. Les rois déjà mariés à leur avènement différèrent le sacre de l’épouse : François Ier, Henri II. Henri IV attendit 10 ans et ce fut le fait du prince, précédant tout juste son assassinat ! Louis XIII, Louis XIV et Louis XV se gardèrent de faire sacrer leur reine épousée plus tard tandis que Marie-Antoinette assista en spectatrice à la tribune ! Les reines furent mises à l’écart déjà par la loi salique et la mode romaine à la Renaissance alors même qu’on les sollicite comme régentes !
[1] L’archevêque Hincmar de Reims, dans un office en l’honneur de saint Remi passé dans l’ordo de Charles V écrivit : « le bienheureux Remi sanctifia dans l’eau du baptême le peuple illustre des Francs en même temps que leur noble roi, après avoir reçu du Ciel un chrême sacré, et il leur accorda pleinement le don du Saint-Esprit, lui qui, par la faveur singulière d’une grâce, apparut sous la forme d’une colombe, et délivra du Ciel au pontife le divin chrême ». Hincmar fit un discours le jour du sacre de Charles le Chauve comme roi de Lotharingie en 869 à Metz, évoquant ce baptême « avec trois mille de ces Francs, excepté les enfants et les femmes, la veille du saint jour de Pâques dans la métropole de Reims, oint d’un saint chrême reçu du Ciel, que nous avons conservé jusqu’à présent ».