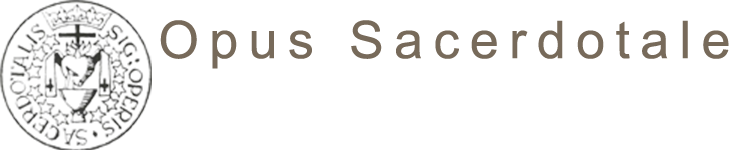Histoire de la spiritualité chevaleresque – par M. l’Abbé Bernard Pellabeuf
Histoire de la spiritualité chevaleresque
Table des matières
INTRODUCTION
I. LES ATTENTES DES LAÏCS
1.1 Pour l’histoire d’une institution
1.2 Remarque historiographique
1.3 L’héritage des civilisations indo-européennes
1.4 Des combattants à cheval
1.5 Vertus et code d’honneur
1.6 La tradition de l’adoubement
1.7 Conclusion de la première partie
II. LES INTENTIONS DES CLERCS
2.1. Le contexte historique de l’adoubement liturgique
2.2 La benedictio novi militis
2.2.1. Benedictio
2.2.2. Miles
2.2.3. Novus
2.2.4. Le rite
III. L’Âge d’Or de la chevalerie
3.1. L’âge courtois
3.2. Les croisades
3.3. Les ordres de chevaliers religieux
3.4. Cîteaux
3.5. Le cycle du Graal
IV. La chevalerie tardive
4.1. De nouveaux ordres de chevalerie
4.2. Le service du Prince
4.3. Particularités nationales
4.3.1. Knight : le chevalier anglais
4.3.2 Les cavaliers des républiques italiennes
4.3.3 L’exception ibérique
4.3.4 La preuve par le Congo
4.4 La spiritualité chevaleresque tardive
V. Renouveau de la chevalerie
5.1 Le XIXème siècle
5.1 Le XXème siècle
CONCLUSION : actualité de cette spiritualité
Introduction
A deux reprises, dans le Benedictus, il est question d’être libéré « de la main des oppresseurs », ou « de la main des ennemis » : Zacharie rappelle les promesses du Seigneur, et annonce qu’elles vont s’accomplir. Il termine sa prière par l’expression : « pour guider nos pas au chemin de la paix ». (Lc 1, 68-79) C’est une des préoccupations majeures des gens de l’Ancien testament, d’être libres pour exercer sur la Terre Sainte et dans le Temple un culte agréable à Dieu. Le Cardinal Ratzinger faisait remarquer que c’était déjà l’exigence de Moïse : c’est pour offrir un sacrifice qu’il faut que le Peuple de Dieu quitte l’Egypte ; « le culte divin, la liberté de pouvoir adorer Dieu comme il l’exige, qui apparaît au Pharaon comme le seul but de l’Exode, en est véritablement le but essentiel. »[1] Cette préoccupation restera celle de l’Eglise, qui à Vatican II exige la liberté pour son culte : « Le pouvoir civil (…) dépasse ses limites s’il s’arroge le droit de diriger ou d’empêcher les actes religieux. »[2]
On comprend dans ce contexte l’enseignement de Saint Thomas d’Aquin : « La fonction militaire est susceptible d’être ordonnée au bien du prochain, et non pas au bien des particuliers uniquement, mais encore à la défense de tout l’État. […] Le métier des armes peut aussi servir au maintien du culte divin. […] Il est donc convenable d’instituer un ordre religieux pour la vie militaire, non certes en vue d’un intérêt temporel, mais pour la défense du culte divin et le salut public, ou encore la défense des pauvres et des opprimés. »[3] Et Saint Thomas cite les combats des frères Maccabée, « pour nos lois et pour nos choses saintes » (1 M 13, 3). En justifiant les ordres religieux militaires, il fait comprendre les motivations de l’institution d’un rite liturgique pour le chevalier.
Tout cela nous montre que même si l’institution chevaleresque n’est pas née du fait de la hiérarchie ecclésiastique, celle-ci a eu l’intuition de l’avantage qu’elle pouvait en tirer. Il était important de greffer sur un mouvement social comme la chevalerie une spiritualité qui permette à ses membres de se sanctifier tout en remplissant leurs devoirs vis-à-vis de l’Eglise et des communautés au sein desquelles ils vivaient.
On pourra donc commencer par examiner les attentes des laïcs désirant adhérer à cette institution, ce qui permettra d’en esquisser les origines historiques : pour éviter de présenter une spiritualité abstraite, il importe de la suivre pas à pas dans son développement historique et donc dans ses rapports avec l’histoire tout court. Et nous verrons que dès ce stade les éléments spirituels ne manquent pas.
Ensuite il faudra chercher quelles étaient les motivations des clercs en instituant l’adoubement liturgique vers l’an Mil.[4] Il y avait des préoccupations immédiates et quasi matérielles, mais aussi un souci moral ; et parce qu’on ne moralise vraiment que ce qu’on spiritualise, c’est à ce stade qu’on pourra trouver le maximum d’éléments spirituels.
Cependant la chevalerie ne s’est pas figée au XIème siècle. Au contraire, peut-être justement parce qu’elle avait acquis un caractère manifestement sacré avec l’adoubement liturgique, elle a connu son heure de gloire, un temps qu’on peut appeler son âge d’or. Une série d’évènements militaires, sociaux, culturels et littéraires, ainsi que spécifiquement religieux, se sont produits au XIIème siècle qui l’ont profondément marquée, de sorte qu’on en est arrivé à une spiritualité moins liée aux circonstances historiques de sa naissance.
Par la suite, la chevalerie a perdu de son rôle social, et on peut distinguer une époque de « chevalerie tardive ». Là encore elle acquiert des caractéristiques particulières qui ne sont pas sans préparer l’avenir : un chevalier n’est pas nécessairement un cavalier, et il n’est plus non plus forcément un combattant. Mais le socle du code d’honneur reste intact.
Après les âges obscurs de la Renaissance et du Siècle des Lumières, on redécouvrira avec le romantisme l’éclat du Moyen-âge ; et aux XIXème et XXème siècles la chevalerie fera un retour discret mais significatif. Et c’est donc enfin de cela qu’il faudra se soucier : quels peuvent être les éléments de cette spiritualité à promouvoir aujourd’hui.[5]
- Les attentes des laïcs
Présenter séparément les attentes des laïcs et les intentions des clercs ne signifie pas que ceux-là n’adhéraient pas à celles-ci : le Moyen-Âge est trop religieux pour une telle séparation ; ni que ceux-ci ignoraient celles-là : ils étaient bien de leur époque et n’en remettaient pas fondamentalement la culture en cause. Qu’on ne s’étonne donc pas de trouver dans cette section des éléments proprement religieux.
Mais cette distinction est nécessaire pour la clarté du propos. Il y a dans la chevalerie des éléments qui viennent de la simple évolution sociale, d’autres qui sont voulus en eux-mêmes pour moraliser et spiritualiser la chevalerie.
1.1 pour l’histoire d’une institution
Que recherchaient les laïcs, en demandant l’adoubement à l’Eglise ? Leurs motivations sont nombreuses et montrent que la chevalerie est une réalité complexe et solidement enracinée dans les traditions qui ont façonné l’Occident. Car un chevalier peut être considéré, d’après son nom, comme un combattant à cheval, ou d’après son institution, comme quelqu’un qui a reçu l’adoubement. Ou encore, comme quelqu’un qui adhère au code d’honneur.
Au début des temps Mérovingiens, tous sont sommés de combattre avec les seigneurs.[6] Mais au moins à partir des Carolingiens, les combattants ne sont plus la totalité des hommes libres. Ils sont la minorité – et ils combattent à cheval. On peut y voir un héritage romain[7], car dès que la république a été assez forte pour ne plus mobiliser tous ses citoyens – en gros après les guerres puniques – la protection de son empire a reposé sur des légions suffisamment entraînées pour pouvoir affronter des ennemis largement supérieurs en nombre. Cela a conduit à l’émergence, au Moyen-Âge, d’un groupe social particulier, les combattants, qui ont la responsabilité de la « tranquillité de l’ordre ». Et parmi ces combattants, ceux qui possèdent un cheval sont à part.
1.2 Remarque historiographique
Pour déterminer la mentalité des gens vers l’An Mil, il faut se tourner vers trois sources. La source germanique, inscrite dans le contexte indo-européen, est fondamentale, puisque d’elle vient le rite de l’adoubement. La source chrétienne l’est aussi : sans le christianisme, le Moyen-Âge est incompréhensible. Mais on a eu tendance à minorer la source romaine. Les études de Léon Gautier, par exemple, sont tributaires de la façon dont on percevait à son époque les Grandes Invasions. Voici ce qu’en dit Migne : « A la chute de l’empire d’Occident, quand les Goths, les Huns et les Francs se partagèrent le patrimoine du faible Honorius, l’Europe éprouva la plus cruelle révolution que l’histoire nous ait transmise. Ces conquérants, peuples guerriers et farouches, méprisaient l’art paisible de l’agriculture ; la plupart habitaient des forêts, leurs maisons n’étaient que des antres souterrains, et leur ignorance allait si loin, qu’ils ne connaissaient pas même l’usage des lettres ou caractères. Sous la domination de ces barbares, les sciences et les arts furent traités comme les vaincus… »[8]
Mais les progrès de l’histoire de l’Antiquité Tardive[9] et du Haut Moyen-Âge permettent de constater que la romanité n’a pas disparu, et on le note tout d’abord au plan de la culture, où l’Antiquité reste un modèle permanent. « Les écoles des grammairiens et des rhéteurs avaient survécu aux invasions en Italie ostrogothique et en Afrique vandale. En Gaule du Sud et en Espagne, si elles ont disparu, des précepteurs particuliers, ou les parents, ont maintenu jusqu’au VIIème siècle la tradition de la culture classique. »[10] On peut ajouter qu’une telle survie de la culture antique aurait été impossible si les nouveaux venus n’avaient éprouvé pour elle que du mépris. Le respect assez général des abbayes par les Mérovingiens, ou l’introduction d’éléments de droit romain dans les codes juridiques à l’usage des populations germaines installées dans l’ancien empire romain prouvent au contraire l’envie qu’avaient les dirigeants des nouveaux venus de conserver une grande part de l’héritage romain. Ainsi la culture latine s’est prolongée grâce à la littérature juridique ou autre : l’idéal de la culture antique a perduré de façon continue jusqu’au VIIe siècle, et a été repris ensuite dès la Renaissance Carolingienne, coexistant avec le modèle de formation monastique. Que ce soit directement ou indirectement, cette culture a influencé l’institution chevaleresque.
Sur le fait qu’on a bien ces trois sources à l’origine de la chevalerie, on peut se reporter à ce que dit Jean Flori : sur la période des IIIème au VIème siècles, « L’Empire romain forme le substrat culturel et fournit la base démographique de l’Europe occidentale ; les peuples barbares, principalement germaniques, s’y sont introduits plus ou moins pacifiquement avant de prendre le contrôle politique de ses dépouilles ; le christianisme, sous des formes diverses, a fini par pénétrer les deux entités romaine et germanique pour conférer à la nouvelle société issue de leur fusion sa seule unité réelle, rassemblant ses éléments divers pour former, à la fin de notre période, une ‘chrétienté occidentale’. »[11]
S’il a pu y avoir ainsi une permanence culturelle, c’est parce qu’il y a eu surtout permanence démographique, non seulement du bas-peuple, mais aussi dans la haute société. Les élites gallo-romaines ou italiques ont fusionné avec les seigneurs nouveaux venus. Cette fusion a pu prendre des siècles ; on signale qu’en Burgondie, elle ne fut réalisée qu’au VIIIème siècle : « Dès la seconde moitié du sixième siècle, des nobles gaulois portaient des noms germaniques et des Burgondes répondaient à des noms romains. Il existait même des aristocrates qui portaient deux noms, l’un romain, l’autre germanique (…) La création d’un espace identitaire burgonde s’acheva (…) au début du 8ème siècle. »[12] Mais le phénomène est général. Jean Flori note « Même si l’on ne peut admettre, comme le voudrait K. F. Werner[13], une stricte continuité entre noblesse romaine et noblesse médiévale, on retrouve, parmi les comtes et châtelains, des descendants de familles qui exerçaient jadis la militia au sens ancien de fonction publique et dont la noblesse, transmise par le sang, s’était maintenue aux yeux de tous, en l’absence de tout exercice de cette fonction. »[14]
Dans la pratique, on peut relever la querelle au sujet de l’origine romaine de la chevalerie. Léon Gautier a raison de la rejeter. Mais lorsqu’il analyse l’expression cingere balteum en disant que l’expression est romaine, mais la réalité germanique, il va trop loin : la remilitarisation de la société et de fonction publique à la fin de l’Empire font douter qu’il ait totalement raison.[15]
On peut donc s’écarter de la ligne de Léon Gautier, qui n’envisageait qu’une christianisation progressive du rite germain : on ne peut plus se passer de l’apport romain pour comprendre l’institution chevaleresque. Cet ouvrage de Léon Gautier reste néanmoins une référence fondamentale pour la connaissance de la chevalerie.
1.3 L’héritage des civilisations indo-européennes
Ce n’est sans doute pas un hasard si la chevalerie est née chez des peuples indoeuropéens. En effet chez les Indoeuropéens on distingue trois catégories de personnes : les prêtres-législateurs, les guerriers, et les producteurs.[16] Le jeune homme qui au Moyen-Âge demande à être adoubé se situe en fait, sans le savoir, dans cette tradition d’une appartenance à la catégorie des combattants.
De plus, si les prêtres sont aussi des législateurs, il est normal qu’ils assignent aux combattants leurs objectifs et réglementent les moyens pour y parvenir. Jules César en fera l’expérience : c’est après une réunion de druides dans la forêt des Carnutes qu’éclate la révolte de Vercingétorix. César en tirera les leçons et interdira les cultes druidiques. Quand plus tard le pape appelle à la croisade, ou quand les clercs influencent le code d’honneur pour discipliner les cavaliers carolingiens, ils se situent, là encore sans en avoir conscience, dans l’héritage indoeuropéen, qui nous fournit une première approche de la spiritualité chevaleresque : la soumission à l’ordre religieux.
Enfin le cheval, « originaire des steppes d’Europe orientale, symbolisait la vie et ses instincts, ainsi que la noblesse. Domestiqué dès le quatrième millénaire avant notre ère, il a permis les conquêtes des Indo-Européens. Le prestige qui l’entourait est à l’origine de la chevalerie dans l’Occident chrétien. »[17] Tout cela montre que le cadre dans lequel s’épanouira la chevalerie s’est mis en place durant des millénaires.
1.4 Des combattants à cheval
En effet, ceux qui veulent l’adoubement se rattachent à une tradition qu’on trouve chez les Gaulois comme chez les Germains : on note chez ces deux peuples l’existence, dès l’Antiquité, d’une sorte de caste de combattants à cheval qui ont à cœur de protéger les civils qui se soumettent à eux, sans quoi ils les opprimeraient.[18] Peut-être cette façon de voir met-elle trop l’accent sur les luttes entre les classes sociales, mais en tout cas elle se comprend spécialement à l’époque mérovingienne où les guerres dévastatrices se succèdent indéfiniment : les héritiers des seigneurs francs se partagent le domaine et n’ont de cesse qu’ils aient repris la part du voisin leur frère ; ils obligent la population gallo-romaine à participer à ces expéditions, et les membres de cette population s’y joignent finalement par appât du gain, le but étant alors de prélever un maximum de butin.[19] Cette caste des guerriers à cheval est donc riche, car posséder et entretenir un cheval n’est pas à la portée de tous, et elle se sent une responsabilité sociale vis-à-vis de ceux qu’elle doit protéger.
Cependant cette conception ne rend pas compte de toute la réalité de la chevalerie – paradoxalement, un chevalier n’est pas forcément un cavalier, et à l’époque tardive il n’est parfois même pas un combattant ! Il faudra donc chercher d’autres traits de cette institution. Mais avant, demandons-nous quelle spiritualité pouvait être celle des combattants à cheval.
Une symbolique s’attache au binôme du cavalier et du cheval. Celui-ci représente le corps, celui-là évoque l’âme. La maîtrise de soi qu’implique le fait de monter à cheval, maîtrise nécessaire pour dominer sa monture, permet de comprendre cette symbolique. Ajoutons que cette maîtrise, de soi-même et de sa monture, est particulièrement nécessaire au combat. Le cheval est un animal peureux, le cavalier doit s’imposer à lui. Tout cela culmine dans la charge, où le cavalier ne doit pas seulement imposer sa volonté à sa monture, il doit encore la faire participer à un mouvement d’ensemble où le moindre faux pas peut être fatal. Cette maîtrise enfin est nécessaire à celui qui régit une population : un chevalier peut s’appliquer à lui-même – pour son domaine – la formule d’Auguste dans Cinna « Je suis maître de moi comme de l’Univers. »[20]
Si l’on parle de chevaux dans la Bible, ce sont généralement ceux des ennemis, comme ceux qui finissent ensevelis dans la Mer Rouge : les montagnes de Judée se prêtent mal aux déploiements de cavalerie. Cependant, on trouve des chevaux dans l’Apocalypse, et ceux qui les montent annoncent la réalisation des desseins de Dieu. C’est peut-être ainsi que se voyaient les chevaliers de la croisade.
Surtout le chapitre XIX de l’Apocalypse représente un cavalier monté sur un cheval blanc et qui a pour nom « Verbe de Dieu » : il combat les païens et vainc la Bête et ses séides. Cela ouvre pour le chevalier la porte à une spiritualité vraiment chrétienne, c’est-à-dire qui l’identifie au Christ. C’est le mérite de Bruno Pin de l’avoir vu et exposé dans son beau livre « Le Christ Chevalier »[21]. Notre étude vise donc à montrer comment s’est réalisée cette identification aux différents âges et courants de la chevalerie.
1.5 Vertus et code d’honneur
Un certain nombre de vertus est donc requis de ces combattants à cheval pour exercer efficacement leur protection des civils. Peu à peu, une élite parmi les guerriers va considérer qu’elle doit avoir non seulement force et courage, mais aussi désintéressement. Cette prise de conscience se fait au moment de la rechristianisation des populations après les grandes invasions.[22] Les clercs qui œuvrent à cette rechristianisation sont tributaires de l’enseignement moral des Pères, eux-mêmes influencés par le stoïcisme, en sorte qu’on peut, sous cet aspect, rattacher l’élaboration de l’idéal chevaleresque à l’idéal vertueux des Grecs de l’Antiquité.[23]
C’est en tout cas une part de la thèse de Kenelm Henry Digby (1800-1880). Considérant avant tout dans la chevalerie son sens de l’honneur et les vertus d’héroïsme qui en découlent, il voit une origine de la chevalerie dans les héros de la Grèce Antique. A l’âge de vingt-deux ans il écrit The Broad Stone of Honour[24], puis il le réédite en quatre tomes, en 1828 et 1829 après sa conversion au catholicisme survenue en 1825. Cette façon de voir a le mérite de souligner l’enracinement de l’idéal chevaleresque dans la culture occidentale, mais les seules vertus ne suffisent pas à définir le chevalier : la visée pédagogique de Digby ne fait aucun doute, il écrit pour les gentlemen anglais de la période romantique.
Toutefois il est vrai que cet idéal vertueux des chevaliers fait partie de leur institution. Il est résumé dans leur code d’honneur, que Léon Gautier (1832- 1897) formule ainsi :
- Tu croiras à tout ce qu’enseigne l’Église, et observeras tous ses commandements.
- Tu protègeras l’Église.
- Tu auras le respect de toutes les faiblesses, et t’en constitueras le défenseur.
- Tu aimeras le pays où tu es né.
- Tu ne reculeras pas devant l’ennemi.
- Tu feras aux infidèles une guerre sans trêve et sans merci.
- Tu t’acquitteras exactement de tes devoirs féodaux, s’ils ne sont pas contraires à la loi de Dieu.
- Tu ne mentiras point, et seras fidèle à la parole donnée.
- Tu seras libéral, et feras largesse à tous.
- Tu seras, partout et toujours, le champion du Droit et du Bien contre l’Injustice et le Mal.[25]
Et c’est par leurs pairs, soumis eux-mêmes à ce code, que sont jugés les chevaliers quand ils y ont manqué, et non par d’autres juges ou par plus noble qu’eux.[26] D’un point de vue spirituel, on peut considérer le fait de suivre le code d’honneur, qui exige d’un chevalier plus que la morale ordinaire, une façon de vivre selon les conseils évangéliques : il faudra y revenir en parlant des ordres de moines-soldats.
1.6 La tradition de l’adoubement
L’adoubement met en lumière la responsabilité sociale de celui qui le reçoit. Pour Léon Gautier, historien de la littérature, un chevalier est avant tout quelqu’un qui a été adoubé. Il peut ainsi faire remonter l’origine de la chevalerie au cérémonial de remise des armes chez les anciens Germains, tel qu’il est décrit par l’historien romain Tacite.[27]
Dans cette cérémonie, on remet solennellement ses armes au jeune homme libre. Il n’y a rien d’étonnant à ce que ce rite se soit transmis durant un millénaire. La mentalité germanique a influencé les populations soumises par les grandes invasions, et l’on trouve d’autre rites de remises d’objets pour sacraliser des évènements. Ainsi lorsqu’on vend un champ, dans la société médiévale occidentale, le vendeur remet une motte de terre de ce champ à l’acheteur.[28] Ce rite de remise d’objets à caractère sacré s’inscrit dans un contexte plus vaste : « C’est un trait propre à la psychologie médiévale que le besoin, vivement senti, de vérités concrètes : le besoin de voir, de toucher par soi-même. (…) On pourrait citer par milliers les textes révélant ce caractère spécifique de l’époque féodale qui rattache toujours à une vérité concrète les vérités d’ordre spirituel. »[29] On sait aussi l’importance qu’a revêtu, dans la théologie de l’ordination, les rites de la porrection des instruments, où l’on remet un évangéliaire au nouveau diacre, ou un calice avec sa patène au nouveau prêtre : ce fut au point que certains théologiens ont affirmé que ces rites faisaient partie de l’essentiel du sacrement ![30]
Chez les Germains, donc, le jeune homme libre, parvenu à l’âge adulte, reçoit solennellement ses armes, dans un lieu sacré. Ce rite lui confère des droits mais surtout des devoirs. Dans les sociétés primitives, la nature n’est pas domestiquée, elle reste hostile, et tous les individus doivent demeurer unis pour faire face à toutes les menaces. Ce trait explique la capacité de mobilisation de certaines populations, qui surprend les individualistes des civilisations techniquement avancées. Une nouvelle fois, on constate que la chevalerie s’enracine profondément dans les sources de la civilisation occidentale. Notons ici que la responsabilité sociale du combattant à cheval ne vient pas forcément d’une solution aux conflits entre puissants et faibles : l’idée que le combattant reçoit ses armes de la société parce qu’il doit la défendre suffit à expliquer ce devoir social du combattant – à cheval ou non.
Car de l’institution originelle, la chevalerie gardera toujours cette idée que l’adoubement donne davantage de devoirs que de droits, et dans le contexte chrétien le devoir principal sera de maintenir la population chrétienne en paix. Ces devoirs impliquent un entraînement poussé et constant, afin d’être toujours prêt à agir ; ils impliquent un certain nombre de vertus, notamment force, courage et abnégation, tout cela dans une totale maîtrise de soi. On voit que l’adoubement, pour un chrétien, suppose le code d’honneur et une forme d’imitation du Christ.
Mais puisque c’est avec l’épée qu’on adoube, voyons quelle est la spiritualité qui s’attache en propre à cette arme. Cet objet a une haute valeur symbolique. Celui qui le détient a un pouvoir de vie et de mort sur son prochain. Le rite est donc destiné à montrer que ce pouvoir n’est pas un pouvoir personnel, mais communautaire. Son usage est soumis à des règles, sur lesquelles le clergé a son mot à dire, et c’est ce qui explique l’existence du code d’honneur chevaleresque. D’ailleurs l’épée est droite. Cette caractéristique de l’arme du chevalier est ressentie comme un appel à la droiture de celui qui veut conformer sa conduite au code d’honneur. On n’adoube pas avec un sabre courbe. L’épée qui sert à l’adoubement liturgique est une épée bénie.[31]
La conversion des Germains à l’arianisme d’abord, au christianisme authentique ensuite, s’est accompagné d’une acculturation certaine : ils sont restés des guerriers. L’Eglise, qui s’était ralliée à l’empereur romain devenu chrétien et christianisant son empire, s’est ralliée aux rois devenus catholiques, à commencer par Clovis. Divers usages en résultent. Ainsi pour prouver sa bonne foi, on pourra jurer soit sur l’évangile, soit sur l’épée : « La proclamation de l’équivalence entre les armes et l’évangile est un point exemplaire de la méthode acculturative romano-chrétienne face au paganisme germanique. »[32] L’épée ne doit pas tomber aux mains de l’ennemi ; on lui donne un nom : Durandal et Excalibur sont les plus connues, grâce à la chanson de Roland et au cycle du roi Arthur – on retrouve aujourd’hui ce fait dans le cycle de Tolkien Le Seigneur des Anneaux. Des reliques peuvent être insérées dans le pommeau de l’épée.
L’épée surtout n’est pas absente de la Sainte Ecriture. Dès la Genèse, elle sépare le paradis et le monde où sont relégués Adam et Eve après leur chute : son tranchant est là pour mettre à l’abri ce qui est sacré, en le séparant nettement du profane (Gn 3, 24). Dans l’Apocalypse, l’épée apparaît encore : là, c’est la parole du Christ qui fait le tri entre le bien et le mal (Apoc 1, 16 ; 2, 12 ; 19, 15). Le chrétien qui porte l’épée doit contenir le mal, ne pas lui permettre de pénétrer dans la communauté chrétienne ; et si le chevalier intervient dans les affaires de l’Église, c’est parce qu’elle doit rester digne d’être défendue. Et il a bien le droit de le faire : il sait que « Qui prend l’épée périra par l’épée » (Mt 26, 52), c’est-à-dire qu’il est averti que son droit d’utiliser l’épée lui vient de l’oblation qu’il a faite de sa vie, offerte pour la cause de Dieu et de l’Église.[33]
Surtout, retenons que c’est cette exposition à la mort qui fait que le combattant chrétien ressemble au Christ, et que sa spiritualité est ainsi véritablement chrétienne : comme le Christ il offre sa vie pour ceux qu’il aime (Jn 15,13). Dans cette perspective, le coup d’épée donné sur l’épaule lors de l’adoubement prend toute sa valeur symbolique, et les Maltais l’ont bien vu : c’est une humiliation pour un chevalier que de recevoir un coup, et cette humiliation symbolique rappelle au nouveau chevalier qu’il doit être prêt à suivre son Maître qui s’est abaissé jusqu’à la mort, et la mort sur une croix (Phil 2,8).[34]
1.7 Conclusion de la première partie
Ces approches historiques de la réalité chevaleresque se complètent donc et montrent d’une part qu’on a affaire à une réalité fondamentalement enracinée dans la culture occidentale, d’autre part que cette réalité est complexe ; aucune ne rend compte totalement de ce qu’est un chevalier, mais réunies elles permettent de tenter une définition assez générale du chevalier : celui-ci est un combattant ayant conscience de sa responsabilité sociale et donc des vertus qui doivent être les siennes, et sa responsabilité est marquée par la cérémonie de l’adoubement. Dans le contexte du Moyen-Âge, cette responsabilité s’exerce vis-à-vis de l’Église et de la chrétienté. Mais de ces trois approches la dernière est la plus propice à notre propos, car qui dit adoubement dit rite, donc symbole et finalement spiritualité.
- Les intentions des clercs
2.1 Le contexte historique de l’adoubement liturgique
Vers l’an Mil, le Pape est depuis des siècles le protecteur du peuple romain, et ainsi le souverain temporel de l’Italie Centrale : l’ancien Empire d’Occident s’est effondré, et malgré ses prétentions à être empereur universel, le basileus de Constantinople est incapable de faire respecter ce qu’il considère comme ses droits sur l’Italie. Or depuis environ deux siècles les assauts des Lombards ont mis à mal « le Patrimoine de Saint Pierre », comme on appelle alors le futur Etat pontifical. Les Papes ont fait appel aux rois, notamment à Charlemagne qui y a gagné son titre d’empereur d’Occident. Mais au Xème siècle les Papes doivent se débrouiller seuls : c’est seulement après la réforme ottonienne que les empereurs romains germaniques pourront à nouveau protéger les Etats du Pape – et le Pape lui-même. Ensuite le Souverain Pontife aura à lutter contre les Normands installés en Sicile puis à Naples, et l’utilité de l’adoubement liturgique s’en trouvera confirmée.
Donc on voit la motivation probablement première de l’institution, à Rome, vers l’an Mil, d’un rite d’adoubement liturgique ; il s’agit de donner mission au nouvel adoubé de défendre l’Eglise et de se sanctifier en le faisant ; et cela parce que l’empire est défaillant : on doit retenir ce lien étroit entre chevalerie est royauté : celle-là supplée à celle-ci. Cependant si cette intuition première a perduré au point que des rituels beaucoup plus élaborés ont pu ensuite être insérés dans les livres liturgiques, c’est sans doute que le mouvement était concomitant à la réforme grégorienne : un des grands axes de cette réforme était de soustraire les clercs au pouvoir des princes, et justement le fait d’avoir des combattants recevant d’un prélat leurs armes fournissait à l’Eglise des hommes prêts à comprendre et faire respecter son désir d’indépendance.
La paix pour le culte, voilà ce que l’Eglise demande d’abord aux chevaliers. Par la suite on amplifiera l’intitulé de cette mission, Léon Gautier va dire qu’il s’agit « d’élargir ici-bas les frontières du royaume de Dieu ».[35]
2.2 La benedictio novi militis
En prévoyant un rite liturgique spécial pour les nouveaux chevaliers, l’Eglise ratifie leurs attentes en précisant les siennes. Ce faisant, les clercs lui ont donné un nom qui révèle beaucoup de la portée qu’ils voulaient donner à ce rite, et chacun des mots de l’expression benedictio novi militis est révélateur de ces intentions.
2.2.1. Benedictio
Il s’agit premièrement d’une bénédiction. Dans l’esprit du clergé médiéval, elle est probablement en rapport avec le couronnement impérial, ou l’onction royale. Tant que le septénaire des sacrements n’a pas été fixé par les théologiens, on a pu considérer le sacre impérial comme un sacrement – mais indubitablement c’est un sacramental. Il en va de même pour l’adoubement liturgique. La lecture des paragraphes 1667 à 1673 du catéchisme de l’Eglise catholique ne peut qu’en persuader, spécialement les passages suivants. Il y a d’abord le rappel de la définition des sacramentaux donnée par le concile Vatican II : « La sainte Mère Église a institué des sacramentaux, qui sont des signes sacrés par lesquels, selon une certaine imitation des sacrements, des effets surtout spirituels sont signifiés et sont obtenus par la prière de l’Église. Par eux, les hommes sont disposés à recevoir l’effet principal des sacrements, et les diverses circonstances de la vie sont sanctifiées. »[36] Et aussi : « Ils sont institués par l’Église en vue de la sanctification de certains ministères de l’Église, de certains états de vie… Selon les décisions pastorales des évêques, ils peuvent aussi répondre aux besoins, à la culture et à l’histoire propres au peuple chrétien d’une région ou d’une époque. Ils comportent toujours une prière, souvent accompagnée d’un signe déterminé, comme l’imposition de la main, le signe de la croix, l’aspersion d’eau bénite (qui rappelle le Baptême). »[37]
Dans le cas de l’adoubement liturgique, le signe déterminé est la collée, coup de la paume de la main donné sur le cou du nouveau chevalier, ce qui rappelle la confirmation, dont l’adoubement est en quelque sorte un prolongement ; la remise de l’épée n’est plus là que comme analogue à la porrection des instruments dans les rites d’ordination. Le coup de plat d’épée sur l’épaule peut confirmer ou remplacer la collée.
Quel doit être le ministre de la benedictio novi militis ? Le Catéchisme de l’Eglise Catholique répond là encore : « plus une bénédiction concerne la vie ecclésiale et sacramentelle, plus sa présidence est réservée au ministère ordonné (évêques, prêtres ou diacres ; cf. De Benedictionibus, Praenotanda generalia 16 et 18, ed. typica 1984 p. 13-15). »[38] Le Pontifical Romain, jusqu’à son édition de 1952, comporte la benedictio novi militis et la réserve à un prélat. Cela inclut donc les Pères Abbés. Mais puisqu’un évêque peut déléguer un prêtre pour donner la confirmation, sans doute faut-il admettre la possibilité de déléguer un prêtre aussi pour l’adoubement.
Le même catéchisme répond aussi à la question de l’effet d’un sacramental : « Les sacramentaux ne confèrent pas la grâce de l’Esprit saint à la manière des sacrements, mais par la prière de l’Église ils préparent à recevoir la grâce et disposent à y coopérer. »[39] La grâce propre de l’adoubement liturgique, on l’a vu, est de donner mission de défendre l’Eglise et de se sanctifier en accomplissant cette mission.
Enfin le catéchisme précise la durée de la grâce reçue : « Certaines bénédictions ont une portée durable : elles ont pour effet de consacrer des personnes à Dieu – à ne pas confondre avec l’ordination sacramentelle – … Parmi celles qui sont destinées à des personnes … figurent … le rite de la profession religieuse et les bénédictions pour certains ministères d’Église (lecteurs, acolytes, catéchistes, etc.). »[40] Quand on est adoubé, c’est pour la vie : le sacramental rejoint ici la conception commune concernant l’adoubement laïc. Si l’on ne peut évidemment pas parler d’un caractère sacramentel donné par la benedictio novi militis, du moins on doit reconnaître que l’âme en est marquée d’une disposition stable. La mention de la profession religieuse par le catéchisme à propos des sacramentaux nous montre que ceux-ci peuvent impliquer une sorte de consécration personnelle, et nous retrouverons cette idée à propos des ordres de religieux chevaliers.
Et puisque les sacramentaux sont dépendants de l’ordre sacramentel, il faut considérer la benedictio novi militis en lien avec la confirmation. En effet, « par le sacrement de Confirmation, leur lien (celui des baptisés) avec l’Église est rendu plus parfait, ils sont enrichis d’une force spéciale de l’Esprit Saint et obligés ainsi plus strictement à répandre et à défendre la foi par la parole et par l’action en vrais témoins du Christ », dit le concile Vatican II.[41] On voit ainsi que la force spéciale peut être donnée de façon elle aussi spéciale à celui qui fait profession de répandre et défendre la foi : c’est en vertu du baptême et de la confirmation que les laïcs sont députés à l’apostolat.[42]
2.2.2. Miles
Celui qui est ainsi béni est un miles. On doit remarquer deux choses à l’utilisation de ce terme. La première est qu’il y a là un écho à l’expression de Saint Paul sur le bonus miles Jesu Christi (2 Tim 2, 3) et une allusion à l’enseignement des clercs depuis les temps mérovingiens à l’intention des soldats. Il y avait en effet grande nécessité de moraliser la vie militaire à l’époque mérovingienne, comme d’ailleurs après l’effondrement de l’Empire Carolingien.
La seconde est qu’il est question de miles (soldat), non d’eques (cavalier) :or, nous l’avons vu, la culture romaine classique n’a pas disparu avec l’empire, et à Rome plus qu’ailleurs on avait des raisons de se souvenir des equites romani, ces citoyens romains assez riches pour payer l’équipement du cheval qui leur était fourni par la res publica. Ces cavaliers romains avaient d’ailleurs, en fonction de leur richesse, un rôle non négligeable dans les affaires publiques, à côté du Sénat. Donc ce n’est pas pour rien que le rite ignore si celui qui le reçoit combattra à cheval ou non. Cela démontre que pour l’Eglise celui qui reçoit la grâce de l’adoubement ne change pas de condition sociale. A l’origine, les chevaliers se recrutent dans tous les milieux, même très humbles : au Xème siècle on constate l’adoubement de serfs.[43] Cependant il est vrai que de fait les milites ainsi adoubés constituent un groupe à part et le latin médiéval met en valeur d’autres termes pour désigner les combattants non adoubés : pugnatores ou bellatores (de pugna, le combat, et bellum, la guerre).
Il était important de relever ce fait, puisque dans les langues romanes le mot désignant le chevalier est un mot dérivé de cheval. On a caballero en espagnol, cavaliere en italien, cavaleiro en portugais. Ces mots ont donc dû apparaître à haute époque, avant la fragmentation du roman en diverses langues.[44] Or le phénomène se retrouve un peu différemment en allemand, où le terme Ritter est dérivé d’un mot signifiant non pas cheval, mais aller à cheval (reiten) ; on le retrouve en hollandais, avec ridden. On trouve cependant une exception notable, l’anglais, où le chevalier est appelé knight, et on y reviendra en parlant de la chevalerie tardive.
2.2.3. Novus
Le mot novus doit se comprendre de plusieurs façons. D’abord il montre que le soldat en question est plutôt un jeune homme. En ce sens on retrouve ce qui se faisait chez les Germains : il s’agit de donner une mission, non de récompenser des services. Le jeune chevalier est nouveau comme le jeune religieux qui entre dans une vie nouvelle.
Mais surtout ce mot, au plan spirituel, est un écho de l’expression homo novus de Saint Paul (Eph 4, 24) :de même que le baptisé est renouvelé totalement dans son être, à l’image du Christ, de sorte que tout son comportement s’en trouve changé, ainsi le miles ne peut pas combattre pour n’importe quelle cause ni n’importe comment. Saint Augustin, l’auteur le plus lu dans l’Occident médiéval, fait un parallèle, entre le commandement nouveau (Jn 13, 34) et le chant nouveau de l’Apocalypse (14, 3).[45] On peut bien y ajouter le parallélisme avec l’homme nouveau, car le chant nouveau est un chant de victoire, en sorte que par le nom du sacramental qu’il reçoit, le miles est encouragé à appliquer le commandement de l’amour pour obtenir la victoire dans le monde à venir. Une perspective eschatologique devient ainsi manifeste.
2.2.4. Le rite
Il serait intéressant, mais un peu hors des limites de cette étude, de pouvoir comparer le rituel de l’adoubement liturgique avec celui du sacre du roi ou de l’empereur.[46] On le trouve dans les livres liturgiques, mais il n’est pas décrit dans des ouvrages où on aurait pensé l’y trouver.[47]
On a déjà évoqué dans ce rite la colée et la remise de l’épée : l’Eglise d’une part valide le rite germanique de remise des armes, mais l’insère dans un contexte qui en change la nature en le haussant à une sorte de supplément à la confirmation. Mais autour de ces deux actes principaux du rite, on a divers éléments traditionnels destinés soit à en faire comprendre la portée, soit à en permettre une réception plus fructueuse. On peut suivre ici le livre Le Christ chevalier, de l’abbé Bruno Pin, entièrement consacré à la spiritualité chevaleresque.[48] Il montre que celle-ci conforme au Christ, et il s’appuie pour sa démonstration sur les éléments du rite de l’adoubement.
La veillée d’armes rappelle les nombreuses nuits passées par le Christ en prière : le futur chevalier prie dans un sanctuaire toute la nuit qui précède son adoubement. L’épée qui servira à son adoubement est alors posée sur l’autel. Au matin il prend un bain, qui rappelle son baptême. Pour l’abbé Pin, l’adoubement liturgique est une investiture qui est pour le chevalier ce que le baptême au Jourdain fut pour le Christ.
Notons enfin que le choix des psaumes accompagnant le rite est très parlant pour les chevaliers : accingere gladium super femur tuum, potentissime (Ps 44 (45), 4) ou encore : cadent a latere tuo mille… ad te autem non appropinquabit (Ps 90 (91), 7).
- L’âge d’or de la chevalerie
Vers l’an mil, l’institution chevaleresque n’a pas encore atteint son apogée. Celle-ci peut se situer au XIIème siècle. On observe en effet un phénomène particulier : il y a un moment où les nobles font suivre leur titre nobiliaire de la mention de chevalier s’il y a lieu ; puis un moment où on ne conserve que la mention de chevalier, qui éclipse ainsi le titre de noblesse ; enfin le titre nobiliaire reprend sa place, et même toute la place. Il est possible que l’intervention de l’Eglise dans le rite de l’adoubement soit pour beaucoup dans le prestige de la chevalerie à ce moment où elle paraît plus importante que la noblesse. Ce fait a été mis en lumière par Georges Duby dans ses recherches sur la période des XIème et XIIème siècles.[49] Cette évolution s’est d’ailleurs produite à des périodes différentes selon les régions.[50]
On peut regretter cet accaparement de la chevalerie par la noblesse, qui ne correspond pas à l’intention de l’Eglise, et qui risque de faire de l’adoubement un rite d’accession à un statut social supérieur. Il reste que ce qu’on exige moralement d’un noble, on doit aussi l’exiger d’un chevalier.
Or à l’époque où ceux qu’on nomme chevaliers dominent la vie sociale en Occident, cinq facteurs vont modifier la perception de ce terme et transformer la mentalité et donc la spiritualité de ceux qui portent ce titre : la mentalité courtoise, la croisade, la naissance des ordres de chevalerie, l’apparition de l’ordre cistercien ainsi que le cycle arthurien et la légende du Graal.
3.1. L’âge courtois
La littérature courtoise a été un moment important dans la pensée occidentale. Certainement la dévotion mariale du peuple chrétien a fait beaucoup pour faire considérer la femme pour ce qu’elle est selon la Révélation chrétienne. L’évolution du vocabulaire à l’époque du Haut Moyen-Âge a pu retarder cette prise de conscience, car quand la formation de l’Antiquité classique n’a plus été reçue systématiquement par ceux qui accédaient à l’épiscopat, on a commencé à utiliser le mot homo à la place de vir, ce qui a pu conduire à exclure d’une façon ou d’une autre les femmes du genre humain, et cela au moment où le mot animus (masculin) cédait la place au mot anima (féminin). Mais la littérature courtoise permet de reconsidérer la dignité de la femme et de la traiter selon ses aspirations. La délicatesse retrouve ses droits dans la culture militaire des chevaliers.
Au plan spirituel, outre la dévotion mariale qui prend une tournure particulière comme on le verra à propos de l’Ordre de Cîteaux, il faut voir qu’il s’agit d’une mise en valeur de la béatitude des doux. On se trompe souvent à ce sujet. Il ne s’agit pas de faiblesse. Au contraire la douceur évangélique est la marque d’un amour dont la force extrême lui permet de s’autocontrôler et de s’adapter exactement à la nature et à la psychologie de son objet. La maîtrise de soi qu’exige le métier de chevalier y trouve son compte.
Les chroniqueurs des croisades représentent souvent la douleur du croisé quittant femme et enfants.[51] On voit là la grandeur de la force de l’amour, qui permet de passer de l’amour familial à l’amour de la chrétienté. C’est au sein de la famille que se forge une âme chevaleresque.
3.2. Les croisades
Quand Urbain II lance la croisade au concile de Clermont, la lutte contre les musulmans est déjà une habitude de la chevalerie franque. On peut en faire remonter l’origine à Charles Martel à Poitiers en 732 ou aux combats de Charlemagne, franchissant les Pyrénées puis récupérant la Septimanie. Toujours est-il que de nombreux chevaliers passent régulièrement en Ibérie pour porter secours aux Espagnols et aux Portugais engagés dans la Reconquista. Le propre fondateur de la dynastie royale portugaise, est Henri de Bourgogne, un descendant d’Hugues Capet. On peut encore citer parmi ces preux Rotrou III, seigneur du Perche, ou Guillaume IX d’Aquitaine. De plus le propre frère de Raymond de Saint Gilles, comte de Toulouse, qui deviendra comte de Tripoli à la faveur de la première croisade, avait mis son épée au service du Basileus : sans doute celui-ci avait-il en vue ce genre d’aide que l’Occident pouvait lui apporter – des mercenaires, pas des armées constituées – quand il lança son appel au Pape.
Mais la Croisade va devenir une véritable institution.[52] Les Papes promettront des indulgences à ceux qui feront le vœu de croisade, étendront leur protection à leurs biens pendant leur absence, etc. Le salut éternel est promis à qui meurt en croisade, comme si cette mort équivalait à un martyre et Léon IV proclame : « Quiconque sera mort fidèlement dans ce combat, les royaumes célestes ne lui seront pas refusés », car « le Tout-Puissant sait que si l’un d’entre vous meurt, il sera mort pour la vérité de la foi, le salut de la Patrie et la défense des chrétiens. »[53] C’est peut-être à cela que les croisés pensaient en adoptant la croix comme insigne montrant leur appartenance à la croisade : mourir en croisade, c’est entrer dans la Jérusalem céleste, comme le suggère Joinville, qui dit de Saint Louis qu’il est mort comme le Christ, « en la croix » : coudre la croix sur son habit configure au Christ en sa passion.
La chevalerie acquiert alors un but nouveau : Jérusalem. La défense de la chrétienté prend une dimension nouvelle : au maintien de l’existant, pourrait-on dire, s’ajoute la défense des droits de l’Eglise hors du territoire contrôlé par ses membres. Et pour les croisés, l’Eglise a le droit de posséder les Lieux Saints, ceux où le Christ a passé sa vie terrestre, ceux où se sont réalisées l’incarnation, la passion, la résurrection, l’ascension et la Pentecôte, ils doivent être domaines de chrétienté. On s’était accommodé, de plus ou moins bon gré, de la domination musulmane sur les Lieux Saints, mais on ne pouvait plus la tolérer quand elle se durcissait au point de rendre quasi impossible les pèlerinages en Terre Sainte. On a pu définir les croisades d’Orient comme des pèlerinages armés, et c’est sans doute une assez juste façon de rendre compte de ce que pensaient les croisés.
Or les croisés ont conscience de combattre sur les lieux mêmes où les combattants de l’Ancien Testament ont combattu. Cela explique d’ailleurs peut-être certains des abus de la première croisade, où les massacres ne manquent pas, comme on voit que cela s’est produit au livre de Josué, quand les guerriers hébreux, mal sortis de la préhistoire et encore peu imprégnés d’une Révélation qui va se déployer sur plus d’un millénaire, pensaient offrir à Dieu un sacrifice agréable en éliminant tous leurs ennemis.[54] Mais de cette situation, où les croisés mettaient leurs pas dans ceux des soldats de David ou des Maccabées, on peut imaginer que comme eux ils pensaient recevoir l’aide directe de Dieu : c’est le Prince des milices célestes, que l’Apocalypse identifie à Saint Michel, qui intervient pour indiquer à Josué comment il prendra Jéricho (Jos 5, 14). De là on peut conclure que tous les combats pour Dieu ne forment en réalité qu’un seul et même combat, depuis le combat des origines où les Anges de Saint Michel chassent du ciel les anges ayant suivi Lucifer, jusqu’aux combats des derniers temps dont parle l’Apocalypse.
Et c’est valable pour le combat spirituel de chaque chrétien : il se livre dans le prolongement du combat des Anges. La croisade, précisément, fera comprendre cela aux chevaliers : quand les croisés subissent un revers, on attribue leur défaite à leurs péchés.[55] Saint Bernard formulera ce rapport entre le combat matériel et la lutte spirituelle en disant des Templiers : « Oui, c’est une milice d’un nouveau genre, inconnu aux siècles passés, destinée à combattre sans relâche un double combat contre la chair et le sang et contre les esprits de malice répandus dans les airs. (…) Le soldat qui revêt en même temps son âme de la cuirasse de la foi et son corps d’une cuirasse de fer, ne peut point ne pas être intrépide et en sécurité parfaite ; car, sous sa double armure, il ne craint ni homme ni diable. »[56]
Mais Jérusalem va bientôt devenir un objectif inaccessible. La réussite de la première croisade relève du miracle, si l’on tient compte de l’échec des deux expéditions suivantes, pourtant numériquement comparables, celles dirigées par Raymond de Toulouse et Guillaume IX d’Aquitaine. Ce miracle de la première croisade peut s’expliquer en partie : les alliés byzantins connaissaient le terrain, qui était le leur encore peu de temps avant, et ils ont accompagné les croisés jusqu’à Antioche, qu’ils n’avaient perdue qu’une trentaine d’années plus tôt ; leurs conseils sont sans doute pour beaucoup dans la victoire de Dorylée, où l’armée franque s’était opportunément flanc-gardée. Mais cette victoire, qui a ouvert à la croisade la traversée de l’Anatolie, est due sans doute aussi à une sous-estimation par les Turcs des capacités militaires des Occidentaux, dont ils avaient eu une piètre démonstration lors de la croisade des Pauvres Gens : dans cette hypothèse, celle-ci n’a pas été totalement inutile.[57] Mais quand la route de l’Anatolie fut devenue impraticable aux armées croisées, celles-ci devront se faire transporter par mer, et donc dépendre des républiques italiennes, avec les inconvénients que l’on vit lors de la quatrième croisade, qui au lieu de combattre les musulmans a combattu des chrétiens ![58]
En tout cas, Jérusalem devenue inaccessible, la spiritualité chevaleresque va devenir plus profonde. La quête du chevalier tend à se confondre avec la recherche de Dieu, et c’est probablement ce qui explique le succès du thème du Graal dans la littérature chevaleresque. On est passé du désir de voir Jérusalem sur terre au désir de la Jérusalem céleste, de l’au-delà des mers à l’Au-Delà tout court.
On ne peut pas passer sous silence les Croisades tardives. Il faut préciser que la croisade est une réalité analogique, qui a pris des visages divers. Les croisades au sens fort sont les croisades d’Orient. Celle des Albigeois ou les expéditions d’Europe du Nord, si elles ont pu être justifiées au plan du droit de la guerre juste, ont du moins dévié en recourant aux conversions forcées. Or dès le Moyen-Âge l’Eglise condamnait ces faits. Peut-être faut-il voir dans ces déviations une contamination des consciences chrétiennes par l’islam, car les responsables de cette religion recommandent les guerres en vue de la conversion de ceux qu’ils considèrent comme infidèles, tandis que dans l’histoire de l’Eglise ce genre de fait est rare et a lieu toujours sur décision du politique au titre de l’ordre public, comme on le voit chez un Saint Marcellin contre les donatistes[59] ou chez un Charlemagne contre les Saxons.
3.3. Les ordres de chevaliers religieux
Bien qu’ils doivent leur origine aux croisades, les ordres religieux militaires méritent d’être traités à part, étant donné leur apport à la spiritualité chevaleresque.[60] La notion d’ordre est un concept analogique.[61] Il s’agit soit de classer en fonction d’un premier, soit de considérer une portion du résultat de ce classement. La communauté chrétienne s’ordonne en fonction du Christ, mais de cet ordonnancement résultent des groupes de fidèles qui sont dans le même rapport au Christ. Dès les temps mérovingiens, la communauté des fidèles se pense en fonction de deux ordines principaux : l’ordo presbyterorum (et cette expression se retrouve jusqu’à Vatican II) et l’ordo militum.[62] On retrouve là les groupes des prêtres-législateurs et des guerriers des civilisations indo-européennes. On y ajoute aussi un ordo monachorum. Les ordres religieux militaires sont à penser dans ce double cadre, ils sont à la fois moines et soldats.[63]
Leur apport à notre sujet est donc de placer les conseils évangéliques à l’intérieur même de la spiritualité chevaleresque. Ce que le chevalier, même non religieux, vit en respectant le code d’honneur et les lois de l’Eglise sur l’usage des armes, en exposant sa vie à l’imitation du Christ pour la protection de l’Eglise et la promotion de la chrétienté, il peut le pratiquer à la façon d’un religieux. Son engagement dans la vie de chevalier est une oblation de lui-même à Dieu ; et en risquant sa vie sur les champs de bataille il va d’une certaine façon plus loin que le religieux.
Nés du souci de soigner les pèlerins parvenus jusqu’à Jérusalem, les premiers membres de ces ordres ont eu bientôt à cœur de les escorter depuis les ports de Palestine et de les y reconduire. Sans jamais perdre de vue leur vocation hospitalière, ils verront leur vocation militaire prendre un essor considérable au temps des croisades. Il y a là une leçon d’une brûlante actualité : la défense de l’Eglise sera d’autant plus efficace qu’elle s’enracine davantage dans l’activité caritative concrète. L’ordre du Temple ne survivra pas à la période des croisades d’Orient, le procès inique qui lui a été fait et sa disparition brutale ne cessent pas de frapper les imaginations, et à côté d’études sérieuses les concernant on trouve toute une littérature fantaisiste voire ésotérique, ou même franchement alimentaire quand un auteur prétend savoir où se trouve leur trésor ![64] L’Ordre de Saint Jean de Jérusalem, connu sous le nom d’Ordre de Malte,[65] a continué le combat contre les musulmans par la guerre de course en Méditerranée Orientale ; leur défense héroïque lors du Grand Siège a permis le sursaut de l’Occident et la victoire de Lépante. Les livres ne manquent pas au sujet de cet ordre prestigieux.[66]
L’Ordre des Chevaliers Teutoniques est apparu plus tardivement ; on peut voir dans l’hospice des chevaliers allemands de Jérusalem au temps des croisades d’Orient le germe de cet ordre, mais la fondation de l’ordre lui-même est postérieure d’un siècle environ à celle des chevaliers du Temple ou de Saint Jean. Sans doute faut-il voir dans l’héritage de Charlemagne, qui dut pour pacifier les Saxons les forcer à embrasser la religion chrétienne, une raison de ses déviations lors de la lutte contre les Baltes païens ou les Slaves orthodoxes, ou lors du passage de cet ordre presque en entier à la Réforme protestante.[67]
Et les ordres religieux militaires auront une postérité dans les ordres princiers de la période tardive. L’Ordre de Saint Lazare[68], qui doit son nom au fait qu’il était spécialisé dans le soin aux lépreux en Terre Sainte et qui s’est adjoint une milice vers 1200, en est une illustration, dont il faudra parler en traitant de la chevalerie tardive.
3.4. Cîteaux
C’est de son propre fond de mentalité chevaleresque que Saint Bernard puise l’enseignement qu’il donne aux chevaliers de Temple sur le lien entre le combat par les armes pour le royaume de Dieu et le combat spirituel personnel : « participer à la victoire du Christ » est le but de toute vie chrétienne. C’est ce que dit Dom Jean Leclercq : « Nous entrevoyons à quel point il était resté un guerrier. Non pas un belliciste. Mais il aimait parler de lutte ; son auditoire l’aimait aussi et avait besoin qu’on le fît : car tous ces anciens chevaliers étaient désormais engagés dans une bataille qui devait les faire participer à la victoire du Christ… Dans la réalité quotidienne toujours lutte il y a. On doit se battre tout au long du chemin… On a parlé de la « violence des pacifiques » ; mais elle suppose d’abord que les violents eux-mêmes aient trouvé la paix, au prix d’une lutte continue, non contre eux-mêmes, mais contre ce qui, en eux, s’oppose à l’œuvre de l’Esprit. Ce n’est pas là une utopie, un rêve inaccessible. Bernard suppose toujours qu’il peut être réalisé. Tâche sérieuse, difficile, mais non décourageante. Certes, toujours c’est la bataille, mais c’est toujours également la victoire. Presque jamais Bernard n’envisage la défaite. A chaque fois qu’il y a blessure, il y a guérison (…) Bernard avait l’art d’être encourageant. »[69] Commentant le Prophète Habacuc, Saint Bernard explique : Et nos ergo, fratres, obsecro, super custodiam nostram stemus, quoniam tempus militiae est (et donc, nous, frères, je vous en prie, tenons-nous sur notre garde, car c’est le temps de la milice) – militia signifie le temps de guerre, le temps qu’on passe sous les armes ou en service, autant que l’armée elle-même.[70]
Mais c’est sous la bannière de la Vierge Marie que militent les cisterciens. La dévotion mariale de Saint Bernard n’est pas à démontrer. Et c’est aux cisterciens qu’on doit la façon populaire de parler de la Sainte Vierge comme de « Notre Dame ». La dame, c’est la suzeraine. On ne combat vraiment pour le royaume de Dieu qu’en se soumettant à celle qui en est la reine. Elle est dite « victorieuse de toutes les batailles de Dieu », parce que d’une part la vérité sur son rôle est garante de l’orthodoxie au sujet de l’incarnation, et d’autre part parce que son intercession lors des grandes luttes pour la protection de la chrétienté a souvent été décisive, comme à Lépante. Avec Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, cette perspective va prendre une dimension particulière et avec Saint Jean-Paul II elle va devenir dévotion de toute l’Eglise.
Et ce n’est pas un hasard si dans la Quête du Graal de Chrestien de Troyes les abbayes sont toutes de « blanches abbayes », c’est-à-dire des abbayes où l’on porte l’habit blanc des cisterciens.
3.5. Le cycle du Graal
L’Âge d’Or de la chevalerie voit naître à côté de la poésie courtoise un phénomène littéraire qui va marquer l’Occident durablement, c’est la littérature autour de la figure du Roi Arthur et du cycle du Graal. Ces œuvres sont souvent de peu d’intérêt spirituel, et les romans de chevalerie qu’au XVIème siècle un Saint Ignace de Loyola, au cours de la convalescence précédant sa conversion, va demander à lire pour tuer le temps, méritent très peu leur nom. C’est que le cycle de la Table Ronde a de nombreux inconvénients. « L’esprit d’aventures y éteint l’esprit des croisades… Il nous a enlevé notre antique objectif, qui était le tombeau du Christ… Aux austérités du surnaturel il a substitué le clinquant du merveilleux. »[71] Cependant le Perceval ou le Conte du Graal de Chrétien de Troyes ne manque pas d’éléments spirituels.[72]
Le Roi Arthur est un symbole christique. Les hypothèses sont variées sur le personnage qui est à l’origine de la légende. Dernièrement on a pensé que ce fut un officier romain, plutôt qu’un roi celtique ; en tout cas il est mort au combat en défendant contre les envahisseurs païens, Angles ou Saxons, des populations bretonnes récemment christianisées. Son épitaphe note Hic jacet Arthurus, rex quondam rexque futurus (ci-gît Arthur, roi autrefois et qui sera roi), comme si son retour annonçait le triomphe final de la vraie religion dans son ancien royaume, ce qui en fait une image du retour glorieux du Christ à la fin des temps. Les chevaliers vont reconnaître dans ce personnage littéraire un modèle pour eux qui défendent la chrétienté. Et le mythe de la Table Ronde, dont la forme manifeste que ceux qui y délibèrent sont tous égaux, reflète l’idéal de la chevalerie où, quand il s’agit du code d’honneur, le juge n’est pas forcément le plus haut dans la hiérarchie sociale.
Plus intéressant encore est le vase appelé Saint Graal que cherchent les chevaliers du roman. Il semble bien qu’on ait là la christianisation d’un mythe celtique, celui du chaudron d’abondance. Quoiqu’il en soit, il est présenté comme le vase où Joseph d’Arimathie aurait recueilli le sang coulant du côté du Christ en croix : on peut y voir un symbole eucharistique. Chercher ce vase est l’œuvre suprême d’une vie, en le voyant on meurt. La quête du chevalier qui le mène vers Jérusalem est transfigurée en une quête de Dieu lui-même, dont plusieurs personnages de l’Ancien Testament pensent qu’ils ne peuvent le voir sans mourir.[73] C’est pour le chevalier comme une forme d’Ascension : voir Dieu suffit à conclure une vie. En tout cas, cette forme de spiritualité est à mettre en rapport avec le fait qu’elle se développe à l’époque où l’on institue l’élévation de l’hostie à la messe,[74] et où l’on va commencer à faire des expositions du Saint Sacrement : la dévotion chevaleresque est en prise directe avec les aspirations du peuple chrétien. La quête du Graal explique donc au chevalier quels écueils il doit éviter et quels renoncements il doit opérer pour atteindre le but de sa vie.
- La chevalerie tardive
A la Renaissance le prestige de la chevalerie demeure intact, on le voit à l’adoubement par Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, du roi François Ier en personne au soir de la victoire de Marignan. L’adoubement est laïc, on ne saurait adouber liturgiquement un roi qui a été sacré liturgiquement. Mais cela montre que l’adoubement a changé de signification : avant, il donnait une mission et des devoirs ; à présent il vient consacrer la valeur de celui qui le reçoit comme une récompense. Il devient une distinction dont on arborera les insignes.[75] Il s’agit d’une dénaturation de l’idéal originel, même si l’on a toujours eu à cœur de vérifier que l’impétrant avait les qualités requises pour être à même d’accomplir sa mission.[76]
Ce changement est dû à divers facteurs. D’abord le morcellement de la chrétienté en plusieurs nations – le sentiment national apparaît durant la guerre de cent ans – ne pouvait qu’influencer la chevalerie. Ensuite la noblesse s’est renouvelée, dès la fin du Moyen-Âge : des seigneurs habitent non des lieux fortifiés mais des maisons de ville où ils ont des fonctions judiciaires. Surtout le pouvoir royal a progressivement mis fin au système féodal. Et la croisade n’est plus qu’un souvenir, même si elle demeure toujours le but ultime de la diplomatie du Souverain Pontife.
La condition même du combattant à cheval n’est plus ce qu’elle était : l’épisode de Courtrai en 1302[77] démontre aussi que la cavalerie n’est plus l’arme absolue, puis l’archerie anglaise a maintes fois donné la victoire à son roi contre la chevalerie française, et surtout l’apparition des armes à feu permet à presque n’importe qui, sans grand entraînement, d’abattre le plus preux des chevaliers.[78] La défaite de François Ier à Pavie en est un exemple frappant qui efface Marignan : alors que le maître de son artillerie lui avait donné la victoire, il a cru pouvoir la parachever par une charge… qui passant dans le champ de tir de ses canons, a permis à ses adversaires de reprendre l’avantage. Le code d’honneur en est bien sûr affecté : là où l’on professait de ne jamais reculer, il faut apprendre à manœuvrer !
Dans ce contexte, faut-il parler de décadence de la chevalerie ? A certains égards il y a bien décadence. Mais on peut aussi considérer que la chevalerie acquiert à cette période des caractéristiques qui ne sont pas sans valeur y compris pour le présent. De même que l’expression d’Antiquité Tardive corrige avantageusement l’idée de décadence romaine, ainsi on peut parler de chevalerie tardive.
4.1. De nouveaux ordres de chevalerie
C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre le glissement qui s’opère dans les ordres de chevalerie. La croisade terminée, et au moment où l’esprit de croisade s’éteint, ils risquent de perdre de leur légitimité aux yeux des puissants, qui peuvent convoiter leurs richesses, et cela d’autant plus que, la féodalité passée elle aussi, les puissants sont de plus en plus forts : L’Ordre du Temple en fera les frais sous le roi Philippe IV le Bel et le Pape Clément V. La souveraineté sur Rhodes puis Malte des chevaliers de Saint Jean de Jérusalem, ainsi que leur incessante guerre de course en Méditerranée, leur admirable résistance contre les Turcs venus les assiéger à demeure en 1570, tout cela leur conserve une pleine légitimité aux yeux de tous.
Mais d’autres ordres se trouvent des protecteurs. Les chevaliers de Saint Lazare en sont peut-être l’exemple le plus frappant : ils ont été sécularisés en 1772 par le Pape Clément XIV et on peut y voir l’effet d’une trop grande sujétion à la famille royale de France. Suite aux aléas de la Révolution Française ils se placeront sous la protection du Tsar de Russie, admettront parmi eux des orthodoxes et ensuite même des protestants.
Dans ce contexte, les souverains eux-mêmes se mettent à fonder des ordres à leur dévotion, en grand nombre. Il y a la Toison d’Or pour la Maison de Bourgogne, l’Ordre du Saint Esprit pour la Maison de France, etc. Toutefois, ces ordres, même dépendants des princes, restent considérés comme proches des institutions religieuses. On le voit au sous-titre que Migne donne à son dictionnaire des ordres religieux : il s’agit du « Dictionnaire des ordres religieux, ou histoire des ordres monastiques, religieux et militaires… » : il n’y omet pas les ordres princiers.[79]
C’est que ces ordres, s’ils se réfèrent souvent à l’imaginaire du cycle arthurien et de la Table Ronde, gardent une dimension religieuse. Par exemple, les chevaliers de l’ordre du Croissant (fondé à Messine en 1448 par René d’Anjou et qui aura une existence éphémère), sont astreints à la récitation de l’office de la Sainte Vierge. L’ordre de l’Eléphant, au Danemark où ce pachyderme n’est pas courant, est ainsi nommé par dévotion mariale : l’éléphant blanc, symbole de pureté, est souvent associé à la Vierge Marie… Ces fondations d’ordre sont donc pour une part à mettre en perspective avec la fondation d’Abbaye et d’évêchés par les princes.
4.2 Le service du Prince
Mais il faut voir dans ce service du prince un certain retour à l’Antiquité. Du côté germanique ou gaulois on a connu des guerriers comme les « antrustions » chez les Francs[80] ou les « ambacts » chez les Gaulois[81] qui au combat se tenaient alentour du chef et devaient se faire massacrer pour lui s’il le fallait. L’Antiquité romaine nous fournit aussi un aspect de ce retour au passé : à la fin de l’empire, les gouverneurs ne devaient plus porter la toge, mais la tunique avec ceinturon, c’est-à-dire un vêtement réservé jusque-là aux soldats, le mot militia perd son sens strictement militaire pour désigner toute fonction dans un service public.[82]
Car ces ordres princiers, s’ils ont eu d’abord une fonction militaire, par laquelle les Grands s’assuraient les services de moins nobles qu’eux mais qu’ils ne pouvaient négliger, en sont venus à une fonction administrative. Et là on retrouve un aspect de l’hommage médiéval. Cependant on n’entre plus dans ces ordres par l’adoubement, mais par l’imposition d’un collier. Toutefois la dimension religieuse de ce service explique la fierté qu’avait Saint Thomas More de son titre de chevalier, et la fidélité qu’il manifesta à son souverain : il lui a fait part en privé de sa réprobation, mais en public il remplissait loyalement sa fonction de chancelier du royaume d’Angleterre ; ce n’est que lorsque Henri VIII le forcera à se prononcer publiquement qu’il le fera – et méritera ainsi le martyre.
4.3 Particularités nationales
Cette étude a surtout porté sur la chevalerie franque ou française, mais bien sûr l’institution chevaleresque n’a pas eu partout le même visage. L’Allemagne a eu une évolution assez semblable à celle de la France – peut-être dans la continuation de l’empire carolingien, à ceci près que l’émiettement féodal ne fut pas aussi important qu’en France. Ailleurs on eut d’autres développements.
4.3.1. Knight : le chevalier anglais
Si l’histoire de l’Angleterre ne manque pas de modèles de chevaliers au sens où l’on a décrit la chevalerie jusqu’ici, comme on le voit à la figure de Richard Cœur de Lion[83], en fait le mot employé pour désigner celui qui a été adoubé n’est dérivé en anglais ni d’un mot signifiant soldat ni d’un mot en rapport avec le cheval. Knight vient du germanique Knecht, qui veut dire serviteur. C’est ainsi tout un programme chevaleresque qui se dévoile ainsi : les armes remises au jeune soldat font de lui non un maître agissant à son gré, mais un serviteur de la communauté qui les lui remet. Et dans la chevalerie tardive, c’est par le prince que la volonté de la communauté est exprimée.
4.3.2. Les cavaliers des républiques italiennes
Il y a bien en Italie, à l’âge d’or de la chevalerie franque, une caste de combattants à cheval, mais, peut-être du fait que l’idée royale est faible dans les républiques italiennes sans cesse en recherche d’autonomie par rapport à l’empereur romain-germanique, ce groupe social a très peu de traits communs avec la chevalerie ailleurs en Europe. Ce sont plutôt des chefs d’entreprise au sens économique du terme, qui mettent leur épée au service d’une république ou d’une autre, avec un ensemble de dispositions légales qui leur permettent d’être indemnisés en cas de pertes, mais qui gardent pour eux le bénéfice du butin. On comprend de la sorte que des condottières aient pu venir tenter leur chance en descendant d’Allemagne vers les terres d’empire au Sud des Alpes. Il y a eu une période où ces groupes de cavalieri ont dominé la politique des républiques, mais ce ne fut que l’espace de quelques décennies.[84]
4.3.3. L’exception ibérique
Le contact permanent avec les musulmans et les guerres de ce qu’on a appelé au XIXème siècle la Reconquista (celle-ci s’étant terminée peu après la fin des états francs de Syrie), ont fait que la chevalerie a pris un tour particulier au Portugal et en Espagne. Par exemple les Ibériques étaient dispensés de la croisade d’Orient. A l’occasion, le Pape a promulgué une croisade destinée à l’Espagne. Mais aussi, les ordres princiers s’y sont développés très tôt : le roi Alfonse Ier du Portugal, qui a fait venir les Templiers dans son royaume très peu de temps après leur fondation, est aussi le fondateur d’un ordre national. Divers ordres, dont le plus célèbre est celui de Calatrava naissent aussi en Espagne : ils passeront progressivement sous l’autorité des souverains, s’ils n’ont pas été fondé par lui.[85] Mais on voit l’inconvénient d’ordres religieux militaires nationaux : dans les luttes fratricides entre l’Espagne et le Portugal, ils seront en guerre les uns contre les autres.
4.3.4. La preuve par le Congo
Un fait peu connu montre néanmoins que cette chevalerie reste imbue des valeurs de défense de l’Eglise et de la foi, c’est la mentalité des chevaliers du royaume du Congo. Lorsque Diogo Cao, en 1483, parvient à l’embouchure du fleuve Congo, il y trouve un royaume constitué, qu’avec ses compatriotes il s’emploie à christianiser. Le Roi envoie son fils étudier au Portugal en vue du sacerdoce ; revenu évêque, il ne se réacclimate pas et meurt bientôt. Ce qui importe pour notre propos, c’est que les Portugais appliquent aux vassaux du roi du Congo les titres nobiliaires en usage en Europe, et surtout que parmi eux ils nomment des chevaliers de l’ordre portugais du Christ au nom du roi du Portugal. On va les appeler les nekava, « ne » étant un préfixe pluriel en kikongo, et « kava » étant une déformation de caballeros. Or au bout de quelque temps, secouant le droit de patronage du Portugal, envoyant un ambassadeur à Rome, le roi du Portugal nomme de son propre chef des chevaliers. On peut voir l’attachement du roi aux valeurs chevaleresques au fait suivant. Les Hollandais, profitant d’un moment où les royaumes du Portugal et d’Espagne sont réunis, et où les Espagnols au pouvoir ne se soucient pas de défendre les colonies portugaises, envoient des émissaires au Congo pour le protestantiser. Et c’est en brandissant son épée que le roi fait devant eux une profession de foi catholique et les renvoie bredouilles.[86]
4.4 La spiritualité chevaleresque tardive
On peut attribuer à la chevalerie tardive certaines méditations des exercices de Saint Ignace. On sait que celui-ci fut un vaillant soldat appréciant les « romans de chevalerie » avant sa conversion ; après celle-ci, il se représente le monde comme le lieu de l’affrontement de deux camps, entre lesquels il faut choisir : c’est ce qu’exprime la célèbre méditation des deux étendards.[87] De même, toujours en Espagne, on trouve chez Ste Thérèse d’Avila des échos de la période des chevaliers.[88]
Enfin, lorsque Saint Louis-Marie Grignon de Montfort fait faire à ses disciples leur consécration à la Sainte Vierge « devant toute la cour céleste », il pense peut-être à la cour de Louis XIV, mais que la Dame de cette cour soit la Vierge Marie, est une trace de la spiritualité mariale des chevaliers devenus cisterciens.
5.– Renouveau de cette spiritualité
5.1. Le XIXème siècle
Les gens de la Renaissance ne voyaient le Moyen-Âge que comme une période de barbarie, et l’institution chevaleresque y a commencé une éclipse, qui s’est prolongée durant toute la Période Moderne. Il est à mettre au crédit du romantisme d’avoir en partie réhabilité le Moyen-Âge, et la chevalerie va y trouver son compte.
Au plan littéraire, entre autres, Victor Hugo publie La légende des siècles et Notre Dame de Paris, Austin Thierry les Récits des temps Mérovingiens, etc. ; la querelle des Anciens et des Modernes montre que ceux-ci voient dans le Moyen-Âge leur civilisation propre, celle du classicisme n’étant qu’un décalque de civilisations étrangères, grecques et romaines. En architecture, Viollet Le Duc fait ressortir la grandeur de Moyen-Âge. C’est dans ce contexte que Kenelm Digby et Léon Gautier, écrivent leurs livres respectifs sur la chevalerie, au début et à la fin du XIXème siècle.
A cette époque où l’Ordre de Malte se remettait de la perte de son île, l’ordre du Saint Sépulcre se constituait dans sa forme actuelle. Depuis des siècles, de nombreux jeunes chrétiens allaient à Jérusalem se faire adouber par le gardien catholique du Saint Sépulcre et formaient des sortes de confréries à leur retour en Occident. C’est le bienheureux Pie IX qui les constitua en Ordre, ce qui montre que dans le climat créé en Europe par la Révolution française, il pensait que l’institution chevaleresque retrouvait de son actualité.
Autre signe de l’actualité de la chevalerie, la Militia Christi, dont les origines remontent à des compagnons de Saint Dominique, se reconstitue en 1870, après la perte des États Pontificaux, sous l’impulsion du comte Arthur de Beaumont, ancien colonel de l’armée pontificale, et avec l’aide du RP Jandel, Maître des dominicains, avec les encouragements de Pie IX.[89]
5.2. Le XXème siècle
Le renouveau amorcé au XIXème siècle se poursuit au XXème, notamment au plan des études historiques avec les auteurs dont nous avons parlé, comme Régine Pernoud, Jean Flori, Georges Duby, Dominique Barthélémy, et tant d’autres. Au plan spirituel, l’instauration de la solennité du Christ-Roi permettra d’approfondir le lien entre les chevaliers et le Christ.
Mais là encore le climat généré par la Révolution Française, avec tous ses développements nazis ou communistes, et plus récemment la culture de mort ou la théorie du gender, a suscité une réaction salutaire. Le Cardinal Daniélou publie peu avant mai 68 L’oraison problème politique,[90] où l’on trouve déjà ce que relèvera le Cardinal Ratzinger à propos de l’Exode et de sa motivation : les croyants doivent être libres pour offrir à Dieu un culte en Esprit et en vérité ; et nous avons vu que ce genre de réflexions a permis à l’Eglise de légitimer la chevalerie. Benoît XVI, en énonçant ses « points non négociables » se retrouve dans la ligne du clergé indoeuropéen qui dictait leur conduite aux guerriers.[91] Tout cela milite en faveur d’une nouvelle chevalerie. Elle ne maniera plus l’épée, mais en gardera le symbole dans ses rites, puisque, nous l’avons vu, l’épée dans le Nouveau Testament symbolise la parole du Christ, et c’est par la parole et les écrits qu’on lutte contre les idéologies.[92]
Du reste les mentalités restent marquées par la chevalerie. Le succès de films, dans des genres très divers, comme Excalibur ou Les visiteurs, ou d’œuvres littéraires comme celle de Tolkien, le prouvent abondamment.[93] Mais c’est vrai aussi dans le monde de la spiritualité. Le grand théologien Louis Bouyer s’intéressa au thème de la Quête du Graal et intitula un de ses romans Prélude à l’Apocalypse ou les derniers chevaliers du Graal.[94] Pendant la première guerre mondiale, on a développé une spiritualité de la mort au combat qui configure au Christ.[95] On retrouve cette spiritualité dans le poème de Péguy « Heureux ceux qui sont morts » ou encore dans la prière de l’Aspirant Zirnheld, parachutiste de la France Libre mort en Lybie en 1942.[96]
Entre les deux guerres, le Père Jacques Sévin sj, qui avait acclimaté le scoutisme dans le catholicisme français, pensa fonder un ordre de chevalerie, mais d’autres prêtres engagés dans le scoutisme l’en empêchèrent. Pourtant il se situe dans la droite ligne du fondateur du scoutisme : l’anglican franc-maçon Lord Baden-Powell, qui fut adoubé par le roi Georges V, a voulu proposer Saint Georges comme modèle aux scouts, et a reconnu l’influence de Kenelm Digby sur sa façon de concevoir la loi scoute.[97]
En 1945 Gérard Lafond, convaincu par la lecture de La chevalerie de Léon Gautier, fonde à l’abbaye de Saint Wandrille la Militia Sanctae Mariae, dite « Ordre des chevaliers de Notre Dame », qui sera érigée en pia unio par Monseigneur Michon, évêque de Chartres, en 1964. Et c’est à lui, Dom Marie-Gérard Lafond, qui est devenu ensuite Abbé de Wisques, qu’un grand nombre de jeunes gens doivent de s’être engagés à leur tour dans la quête chevaleresque. D’autres institutions, bien plus célèbres, associent la dévotion mariale à l’idée du combat : la Légion de Marie, fondée en 1921 par l’Irlandais Frank Duff, et surtout la Milice de l’Immaculée, fondée en 1917 par Saint Maximilien Kolbe.
Conclusion : actualité de cette spiritualité
Sans doute parce qu’elle est liée aux plus profondes racines de la civilisation occidentale, la chevalerie ne cesse de hanter l’imaginaire de nos contemporains, de passionner nos historiens, de motiver nos militaires et nos militants. Le code d’honneur est toujours d’actualité, et voici la version qu’en a donné Dom Lafond :
- Le chevalier combat pour le Christ et pour son règne.
- Le chevalier sert sa Dame la Vierge Marie.
- Le chevalier défend la Sainte Eglise jusqu’au sang.
- Le chevalier maintient la tradition de ses pères.
- Le chevalier combat pour la justice, l’ordre chrétien et la paix.
- Le chevalier mène contre le Monde et son Prince une guerre sans trêve et sans merci.
- Le chevalier honore et protège les pauvres, les faibles, les déshérités.
- Le chevalier méprise l’argent et les puissances de ce monde.
- Le chevalier est humble, magnanime et loyal
- Le chevalier est pur et courtois, ardent et fidèle.[98]
Pourtant la spiritualité chevaleresque est largement méconnue : elle n’est pas même mentionnée dans le Dictionnaire de la vie spirituelle récemment paru.[99] De même il n’est pas question de la chevalerie dans Passion, tourment ou espérance ? Histoire de l’Apostolat des laïcs, en France, depuis Vatican II de Ludovic Laloux.[100] Or justement les ordres de chevalerie se sont renouvelés selon l’enseignement de Vatican II sur l’apostolat des laïcs.[101] Et ils peuvent avoir un bel avenir, la dictature du relativisme ou le défi musulman l’exigent. Mais la chevalerie aura à continuer à se réformer.
Un certain Jean-Louis Lagor[102] appela de ses vœux, peu après la seconde guerre mondiale, une chevalerie qui s’affranchirait de tout rite et de toute institution, ne gardant que son esprit : « Nous entrerons en politique comme on entre en religion ! », proclamait-il. Sans doute faut-il y voir un péché de jeunesse, car sous un autre pseudonyme, celui de Jean Madiran, cet auteur n’a cessé, dans la deuxième moitié de sa vie, de défendre l’ancien missel, soulignant par là l’importance des rites. A contrario, on peut attribuer le fiasco presque total de l’Action catholique au fait qu’elle a manqué d’ancrage liturgique : elle a été conçue par les Papes pour exister dans des paroisses avec une forte vie liturgique, mais a perdu sa vigueur en se séparant de la vie paroissiale – qui, il est vrai, s’étiolait elle-même à l’époque. Pourquoi l’Église devrait-elle priver ses militants de la grâce du sacramental de l’adoubement ? C’est là que gît le lien entre la chevalerie et la liturgie.
De même, s’il est vrai qu’on peut recevoir l’adoubement sans appartenir à une institution, la sécularisation de notre monde plaide en faveur du rattachement de pratiquement tous les chevaliers à des institutions qui soutiendront leur vie spirituelle et où la fraternité d’armes sera bien précieuse non seulement pour l’efficacité de l’action pais aussi pour le réconfort au milieu des persécutions.
Une autre question qui se pose à l’institution chevaleresque aujourd’hui est la place des femmes. On devrait pouvoir considérer que l’appartenance de celles-ci à des ordres de chevalerie, même sans recevoir l’adoubement, en fait d’elles des membres à part entière, puisque dans l’ordre du Temple on n’avait pas besoin de l’adoubement ; il suffirait qu’elles fassent des vœux analogues à ceux des chevaliers – qu’il suffise ici d’évoquer Jeanne d’Arc ! La défense de la famille et de la vie étant au centre des « points non négociables », le rôle des femmes ne saurait être négligé dans le combat pour le Christ et pour son règne.
Le bienheureux Pie IX pensait que la chevalerie n’avait pas dit son dernier mot, on peut le penser aujourd’hui encore.
[1] Cardinal Joseph Ratzinger, L’Esprit de la liturgie, Ad Solem, Genève 2001, p.18.
[2] Vatican II, Dignitatis Humanae, n° 3.
[3] Somme théologique, IIa IIae 188,3. Ce raisonnement de Saint Thomas suppose un enseignement sur la guerre juste : Léon Gauthier reprend l’historique de la position chrétienne dès le premier chapitre de son ouvrage sur la chevalerie. Ce sujet sort des limites de la présente étude, mais il y est étroitement lié, or il est d’actualité comme on le voit aux publications récentes suivantes. 0n trouve un bon résumé de la pensée de l’Eglise dans l’article La guerre et la paix selon l’Eglise (des Evangiles au Concile) in Chevaliers, n° 2, octobre 1967, pp. 5 – 8 ; les juristes catholiques ont publié, sous la direction de Joël-Benoît d’Onorio, La morale et la guerre, chez Téqui en 1991 ; la revue Communio a consacré à La guerre son numéro 114 de juillet-août 1994 ; sur les conceptions anciennes du rôle du soldat chrétien, voir Philippe Henne, Servir Dieu dans l’armée, mourir pour le Christ ou pour l’empereur, Cerf, Paris 2017 ; voir aussi Jean-François Chemain, Bellum justum, aux origines de la conception occidentale de la guerre juste, Apopsix, Paris 2018 ; ou François-Régis Legrier, Si tu veux la paix, prépare la guerre. Essai sur la guerre juste, Via Romana, Paris 2018 ; et encore Renaud de Malaussène, Une guerre juste ? Du code de Hammourabi aux défis contemporains, réflexions sur l’éthique militaire, Alisio, Paris 2019. Curieusement Gaston Bouthoul dans son La guerre (collection Que Sais-je ? n°577, PUF 1973), est muet sur la guerre juste.
[4] Léon Gautier, La Chevalerie, pp. 296ss (1895, plusieurs fois réédité, on cite ici la réimpression de 1989). Il se base pour donner cette date sur un document découvert dans une bibliothèque romaine ; la probabilité pour que cette date soit la bonne est renforcée par la constatation qu’à cette époque la papauté recrute des milites Sancti Petri et s’adjoint des vassaux appelés fideles Sancti Petri ; Jean Flori, qui cite ces termes (La Chevalerie, éd. Jean-Paul Gisserot, Paris 2015, p.32) rapproche ce fait de la constitution au même moment de troupes destinées à protéger les abbayes. On est surpris que les historiens postérieurs à Léon Gautier ne citent ni ne discutent son affirmation. Généralement en effet ils donnent une date plus tardive pour l’instauration d’un rite d’adoubement liturgique, mais ces dates sont celles des premiers témoins de ce rite dans l’état où il a été inséré ensuite dans le Pontifical, pas celle du premier rite. Pour Jean Flori, le premier rituel (liturgique) de l’adoubement se rencontre en Italie du Sud, alors aux mains des Normands, vers la fin du XIIème siècle. (Ibidem, p. 41.)
[5] Une étude exhaustive sur la spiritualité chevaleresque devrait comprendre une présentation des principales figures chevaleresques canonisées, mais les dimensions nécessairement réduites du présent travail ne permettent pas de le faire. On a pu quand même en mentionner quelques-unes au passage.
[6] Voir Charles Lelong, La vie quotidienne en Gaule à l’époque mérovingienne, pp. 164-171.
[7] Cependant certains voient dans ce fait de la diminution des combattants le résultat du choix de n’avoir que des combattants à cheval : « Dès l’époque de Charlemagne l’armée fut entièrement montée et comme un cheval coûtait cher le service militaire fut restreint à un petit nombre d’hommes. » (Article « cheval » in Dictionnaire encyclopédique d’histoire, Bordas Paris 1986).
[8] Migne, Dictionnaire des ordres religieux, Aux Ateliers du Petit Montrouge, tome II, Paris 1848, col 999s.). Migne raisonne comme si les Germains n’avaient pas évolué depuis l’époque où Jules César les décrivait (Guerre des Gaules, livre VI, § 21 à 24).
[9] Voir André-Irénée Marrou, Décadence romaine ou Antiquité Tardive, Collection Points Histoire, Seuil, Paris 1977.
[10] Pierre Riché, De l’éducation classique à l’éducation chevaleresque, Flammarion, Paris 1968, p. 21. Pour notre propos, on peut noter que selon cet auteur, dès le Vème siècle, les Romains eux-mêmes s’étaient remis à insister sur l’éducation physique et sur la nécessité pour les jeunes gens d’apprendre à se battre. Voir aussi, du même auteur, L’enseignement au Moyen-Âge, CNRS Editions, Paris 2016.
[11] Chevaliers et chevalerie au Moyen-Âge, Hachette Littérature, Paris 2008 p. 11.
[12] Justin Favrod, Les Burgondes, Presses polytechniques et universitaires romandes, collection Le savoir suisse, Lausanne 20053.
[13] Jean Flori fait allusion, sans le préciser, au livre de Karl Ferdinand Werner, Naissance de la noblesse, Fayard, Paris 1998. Un des intérêts des études de Werner tient au fait qu’il parle des deux rives du Rhin, alors que la plupart des auteurs ici cités partent de leurs études sur les terres situées à l’Ouest de ce fleuve.
[14] Jean Flori, Chevaliers et chevalerie au Moyen Âge, Hachette littérature, Paris 2008, p.59.
[15] Léon Gautier, La Chevalerie, p. 17s.
[16] Ce fait a été mis en lumière par Georges Dumézil dans L’Idéologie tripartite des Indo-Européens, Latomus, 1958. L’idée est communément admise, même si Georges Dumézil reconnaissait qu’elle n’est pas applicable à l’ensemble du monde indo-européen ; elle est par exemple sous-jacente à tout l’article de Dominique Briquel : En deçà de l’épopée, un thème légendaire indo-européen : caractère trifonctionnel et liaison avec le feu dans la geste des rois iraniens et latins, in Colloque, l’épopée gréco-latine et ses prolongements européens, Calliope II, pp. 7-31. Synthétisant la pensée de Georges Dumézil, Mircea Eliade explique qu’aux trois ordres d’hommes correspondent dans la mythologie indo-européenne trois groupes de divinités (Histoire des croyances et des idées religieuses, tome I, De l’âge de pierre aux Mystères d’Eleusis, pp. 202ss).
[17] Article « Cheval » dans le Dictionnaire des mythologies indo-européennes, de Jean Vertemont, Faits et Documents, Paris 1997. On peut noter que si, généralement, les spécialistes du monde indo-européen connaissent les origines lointaines de la chevalerie, les spécialistes de l’époque féodale, eux, semblent l’ignorer.
[18] Dominique Barthélémy, La Chevalerie, de la Germanie antique à la France du XIIème siècle, Fayard, Paris 2007. Dominique Barthélémy s’oppose à Georges Duby quant à savoir s’il y a eu une « révolution de l’an Mil. A l’appui de sa démonstration, voir aussi ses autres ouvrages : La mutation de l’an mil a-t-elle eu lieu ? Servage et chevalerie dans la France des Xème et Xième siècles, Fayard 1997, et Chevaliers et miracles, la violence et le sacré dans la société féodale, Armand Colin, Paris 2004.
[19] Voir Charles Lelong, loc.cit.
[20] Corneille, Cinna, acte V, scène 3.
[21] Bruno Pin, Le Christ chevalier, la chevalerie à la lumière de l’évangile, éditions de l’Association Internationale de la Milice de Jésus-Christ, Paris 2011. – L’abbé Bruno Pin est chapelain dans la Milice de Jésus-Christ : il vit de la spiritualité qu’il décrit.
[22] L’expression bonus miles Jesu christi prend tout son sens à cette époque (cf 2 Tim 2,3).
[23] Toutefois Thierry Farenc (Courage grec et force chrétienne, Téqui, Paris 2011) note que pour la vertu de force, le christianisme a opéré un véritable retournement : chez les Grecs le courage est marqué par la confiance de l’homme en soi ; la vertu de force d’un chrétien est liée à l’espérance théologale. La nuance est de taille, et on doit la relever si l’on veut parler des vertus chevaleresques et de la spiritualité qui les sous-tend.
[24] « La large pierre de l’honneur » – ce titre lui a été inspiré par le château médiéval d’Ehrenbreitstein, près de Coblence. Cette conception de la chevalerie a influencé Lord Baden-Powell pour sa loi scoute.
[25] Léon Gautier, La Chevalerie, p. 33.
[26] L’épisode de Guillaume IX d’Aquitaine arrivé à Antioche le montre. Son armée a été surprise au repos près d’une rivière dans les Monts Taurus après une dure traversée de l’Anatolie, et alors qu’il était en reconnaissance : il a dû abandonner son ost pour ne pas ajouter au désastre. A-t-il enfreint le code chevaleresque ? Un tribunal en décidera à Antioche, présidé non par un grand noble (le duché d’Aquitaine était au faîte de sa puissance) mais par un simple chevalier, qui avait au cours d’une longue vie témoigné de ses vertus et de sa sagesse (le duc sera acquitté). Voir Michel Dillange, Guillaume IX d’Aquitaine, le duc troubadour, Geste éditions, La Crèche 2002, pp. 78s.
[27] Tacite, De Germania, XIII. (Ce petit ouvrage, écrit en 98 de l’ère chrétienne, fait le bilan des connaissances sur la Germanie après que l’empereur romain ait renoncé à s’y maintenir. Voir le commentaire que fait Léon Gautier de ce passage : La Chevalerie, p. 14s.
[28] Régine Pernoud, Les hommes de la croisade, Tallandier Paris 1982, p. 23. Elle note que ces gens du Moyen-Âge ont besoin de concret, ce qui explique leur dévotion pour les reliques des saints, par exemple, ou leur volonté de voir les Lieux Saints au moment des croisades d’Orient.
[29] Régine Pernoud, ibidem, p. 22.
[30] Pie XII a dû définir la matière et la forme du sacrement de l’ordre dans sa constitution apostolique Sacramentum Ordinis du 30 novembre 1947, en excluant formellement la tradition des instruments. Documents pontificaux de Sa Sainteté Pie XII, tome IX, p.431 ; Editions Saint Augustin, Saint Maurice 1961.
[31] Sur les multiples facettes de la symbolique de l’épée, voir Liam Allison Silcan, Il Simbolismo della Spada, dal Cavaliere al Guerriero Sacro, Keltia Editrice, Aosta 2012. (L’original en anglais a été édité à Edimbourg en 2009.)
[32] F. Cardini, Alle radici della cavalerria medievale, Firenze 1982, p. 143, cité par Jean Flori, Chevaliers et chevalerie au Moyen Âge, p. 27 et note 27.
[33] Remarquons que cette approche est encore celle des militaires d’aujourd’hui, qui parlent de « réciprocité » : s’ils ont le droit de tuer, c’est parce qu’ils s’exposent eux-mêmes à être tués, et cette façon de voir leur permet de juger de la moralité des « SALA » (systèmes d’armes létales autonomes, mal nommés communément « robots tueurs »), où celui qui décide du tir est loin de l’arme. Voir Brice Erbland, Robots tueurs, que seront les soldats de demain, Armand Colin, Paris 2018.
[34] Ce thème, laïcisé, du chevalier qui doit vaincre son orgueil, se retrouve dans la chanson de geste Lancelot ou le Chevalier de la charrette, racontée par Chrétien de Troyes (Œuvres complètes, La Pléiade, Gallimard, Paris 1994, pp. 505ss) ; Claude Duneton et Monique Baille ont rafraîchi le thème dans leur roman Le Chevalier à la charrette, Albin Michel, Paris 1985.
[35] La chevalerie, p. 30.
[36] Sacrosanctum Concilium 60, repris dans les deux codes de droit canon.
[37] Catéchisme de l’Eglise catholique, n° 1668.
[38] Ibidem, n° 1669.
[39] Ibidem, n° 1670.
[40] Ibidem n° 1672.
[41] Lumen Gentium 11.
[42] Ibidem 33.
[43] Ce fait est relevé par Alain de Bezenac dans son article Chevalerie et noblesse, in Chevaliers N° 32, pp. 15 à 18 ; il a été établi par Léo Verriest dans Noblesse, Chevalerie, Lignages, Bruxelles 1960. Léon Gauthier note de son côté que beaucoup sont adoubés qui ne doivent rien au système féodal, et en note cite nombre de « vilains » que la littérature nous présente comme chevaliers : La Chevalerie, p. 21, et note 1 ; et encore pp. 247ss.
[44] Voir à ce sujet Le latin vulgaire, par Joseph Herman, Que Sais-je ? PUF Paris 1967, p. 114ss.
[45] Saint Augustin, Sermon 336, 1. 6 – ce texte figure dans Liturgia Horarum au commun de la dédicace.
[46] Voir l’article L’adoubement chevaleresque in Chevalerie d’hier et d’aujourd’hui, recueil d’articles parus dans « Les chevaliers de Notre Dame », bulletin de l’association française de leur association de 1959 à 1962, pp. 59 à 85, notamment le paragraphe 3 : « adoubement et sacres impérial et royal ».
[47] On est bien renseigné sur le sacre du roi de France, surtout dans les derniers temps de la royauté ; mais pas sur le sacre de l’empereur : par exemple on le cherche en vain dans Louis Bréhier, Les institutions de l’empire byzantin, Albin Michel, Paris 19702 ; ou dans Georges Bordonove, Charlemagne Empereur et Roi, Pygmalion, Paris 1989 ; ou dans Robert Folz, Le couronnement impérial de Charlemagne, 25 décembre 800, Gallimard 19892. Bernhard Schimmelpfennig note : « Il n’y a aucun couronnement impérial dont l’ensemble des détails nous ait été transmis avec fiabilité. » (article Couronnement impérial in Dictionnaire historique de la papauté¸ sous la direction de Philippe Levillain, Fayard Paris 1994, pp. 483s). On sait que le rite du couronnement de Charlemagne a été un décalque de celui de l’empereur byzantin ; le chant des laudes regiae ou « acclamations carolingiennes » vient de cette cérémonie. Remarquons enfin que Dom Gaspar Lefebvre osb, dans son exposé sur les sacramentaux inséré dans Liturgia (pp. 749ss) range le sacre du roi parmi les sacramentaux en dépendance du sacrement de l’ordre : c’est peut-être vrai pour le roi de France, qui recevait les ordres mineurs, mais sans doute pour le simple miles faut-il le voir en dépendance de la confirmation.
[48] Voir ci-dessus note 12.
[49] Il explique sa démarche dans L’Histoire continue, éditions Odile Jacob, Paris 1991.
[50] Sur le cas de la Picardie, voir l’ouvrage de Robert Fossier, La Terre et les hommes en Picardie jusqu’à la fin du XIIIe siècle, Nauwelaerts, Paris-Louvain 1968.
[51] Voir à ce propos l’introduction de Jean Savant à son recueil de textes, le plus souvent anecdotiques, Les plus beaux textes sur les croisades, La Colombe, Paris 1956.
[52] L’ouvrage de René Grousset, Histoire des Croisades, demeure une référence, même si des compléments ont pu y être apportés par les recherches ultérieures.
[53] Cité par Jean Flori, Chevaliers et chevalerie au Moyen-Âge, p. 41
[54] On remarque que l’anéantissement des ennemis par les Israélites est motivé par l’idolâtrie de ceux-là, et les chevaliers de la croisade ont pu se sentir dans une situation analogue par rapport aux musulmans, ce qui expliquerait certains massacres par ailleurs inadmissibles. A ce sujet on se référera au Cahiers Evangile n° 76, La violence dans la Bible, surtout la deuxième partie (p. 16ss) « La violence au cœur, structure de la violence » ; voir aussi Jacques Cazeaux, Le refus de la guerre sainte, Josué, Juges et Ruth, Lectio Divina 174, Cerf, Paris 1998. Ces massacres au cours des croisades, spécialement dans celle des Albigeois, jettent plus qu’une ombre sur une entreprise par ailleurs moralement haute ; ce ne sont pas les seules déviations à déplorer : à partir de Grégoire IX en 1240 des Papes vont accorder aux défenseurs des Etats Pontificaux les mêmes avantages qu’aux croisés d’Orient, ce qui va mener finalement à une croisade du roi de France contre l’Aragon ! On ne peut que faire sien la conclusion de Michel Balard qui parle de croisades « politiques » dans son article Croisade du Dictionnaire historique de la Papauté (sous la direction de Philippe Levillain, Fayard Paris 1994, pp. 487-490) : « En détournant la croisade de ses objectifs, en développant la pratique des indulgences et le rachat des vœux à des fins fiscales, la papauté a fait perdre toute crédibilité à une entreprise qui, pendant plusieurs décennies avait réussi à faire l’unité de la chrétienté sous l’égide du Saint Siège ». En fait Saint Bernard lui-même, dès 1147, promettait aux participants à la croisade contre les Wendes la même indulgence pour les péchés que celle accordée aux croisés de Jérusalem (Jürgen Miethke, L’Engagement politique, in Bernard de Clairvaux, histoire, spiritualité, mentalités, colloque de Lyon-Cîteaux-Dijon, Sources Chrétiennes 380, Cerf, Paris 1992, pp. 492ss. Voir aussi Agnès et Robert Vinas, La croisade de 1285 en Roussillon et Catalogne, TDO éditions, Polestres 2015.
[55] Voir Jean Richard, (textes recueillis et présentés par -), L’esprit de la Croisade, Cerf, Paris 1969. Tout son deuxième chapitre est à consulter comme source pour ce qui est affirmé ici des croisades. Cet argument des péchés des chrétiens comme explication de leurs défaites est utilisé encore par Saint Bernard lorsqu’il prêche la deuxième croisade, selon J. Miethke, L’engagement politique, in Bernard de Clairvaux, histoire, mentalités, spiritualités, colloque de Lyon-Cîteaux-Dijon, Sources Chrétiennes 380, Cerf, Paris 1992, pp. 486ss.
[56] St Bernard, De Laude novae militiae, 1, FV Editions, 2015. Là encore l’argument est repris dans la prédication de la seconde croisade : J. Miethke, ibidem.
[57] On trouve cette opinion déjà exprimée par le gouverneur turc de Nicée cité par Guibert de Nogent, abbé de Notre Dame de Nogent sous Coucy (1055-1124), dans son Histoire de la première croisade, Editions Paleo, Clermont-Ferrand 2005, p. 94s.
[58] Cf. Geoffroy de Villehardouin et Robert de Clari, Ceux qui conquirent Constantinople, récits de la Quatrième Croisade, texte choisi, partiellement établi et présenté par Noël Coulet, Union Générale d’Editions, 1966 (collection 10/18).
[59] F. Van der Meer, Saint Augustin pasteur d’âmes, Alsatia, Colmar-Paris 1955, tome I, pp. 163ss.
[60] Voir le livre d’Alain Demurger, Chevaliers du Christ, les ordres religieux-militaires au Moyen-Âge (XIème – XIVème siècles), Seuil, Paris 2002 ; et aussi Desmond Seward, Les chevaliers de Dieu, les ordres religieux militaires du Moyen Âge à nos jours, Perrin, 2008.
[61] Voir l’article La notion d’ordre, in Chevalerie d’hier et d’aujourd’hui, recueil d’articles parus dans « Les chevaliers de Notre Dame », bulletin de l’association française de leur association de 1959 à 1962, pp. 5ss.
[62] Sur la portée et l’évolution de cette expression, voir Jean Flori, Chevaliers et chevalerie au Moyen Âge, p. 203ss ; il renvoie à Georges Duby, Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Gallimard, Paris 1998.
[63] On trouve des éléments de la spiritualité des ordres chevaleresques dans leurs rites ; or on dispose de l’ouvrage Rituels anciens des ordres de chevalerie, choisis et présentés par Pierre Girard-Augry, Dervy, Paris 1994.
[64] Régine Pernoud a écrit un petit livre, Les Templiers, Chevaliers du Christ, (Découvertes Gallimard, Histoire, Paris 1995), qui peut suffire à une initiation ; mais on a aussi, de Georges Bordonove, Les Templiers, Fayard, Paris 1963, ou encore, d’Alain Demurger, Les Templiers, une chevalerie chrétienne au Moyen-Âge, Seuil, Paris 2014.
[65] L’ouvrage de fond le plus récent est celui de Henry Sire, The Knights of Malta, New Haven, Yale University Press, 1994. En français, on a par exemple René Borricand, Histoire de l’ordre de Malte, Editions Borricand, 1968 (réimprimé en 1981 en Avignon) ; ou l’opuscule d’Yves Gazzo, 900 ans de fidélité pour le présent et pour l’avenir, Dacres éditions, Paris 2013.
[66] Il faut noter que les Templiers se recrutaient seulement parmi les nobles (Jean Flori, Chevaliers et chevalerie au Moyen-Âge, p. 82) et qu’ils devenaient chevaliers par leur appartenance à leur ordre, sans être adoubés. Aujourd’hui, l’Ordre de Malte laisse à chaque nation le soin de définir ses conditions d’admission, la nation allemande par exemple tenant beaucoup à l’ascendance noble de ses membres.
[67] Pour une première approche, voir Henry Bogdan, Les chevaliers teutoniques, Perrin, Paris 2002 (collection Tempus) : p. 14 pour la fondation en 1198 ; p. 184 pour le passage à la réforme de Luther. On a surtout une étude pratiquement exhaustive de Sylvain Gouguenheim, Les chevaliers teutoniques, Tallandier, Paris 2007.
[68] On trouve peu de documentation sur cet ordre ; on aura des éléments dans l’introduction de l’ouvrage de Henry-Melchior de Langle et Jean-Louis de Tréourret de Kerstrat, Les ordres de Saint Lazare et de Notre-Dame du Mont-Carmel au XVIIème et XVIIIème siècles, Collection S.R.H.N., publications LTK, Paris 1992. D’autres renseignements se trouvent dans Les ordres religieux et militaires en Orléanais, de Philippe Jourdan (Editions Jean-Michel Garnier, Chartres 1985, pp. 79 à 115.
[69] Préface de Dom Jean Leclercq, Les combats de Dieu, textes de Saint Bernard choisis et traduits par Henri Rochais, Stock-Plus, Paris 1981, pp. 14ss
[70] Sermo V de diversis, 4 – édition de Mabillon, col 1097
[71] Léon Gautier, La Chevalerie, p. 32.
[72] Perceval ou le conte du Graal, in Chrestien de Troyes, Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris 1994, pp. 683-911.
[73] Par exemple « Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son regard sur Dieu » – la Bible de Jérusalem commente : « Dieu est à ce point transcendant qu’une créature ne peut le voir et vivre. » (Ex 3, 6) – Ou bien Gédéon s’exclame « Hélas ! mon Seigneur Yahvé ! C’est donc que j’ai vu l’Ange de Yahvé face à face ? (Jg 6,22) – et encore « Nous allons certainement mourir, dit Manoah à sa femme, car nous avons vu Dieu. » (Jg 13, 22)
[74] Pour Dom Cabrol, les cérémonies qui entourent la consécration, dont l’élévation, « ne sont pas antérieures au XIIème siècle » : in Liturgia, Encyclopédie populaire des connaissances liturgiques, publiée sous la direction de l’Abbé R. Aigrain, Librairie Bloud et Gay, Paris 1930, p. 545.
[75] Jean Flori, Chevaliers et chevalerie au Moyen-Âge, p. 84
[76] « Lorsque le sens et la véritable mission de la chevalerie furent oubliés, les puissants utilisèrent à contre-sens l’institution qu’ils vidèrent par le fait même de sa substance. » Alain de Bézenac, loc. cit. p. 18.
[77] A la bataille de l’Ecluse la cavalerie française est anéantie par les miliciens flamands armés de lances, retranchés derrière un fossé marécageux.
[78] La conception du chevalier comme combattant à cheval sous-tend le travail d’Emmanuel Bourassin, Les Chevaliers, splendeur et crépuscule 1302 – 1527, Tallandier, Paris 1995 ; on voit que pour lui chaque défaite des cavaliers face aux fantassins est signe de déclin de la chevalerie.
[79] Migne, Dictionnaire des ordres religieux, Aux Ateliers du Petit Montrouge, Paris 1848.
[80] Cf Jean Flori, Chevaliers et chevalerie au Moyen-Âge, Hachette Littératures (collection Pluriel), Paris 2008, p. 34. (Antrustions : hommes de confiance – cf le mot anglais « trust ».)
[81] César, Guerre des Gaules, livre VI, 15. « Il s’agit de ceux qui forment ‘l’entourage’ du chevalier, et qui, dévoués à lui jusqu’à la mort, ont décidé de ne pas lui survivre. » (Note de Pierre Fabre dans l’édition des Belles Lettres, reproduite pour le Club Français du Livre, Paris 1954.)
[82] « Les empereurs, tous des militaires, s’entourent de fonctionnaires également militaires. On assiste donc à une certaine militarisation de l’administration civile qui se traduit d’ailleurs dans le vocabulaire. Ce point n’est pas sans importance pour notre sujet puisque, dès cette époque, le terme militia – par lequel, beaucoup plus tard, on désignera la chevalerie – en vient à désigner non seulement, comme jadis, l’armée ou le service militaire, mais ‘toute fonction publique au service de l’Etat’. » – Jean Flori, ibidem, p. 17.
[83] Voir Jean Flori, Richard Cœur de Lion, le roi chevalier, Payot 1999 ; ou encore T. A. Archer, The crusade of Richard I, 1189-92, réimpression en 2017 par Endeavourink de l’édition de 1889.
[84] Un historien français s’est intéressé au phénomène, qu’il a étudié de façon à peu près exhaustive, et qu’on suit ici : voir Jean-Claude Maire Vigueur, Cavaliers et Citoyens, Guerre, conflits et société dans l’Italie communale, XIIème – XIIIème siècles, Editions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 20042 ; on peut compléter ce point de vue avec Guerre ed eserciti nel medioevo, a cura di Paolo Grillo e Aldo A. Settia, il Mulino, Bologna 2018 ; et aussi Gabriele Esposito, Le guerre dei comuni contro l’impero 1176-1266, organizzazione, equipaggiamento e tattiche, LEG Edizioni, Gorizia 2017 ; ou Aldo A. Settia, Tecniche e spazzi della guerra medievale, Viella, Roma 2006. Enfin on a un point de vue italien sur les ordres de chevalerie avec Claudio Rendina, Gli ordini cavallereschi, epopea e storia, Newton Compton Editori, Roma 20162.
[85] Les ordres nationaux hispaniques ont eu leur historien français : Francis Gutton. On a de lui, tous édités chez P. Lethielleux, L’Ordre de Calatrava (1955) ; L’Ordre de Santiago (1972) ; L’Ordre de Montesa (1974) ; L’Ordre d’Alcantara (1975) ; La chevalerie militaire au Portugal, l’Ordre du Temple, l’Ordre du Christ, l’Ordre d’Avis, l’Ordre de Santiago (1981).
[86] Sur ces évènements, voir Jean-François de Rome, ofm cap., La fondation de la mission des Capucins au royaume du Congo (1648). Traduite de l’Italien et annotée par François Bontinck. Publications de l’Université Lovanium de Léopoldville n° 13. Edition Nauwelaerts, Louvain-Paris 1964 ; et aussi Paul de Meester, professeur à la faculté de Lettres, Université nationale du Zaïre, Lubumbashi, l’Eglise d’Afrique d’hier et d’aujourd’hui. Edition Saint-Paul Afrique, Kinshasa 1980. (pp. 53-68 pour notre sujet).
[87] Et comme Saint Bernard il se représente la vie spirituelle comme un combat.
[88] « Un souffle d’énergie guerrière anime les écrits de Sainte Thérèse. Elle est fille de chevaliers et originaire d’Avila qui, au cours d’un siège mémorable, fut défendu par l’héroïsme de ses femmes » : c’est le jugement du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus in Je veux voir Dieu, p. 81 – cité par Jacques Mercier, article Sainte Thérèse d’Avila et la chevalerie, in Chevaliers nos 30 – 31, 2e – 3e trimestres 1976, pp. 24 – 2.
[89] Voir le site de la Militia Christi sur internet, tout comme pour l’ordre du Saint Sépulcre.
[90] Fayard, Paris 1965.
[91] Discours aux participants au congrès promu par le parti populaire européen du 30 mars 2006 – consultable sur le site internet du Vatican.
[92] « Sache que l’épée n’est pas un vain symbole ; celle que l’Eglise bénit et remet au chevalier signifie une mission spéciale au sein de l’immense armée de Dieu, et la grâce d’état pour l’accomplir. Cette mission consiste à élargir ici-bas les frontières du royaume de Dieu, à renverser le faux ordre luciférien du monde pour bâtir sur ses ruines une société humaine soumise à la royauté du Christ et propice au salut éternel du grand nombre. » (Règle des chevaliers de Notre-Dame, prologue n° 4 – imprimatur du 16 décembre 1969).
[93] Excalibur – faut-il le rappeler ? – est l’épée grâce à laquelle est désigné le roi Arthur, et qui donne son nom au film de John Boorman paru en 1981 ; la comédie Les Visiteurs est un film de Jean-Marie Poiré sorti en 1993 qui raconte les aventures d’un chevalier du XIIème siècle propulsé à notre époque ; bien que non spécifiquement chevaleresque, l’épopée de J. R. R. Tolkien Le Seigneur des Anneaux, semble rédigé comme un commentaire littéraire du code d’honneur (comme Kenelm Digby, Tolkien est un converti de l’anglicanisme au catholicisme).
[94] Voir Louis Bouyer, Les lieux magiques de la légende du Graal, de Brocéliande en Avallon, O.E.I.L., Paris 1986 ; sous le pseudonyme de Louis Lambert il a écrit aussi Prélude à l’Apocalypse ou les derniers chevaliers du Graal, Critérion, 1982 : Jean Duchesne, en présentant les Mémoires du Père Bouyer (Cerf, Paris 2014), confirme bien que celui-ci est l’auteur de Prélude à l’Apocalypse.
[95] Voir Annette Becker, Les dévotions des soldats catholiques pendant la grande guerre, in Chrétiens dans la première guerre mondiale, sous la direction de Nadine-Josette Chaline, Cerf, Paris 1993, p. 17 : la première dévotion mentionnée est intitulée « Imiter le Christ. Dolorisme ».
[96] Charles Péguy a inséré ce poème dans Ève, Cahiers de la Quinzaine 1914, p. 395. Quant à la prière d’André Zirnheld, elle est connue de tous les parachutistes français, au moins sous sa version chantée sur l’air de la marche consulaire.
[97] Cette influence est exposée et évaluée par Tim Jeal, Baden Powell, founder of the boy scouts, Hutchison, Londres 1989, p. 422 ; à la page 485 il indique que Baden-Powell lui-même a recommandé l’œuvre de Digby.
[98] Règle des chevaliers de Notre Dame, III, 1.
[99] Dictionnaire de la vie spirituelle, sous la direction de Stefano De Fiores et Tullo Goffi, adaptation française par François Vial, Cerf Paris 2012. L’origine italienne de cet ouvrage explique peut-être cette lacune.
[100] Préface de Philippe Levillain, François-Xavier de Guibert, Paris 2002.
[101] Maurice Courtois, Chevalerie et Vatican II, divergence ou convergence ? in Chevaliers nos 30 – 31, 2e – 3e trimestres 1976, pp. 5 – 8 : on y compare certains passages d’Apostolicam actuositatem au De laude novae militiae de Saint Bernard !
[102] Une autre chevalerie naîtra, Nouvelles Editions Latines, Paris 1949.
Bibliographie (dans un autre article)