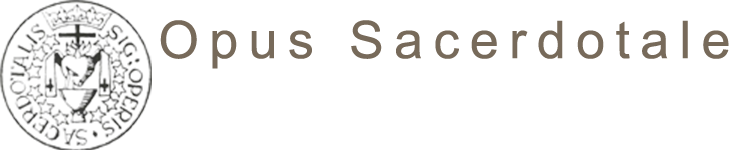L’objection de conscience – un défi à relever par M. l’Abbé C. Barthe
Colloque « L’objection de conscience : un défi à relever »,
Alliance vita, Paris, 3-4 décembre 2011
Peut-on éviter toute collaboration avec des actes de mort ?
Le sujet n’est pas facile :
- parce qu’il est délicat en soi ; immense, avec des ramifications infinies, de complexes nuances, le tout nécessitant une casuistique (au bon sens du terme : l’étude des cas concrets) collant le mieux possible aux réalités.
- parce qu’il est d’une acuité particulière aujourd’hui pour pas mal de professions : professions juridiques, magistratures politiques, professions médicales, pharmaceutiques, un nombre non négligeable de commerces (outre les pharmaciens sur lesquels pèse l’obligation de vendre, rançon du numerus clausus, et qu’on prétend obliger à « débiter » des marchandises de mort, il y a aussi les maisons de la presse, tenues d’exposer et de vendre de la littérature pornographique, les employés de toutes sortes d’entreprises dans le monde de la publicité, du cinéma, etc.)
- Parce que s’il est aisé de donner des principes, il reste parfois héroïque de passer à l’application. Cela oblige celui qui expose la doctrine morale à une grande humilité. De même, lorsqu’on enseigne la patience, la résignation et l’offrande de ses souffrances à quelqu’un qui pâtit horriblement, on ne peut que le faire qu’avec une extrême modestie.
Précisons d’abord un point très important. Les sujets abordés ici sont souvent associés à « la doctrine de l’Église » alors qu’en réalité, ils concernent la morale naturelle qui regarde tout homme, inscrite dans le cœur de chacun (Rm 2, 14-15), même s’il ignore la révélation chrétienne. Étant entendu toutefois qu’en raison de la faiblesse de la raison humaine, conséquence du péché originel, la révélation chrétienne demeure très utile pour conforter cette connaissance naturelle que tout homme pourrait avoir par lui-même, mais qu’il n’a de fait souvent pas, ou que très imparfaitement. Par exemple, l’indissolubilité du mariage est de droit naturel. Mais si le Christ (Mt 19, 3-6) et l’Église ne l’enseignaient pas, les hommes l’auraient complètement oubliée. De même détourner l’acte charnel de sa fin relève de la loi de nature, mais il est plus qu’indispensable que l’enseignement de l’Église le rappelle à temps et à contretemps. Lors de la présentation du Lexique des termes ambigus et controversés sur la famille, la vie et les questions éthiques, du Conseil pontifical pour la Famille (éditions Téqui, 2005), Mgr Vingt-Trois avait beaucoup insisté sur ce point. Il prit l’exemple du mariage, évoqué dès les premiers chapitres de la Genèse, comme une institution qui concerne tout homme. Ce n’est que très longtemps après que le Christ rappela cette institution divine intrinsèque à la création de l’homme. Bien entendu, la loi évangélique résumée par les Béatitudes transfigure la loi naturelle, de manière infiniment plus admirable mais aussi plus exigeante (par exemple, agir professionnellement de manière morale, inclut de ne pas rougir du Christ et témoigner de son enseignement). Le Christ et son Église apportent en outre, par l’intermédiaire de la charité et de la compassion des chrétiens que nous sommes, l’invitation à la conversion, par ses sacrements, le pardon des pécheurs amenés au repentir et toutes les grâces pour soutenir leur vie et leur activité selon la volonté de Dieu.
Il importe encore de bien comprendre la loi naturelle. Il ne faudrait pas l’entendre comme une référence écologique, ou naturiste, même si cela peut être très utile souvent[1]. La loi naturelle est cette loi inscrite dans le cœur de tout homme (Rm 2, 14-15). Elle est l’ordre objectif s’imposant à la raison humaine et représentant pour elle la norme du comportement. Car on prend pour acquis qu’il existe une nature humaine, dont la spécificité est qu’elle formée d’un corps et d’une âme spirituelle, donc dotée de raison, image de la raison divine et participation à celle-ci. Cette nature humaine est la même pour tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux.
Est aussi acquis que l’homme est un être doué d’intelligence qui, comme tel, agit en comprenant ce qu’il fait, pouvant se désigner à lui-même les fins qu’il poursuit. En vertu de la nature humaine, il y a donc un ordre ou disposition que la raison humaine peut découvrir (cela peut prendre du temps, s’obscurcir selon les lieux, les civilisations, ou au contraire s’éclairer, mais demeure en toute hypothèse intrinsèquement universel). Selon cet ordre divin dont l’intelligence humaine est le miroir, la volonté humaine doit agir en accord avec les fins essentielles et nécessaires de l’être humain. La loi non écrite ou loi naturelle, considérée dans son aspect ontologique, n’est pas autre chose que cela : cet ordre ou cette disposition que la raison humaine doit découvrir. De manière très ramassée on pourrait dire que la loi prochaine suprême pour l’homme est celle de sa raison – de sa droite raison, bien sûr – et qu’agir moralement, c’est agir raisonnablement (par exemple, le mensonge, l’adultère, le meurtre crapuleux et a fortiori le meurtre de l’innocent, sont contraires à la droite raison). C’est de grande conséquence, par ailleurs, pour le témoignage à rendre de ses actes, car il faut souvent les expliquer, en rendre raison précisément, et aussi pour l’éducation morale des enfants, des jeunes et de beaucoup d’adultes, dont il faut éclairer l’intelligence.
La coopération au mal
Il n’est pas permis de faire le mal (un braquage de banque). Mais il n’est pas permis non plus de coopérer au mal (fournir aux malfaiteurs les plans de la banque, leur louer une voiture lorsqu’on sait à quoi ils vont l’employer, ne pas les dénoncer lorsqu’on a eu connaissance du forfait, etc.) En fait, il s’agit d’une complicité plus ou moins importante avec l’acte mauvais, dont la gravité se mesure avec le degré du mal commis, le degré de complicité, et bien entendu les multiples circonstances.
Pour être plus précis, on pourrait distinguer une double complicité.
En amont : le militant pour les « droits » de la femme prônant l’avortement, le législateur votant la loi, l’exécutif la promulguant, le prêtre l’excusant, sont complices. On est dans l’ordre du scandale, c’est-à-dire de l’incitation plus ou moins grave au mal.
En coopérant à l’action elle-même : l’infirmière qui assiste le médecin pratiquant l’avortement dans son acte même, le mari payant l’avortement de sa femme, l’ami la conduisant à la clinique où elle va avorter, etc. Le Saint-Siège, au nom de l’immoralité de cette coopération, avait fait révoquer aux évêques allemands les « consulteurs catholiques » prévus par une loi de 1995. Une femme voulant avorter doit se soumettre à une « consultation de grossesse » pour obtenir une attestation nécessaire pour la faire avorter si elle persiste dans son intention. Même un consulteur catholique ayant invité la femme à ne pas avorter, lui délivrait cette attestation lui permettant de le faire.
Dans le cas de coopération à l’acte même, la gravité de la culpabilité de la coopération se mesure également avec la gravité du mal lui-même (faire boire quelqu’un sans lui faire perdre la raison n’est pas un péché grave, mais lui permettre de s’enivrer véritablement, oui). Elle est aussi fonction du lien de nécessité entre l’acte de coopération et le mal commis qui se mesure en fonction des circonstances diverses. Ce peut être assez complexe :
- Le gynécologue opposé à l’avortement mais ayant découvert une malformation chez l’embryon, doit en informer la mère, même si compte tenu de la pression ambiante, elle risque de décider d’avorter. Le devoir est plus important que le risque.
- Le chauffeur de taxi conduisant la nuit des touristes dans un quartier chaud : le risque est important qu’ils s’y rendent pour faire le mal, mais n’est pas absolu.
- Le pharmacien délivrant sans ordonnance des sédatifs risquant de permettre une tentative de suicide endosse une lourde culpabilité en raison de la circonstance suspecte du manque d’ordonnance.
- La prescription et la vente d’un stérilet, dont l’usage sera par définition d’expulser des ovules fécondés, est une coopération à un mal grave avec lien direct.
Il est capital de distinguer entre la « coopération-cause » (coopération directe toujours coupable, avec participation plus ou moins grande) et la coopération non expresse (simple occasion, justifiable dans certaines conditions)[2].
L’éventuelle tolérance du mal
On se méprend souvent aujourd’hui sur la tolérance. La doctrine traditionnelle enseigne qu’en certains cas, quelqu’un exerçant une autorité au nom de Dieu (les parents, le gouvernement de la Cité) peut s’abstenir de réprimer un mal, si l’empêcher causerait un mal plus grand encore. Mais un certain nombre de théologiens catholiques, voire d’évêques estiment qu’il serait parfois moral d’utiliser un moyen mauvais comme les moyens de contraception pour obtenir une fin bonne comme ne pas transmettre le sida. Alors que par la tolérance traditionnelle, on laisse faire tel mal pour éviter un mal plus grand, on coopère ici à un mal pour éviter un mal plus grand.
En saine théologie morale, la tolérance peut s’imposer dans l’agir humain à l’imitation de la Providence divine qui laisse parfois exister le mal dans la considération du plus grand bien (Mt 13, 24-30 : le Maître laisse pousser l’ivraie avec le bon grain, de peur qu’en arrachant l’ivraie, on arrache aussi le bon grain). À l’égard de ce mal, elle constitue une simple abstention de punir. Permission d’ailleurs toute négative, car ce « laisser-faire » n’est donné que parce qu’on ne peut faire autrement. Ce n’implique ni approuver le mal (les maisons que « tolérait » saint Louis dans Paris), ni même, à strictement parler, de concéder une liberté d’agir puisque la liberté ne peut concerner qu’un bien certain. Simplement on s’abstient, dans tel cas, de réprimer. Tolérer en théologie morale signifie souffrir un mal qu’on ne peut empêcher et n’a strictement rien à voir avec la philosophie des Lumières qui désigne une réalité fondée sur les droits imprescriptibles de la conscience. En d’autres termes, si on peut tolérer un moindre mal, on n’a pas le droit de le commettre ou conseiller de le commettre. La théorie dite du « moindre mal » (qui autorise à le commettre ou à le conseiller) est un gauchissement de l’observance de la tolérance.
D’où le principe moral dit de l’acte à double effet ou du « volontaire indirect »[3] suivant lequel il est permis, dans certaines conditions, de poser un acte qui produit un effet bon directement voulu, même si cet acte peut causer aussi un effet mauvais concomitant. Ainsi, pour prendre un des exemples les plus classiques, les analgésiques prescrits à de grands malades sont licites même s’il accélère la mort dans la mesure où, « entre la narcose et l’abrègement de la vie n’existe aucun lien causal direct, posé par la volonté des intéressés ou par la nature des choses (ce qui serait le cas, si la suppression de la douleur ne pouvait être obtenue que par l’abrègement de la vie) »[4] : même si le risque d’abréger les jours existe, il n’y a pas euthanasie.
Les moralistes détaillaient généralement quatre conditions moyennant lesquelles il est permis de poser un acte pouvant causer un double effet, l’un bon, l’autre mauvais :
1/ l’acte cause doit être licite, indépendamment de son effet mauvais (le chirurgien pratique une opération de la prostate qui va rendre l’opéré, toujours capable d’accomplir l’acte conjugal, stérile ; une stérilisation voulue comme telle serait en revanche immorale).
2/ l’intention doit être bonne, ne portant que sur l’effet bon, sans rechercher l’effet mauvais aussi (la stérilité de cet homme). La meilleure garantie de sincérité consiste à tout faire pour éviter l’effet mauvais. Un père de famille ou supérieur de séminaire qui permettent l’accès à Internet avertissent les enfants ou séminaristes qu’ils risquent d’être attirés par mille images mauvaises, et éventuellement les contrôlent.
3/ l’effet bon doit être obtenu directement par l’acte causé et non par l’effet mauvais, comme l’exige Rn 3, 8 : « Devrions-nous faire le mal pour qu’en sorte le bien ? » (une infirmière en maternité n’a pas le droit d’omettre des soins nécessaires à un enfant trisomique pour provoquer sa mort et « délivrer » des parents.
4/ un motif suffisant existe pour permettre la conséquence mauvaise. Plus l’effet mauvais est grave et en connexion avec l’acte posé, et plus le bien directement recherché doit être important et urgent (l’ambulancier qui conduit un très grand blessé aux urgences peut prendre des risques que n’a pas le droit de prendre un automobiliste qui est en retard pour arriver à son bureau).
La troisième condition est cardinale. Chercher à provoquer l’effet bon de la chute d’un tyran (Saddam Hussein), par le moyen mauvais d’affamer les populations qu’il oppresse et d’en priver les enfants de médicaments pour les inciter à se révolter contre lui, est immoral. Un acte objectivement mauvais et très grave comme du terrorisme d’État en l’espèce reste un acte mauvais même s’il fut posé en vue d’une fin bonne. La fin ne justifie pas les moyens.
Pour la quatrième condition, il importe que l’effet mauvais indirectement permis ne soit que de l’ordre du risque. La Congrégation pour la Doctrine de la foi déclara sur l’euthanasie le 5 mai 1980 : « Dans ce cas, en effet, il est clair que la mort n’est en aucune façon voulue ou recherchée, même si le risque en est raisonnablement couru ; on a simplement l’intention de calmer efficacement la douleur en employant dans ce but les analgésiques dont la science médicale dispose ». L’examen prudentiel s’il existe ou pas un motif proportionné pour poser tel acte à double effet s’applique, certes, à la gravité de l’effet mauvais, mais plus encore au risque de le voir se produire. Plus l’éventualité de voir l’effet mauvais advenir est grande, plus le motif de poser l’acte cause doit être grave. Si l’effet mauvais cessait d’être un risque pour devenir nécessité, il deviendrait un moyen mauvais. Par exemple, un bombardement peut être préparé de manière à éviter les pertes civiles. Malgré cela, il est possible que des civils soient tués : leur mort est alors un accident, un risque collatéral non délibéré à la différence des bombardements intentionnels de civils à Hiroshima[5], Dresde, Bagdad, ou de l’attentat contre les tours jumelles de New York.
Les actes intrinsèquement mauvais
Les difficultés des cas limites et des discussions en résultant sur l’application du principe (par exemple, à propos de l’ablation d’organes malades d’une femme enceinte provoquant à coup sûr la mort de l’enfant) sont évitées par le garde-fou qualifiant certains actes d’intrinsèquement mauvais, contraires en eux-mêmes (tels qu’ils sont circonscrits et définis) à la loi naturelle. La mise à mort intentionnelle de l’innocent (« tuer un homme qui se maintient dans sa dignité »), est un acte mauvais en soi par exemple, pour S. Thomas (ST, IIa IIæ, q. 64, a. 2, ad 3). De tels actes contre nature ne peuvent en aucune façon être considérés comme licites servant au double effet. Il n’est plus possible de douter de l’application du principe de Rm 3, 8 en présence d’un acte intrinsèquement mauvais comme le mensonge, le meurtre de l’innocent ou l’usage des moyens abortifs. Une dissuasion nucléaire incluant l’intention, même conditionnelle, de tuer les innocents, et qui est entièrement organisée pour mettre en œuvre cette intention (stratégie anti-cités) est immorale, de la même manière qu’une prise d’otages.
Ainsi, « s’il est parfois licite de tolérer un moindre mal moral afin d’en éviter un plus grand ou de promouvoir un bien plus grand, il n’est pas permis, même pour de très graves raisons, de faire le mal afin qu’il en résulte un bien, c’est-à-dire de prendre comme objet d’un acte positif de volonté ce qui est intrinsèquement un désordre » (Humanæ vitæ, n 14). Paul VI précise spécialement qu’est exclue « toute action qui, soit en prévision de l’acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation ».
S’il est parfois licite de tolérer un moindre mal moral afin d’éviter un mal plus grand ou de promouvoir un bien plus grand[6], il n’est jamais permis, même pour de très graves raisons, de vouloir positivement ce qui est intrinsèquement un désordre, même avec l’intention de sauvegarder ou de promouvoir des biens individuels, familiaux ou sociaux. Ainsi un acte d’union charnelle dénaturé pour être rendu volontairement infécond (stérilisation de la femme, usage de contraceptifs) et par conséquent, intrinsèquement mauvais, ne peut être rendu bon par le bien de l’harmonie conjugale que cet acte mauvais procurerait.
En revanche, les « méthodes naturelles » usant du mariage lors des périodes infécondes de l’épouse pour « l’exercice responsable de la paternité et de la maternité » réglé par la prudence (Evangelium vitæ), est parfaitement licite, car il ne consiste en une « stérilisation directe » de l’épouse, pour Pie XII[7]. Mais cet usage serait peccamineux, non pas dans l’acte lui-même, mais dans l’intention, si on y recourait pour des motifs égoïstes.
La coopération à un acte intrinsèquement mauvais n’est pas possible
On peut discuter à l’infini de la qualification de la coopération au péché de l’ivrogne du tenancier de bar qui lui sert un énième apéritif, ou plus gravement de la coopération du magistrat au divorce[8]. On ne peut pas discuter du caractère formel de la coopération au bombardement de populations civiles (Truman qui donne l’ordre, ses conseillers qui l’approuvent, ceux qui le transmettent, ceux qui ont installé les bombes dans l’avion, l’aviateur qui lâche la bombe sur Hiroshima) ou de la coopération à tout acte d’avortement depuis le premier moment de la conception. Ainsi de la coopération en fournissant :
- les contraceptifs oraux dits « pilule du lendemain » potentiellement abortifs (empêchant l’implantation)[9];
- la RU 486[10];
- un stérilet ;
- les contraceptifs oraux ayant pour effet potentiel d’évacuer l’ovule fécondé[11].
Certes, l’expulsion volontaire de l’ovule fécondé dans les premiers moments de sa vie ne provoquent pas le traumatisme psychologique que cause à la mère l’expulsion de son enfant formé, mais ils interrompent une vie humaine à laquelle ils interdisent la naissance (et possiblement le baptême)[12]. Ils sont donc abortifs[13].
D’autre part, un acte d’union charnelle dénaturé pour être rendu volontairement infécond, même s’il n’y a pas meurtre d’une vie humaine innocente, est aussi un acte intrinsèquement mauvais pour lequel est moralement impossible la coopération plus ou moins grave (campagnes organisées par des associations, pouvoirs publics, conseils actifs de professionnels voire de prêtres, fourniture du « matériel », indication sur la manière de se le fournir, et.). Coopération spécialement en permettant de se procurer des préservatifs masculins et féminins, des contraceptifs oraux, même s’ils n’avaient certainement d’effet que d’empêcher l’ovulation ou dont les conditions d’utilisation seraient telles qu’elle n’aurait que cet effet[14].
Il convient, à ce propos, de citer l’encyclique Evangelium vitæ : « Il est fréquemment affirmé que la contraception, rendue sûre et accessible à tous, est le remède le plus efficace contre l’avortement. On accuse aussi l’Église catholique de favoriser de fait l’avortement parce qu’elle continue obstinément à enseigner l’illicéité morale de la contraception. A bien la considérer, l’objection se révèle en réalité spécieuse. Il peut se faire, en effet, que beaucoup de ceux qui recourent aux moyens contraceptifs le fassent aussi dans l’intention d’éviter ultérieurement la tentation de l’avortement. Mais les contrevaleurs présentes dans la « mentalité contraceptive » – bien différentes de l’exercice responsable de la paternité et de la maternité, réalisé dans le respect de la pleine vérité de l’acte conjugal – sont telles qu’elles rendent précisément plus forte cette tentation, face à la conception éventuelle d’une vie non désirée. De fait, la culture qui pousse à l’avortement est particulièrement développée dans les milieux qui refusent l’enseignement de l’Église sur la contraception. Certes, du point de vue moral, la contraception et l’avortement sont des maux spécifiquement différents : l’une contredit la vérité intégrale de l’acte sexuel comme expression propre de l’amour conjugal, l’autre détruit la vie d’un être humain; la première s’oppose à la vertu de chasteté conjugale, le second s’oppose à la vertu de justice et viole directement le précepte divin « tu ne tueras pas ». […] Malheureusement, l’étroite connexion que l’on rencontre dans les mentalités entre la pratique de la contraception et celle de l’avortement se manifeste toujours plus; et cela est aussi confirmé de manière alarmante par la mise au point de préparations chimiques, de dispositifs intra-utérins et de vaccins qui, distribués avec la même facilité que les moyens contraceptifs, agissent en réalité comme des moyens abortifs aux tout premiers stades du développement de la vie du nouvel individu ».
La coopération ne saurait se targuer, encore une fois, de réduire le mal qui va être commis à un « moindre mal », s’il est intrinsèquement mauvais. L’expression de « moindre mal », minus malum, ne se trouvait chez les auteurs traditionnels que pour dire qu’on peut le tolérer dans le cadre de l’acte à double effet (en ce sens vaut l’expression reprise plusieurs fois par s. Thomas : « De deux maux il faut choisir le moindre »). Mais on ne doit pas le commettre comme moyen nécessaire, car « il n’est pas permis d’employer une chose désordonnée pour empêcher le mal ou le péché du prochain » (ST, IIa IIæ, q. 110, a. 3, ad 4). On devient complice de crime terroriste, par exemple, en désignant dans une liste d’otages certains prisonniers à exécuter, à défaut de quoi, tous seraient massacrés, ou en suggérant de n’en tuer qu’un certain nombre, sous prétexte de « moindre mal ».
Conclusion
1/ Je n’ai fait que rappeler des principes, sur lesquels nous nous accordons assurément. Mais la difficulté est si grande pour les mettre en pratique qu’il convient de s’unir pour faire entendre sa voix, se soutenir notamment dans la véritable persécution que constituent des actions en justice très lourdes, etc. Il est aussi grandement nécessaire d’exercer cette charité première et cette compassion d’éduquer les intelligences des confrères, des patients et « utilisateurs », chacun à son niveau. Il faut leur parler des risques, les amener à une compréhension de la loi de la nature et leur faire bien entendre les droits de la conscience de celui (le pharmacien, le médecin) qu’ils tendent à obliger à un acte qu’il réprouve.
2/ Comment pourrait-on faire que le principe institutionnel du respect de la vie innocente ne concerne pas l’organisation de la vie de la Cité ? Et comment le refus d’appliquer des dispositions qui contreviennent à ce respect ne serait-il pas politique ? Ne s’agit-il pas de problèmes qui intéressent la responsabilité d’une grande part de la population en âge de procréer ? Il ne faut d’ailleurs pas se laisser prendre soi-même aux ambiguïtés de langage : parler d’« objection de conscience » est tout à fait légitime pour être entendu de tous, car tous peuvent comprendre que l’on évoque ainsi les droits de sa conscience. Mais, il ne faut pas pour autant laisser penser, ni surtout penser soi-même, que l’on pratique ainsi une espèce d’anarchisme pour le bien. Ce serait aussi faire un mal pour qu’il en advienne un bien… La loi naturelle commandant d’honorer les dépouilles des défunts, Antigone n’était pas une anarchiste en refusant la « loi » de Créon, ni saint Thomas More en refusant de reconnaître le second « mariage » d’Henri VIII, ni les prêtres réfractaires en refusant une « loi » contraire à la divine constitution de l’Église.
En toute rigueur de terme, qui refuse d’obéir aux lois Neuwirth, Veil et autres du genre, considère qu’elles sont contraires à la loi de Dieu et au bien commun de la Cité. Par conséquent, elles ne sont pas des lois, mais des obligations immorales tyranniques comme l’explique Joël Hautebert. La loi, selon la doctrine classique étant rationnelle dans son essence et pédagogique dans sa finalité. Elle est édictée, dit s. Thomas, pour empêcher les hommes de commettre certains péchés et leur permettre de vivre ensemble paisiblement, selon la volonté de Dieu.
Qui refuse d’obéir à une « loi » attentant à la vie innocente ou autorisant un désordre intrinsèquement contraire à la nature, ne désobéit pas. Il affirme en conscience que ce n’est pas à strictement parler une loi. Mais il le fait à titre individuel, alors que c’est le gouvernement de la Cité ou ses organes (le Conseil constitutionnel, ou ses équivalents) qui devraient porter un tel jugement. En réalité, en bonne morale, on est plutôt dans le domaine de « l’autorité empêchée », dont relève la légitime défense. La légitime défense permet, par exemple, de tuer un injuste agresseur de sa famille, parce que la police organisée par le gouvernement de la Cité ne peut être atteinte immédiatement pour défendre telle victime contre l’injuste agresseur. De même, parce qu’il ne peut atteindre les organes compétents du gouvernement de la Cité – et pour cause – dans le but de leur faire annuler cette prétendue loi, celui qui refuse de s’y soumettre présume de la décision d’annulation qu’ils devraient prendre.
3/ On pourrait aller plus loin, mais ce colloque n’est pas le lieu pour le faire, et parler, dans les cas considérés, d’une remise en cause implicite de la pertinence de la gérance de la Cité. Un gouvernement naturel et chrétien pouvait certes prendre une mauvaise loi – c’est arrivé souvent – à laquelle il fallait désobéir. Mais on se trouve en fait aujourd’hui dans le cas d’un système de direction des citoyens qui écarte par principe et qui ignore par nature la référence à la loi naturelle, et par le fait la notion de bien commun qui n’entrent pas dans son champ institutionnel. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne serve pas de fait un certain nombre de canons du bien commun, et qu’à ce titre il est moralement obligatoire d’obéir aux règles qui les organisent.
4/ On pourrait même aller au-delà dans l’explicitation de ces actes qualifiés pour la commodité et l’efficacité concrète d’« objection de conscience ». Nous ne sommes pas des Romains ou des Zoulous, qui respectaient tant bien que mal la loi naturelle et le bien commun qui en découle. Nous sommes les héritiers d’une situation de chrétienté (très imparfaite et pleine de péchés), où la loi du Christ inspirait, au moins en principe, les gouvernants de la Cité. Nous sommes héritiers d’une Cité catholique, dont les gouvernants voulaient être – même s’ils le réalisaient très improprement – comme des pères de famille vis-à-vis de leurs citoyens, pour leur faire pratiquer le bien et les conduire, sans les y forcer (pas plus que le père de famille ne peut obliger ses enfants à croire en Dieu, mais doit les y conduire), à agir religieusement (et donc moralement, de manière très exigeante). Protester contre un ensemble de plus en plus impressionnant de « lois », dans un pays qui fut chrétien, c’est aussi implicitement protester contre la laïcité de l’État, sur laquelle les actes du magistère romain sont tombés durant deux cents ans comme une pluie d’orage.
[1] Christine Boutin, dans « Face aux chrétiens » sur Radio-Notre-Dame du 27 novembre 2011, parla – cas unique chez les politiques – très courageusement contre la contraception, en invoquant une série d’arguments pédagogiques (la contraception ne réduit pas l’avortement, au contraire), dont celui-ci : le respect « écologique » des cycles naturels est finalement plus efficace et bien mieux reçu en Afrique que la contraception chimique.
[2] Cf. Jean-Pascal Perrenx, Théologie morale fondamentale, notamment t. 2, « Les actes humains », Téqui, 2008.
[3] Cf. par exemple, B. Häring, La loi du Christ, Desclée, 1955, pp. 422 ss.
[4] Pie XII, discours du 24 février 1957. Déclaration de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, du 5 mai 1980.
[5] John Finnis, Germain Grisez, Joseph Boyle, Nuclear deterrence, morality and realism, Oxford, University Press, 1987 et Bernard Dumont, « La morale chrétienne et la guerre », Catholica 13, avril-mai 1989, pp. 4-23.
[6] Cf. Pie XII, allocution au Congrès national de l’Union des juristes catholiques italiens, 6 décembre 1953.
[7] « ‘La stérilisation directe’, disions-Nous le 29 octobre 1951, ‘c’est-à-dire celle qui vise, comme moyen ou comme but, à rendre impossible la procréation, est une violation grave de la loi morale, et donc elle est illicite’. […] Il faut rejeter également l’opinion de plusieurs médecins et moralistes qui en permettent l’usage [de pilules utilisées pour empêcher l’ovulation], lorsqu’une indication médicale rend indésirable une conception trop prochaine, ou en d’autres cas semblables, qu’il ne serait pas possible de mentionner ici ; dans ce cas l’emploi des médicaments a comme but d’empêcher la conception en empêchant l’ovulation ; il s’agit donc de stérilisation directe » (discours du 12 septembre 1958, Documents pontificaux de SS Pie XII, 1958, pp. 506 et 507). La question était donc réglée avant Humanæ vitæ et le réexamen par Paul VI entre 1964 à 1968, fut catastrophique pour ses conséquences pratiques.
[8] Les opinions sont partagées entre les moralistes. Elles ne le sont pas, en revanche, pour les avocats. Il y a pourtant des cas où la participation au divorce est possible : faux mariage ; mariage que l’on veut, par ailleurs annuler ; etc.
[9] Ils bloquent l’ovulation, sachant que la fécondation peut intervenir jusqu’à cinq jours après le rapport, l’ovule n’étant lui accessible et en vie que pendant 24 heures après l’ovulation. Même les fabricants avouent que son action contragestive est probable.
[10] Le développement de l’embryon est arrêté, la muqueuse se détache et comme lors des règles, est éliminée.
[11] En soi, la contraception et l’avortement sont « de nature et de poids moral différents » (Evangelium vitæ, n. 13). Mais de fait, les actuelles générations de contraceptifs oraux agissent non seulement pour empêcher la progression des spermatozoïdes et supprimer l’ovulation, mais en tant que de besoin, rendent la muqueuse utérine impropre à la nidation de l’embryon, ce qui est un effet abortif éventuel par évacuation d’un « produit humain ».
[12] On ne peut aucunement s’appuyer sur l’opinion de s. Thomas (suivant la physique d’Aristote) pour excuser l’expulsion de l’embryon dans les premiers jours, sous prétexte qu’il n’aurait pas encore d’âme humaine. Lui-même considère cette expulsion comme l’équivalent d’un avortement, d’autant que, même dans cette opinion, on ne saurait déterminer à quel moment précis interviendrait l’animation, ce qui interdit de prendre tout risque. Le magistère, s’il évoque sans trancher l’éventuelle possibilité d’une distinction entre embryon animé et embryon inanimé, exclut de même qu’elle puisse avoir des conséquences dans l’appréciation morale de l’avortement :
Pie XII : « Quelque fondée que puisse être la distinction entre les différents moments du développement de la vie déjà née ou pas encore née au regard du droit profane ou ecclésiastique, et certaines conséquences civiles et pénales selon la loi morale, il s’agit dans tous les cas d’un grave et coupable attentat à la vie humaine inviolable » (26 novembre 1951).
Vatican II : « La vie doit être sauvegardée avec un soin extrême dès la conception : l’avortement et l’infanticide sont des crimes abominables » (Gaudium et spes, n. 51).
Instruction Donum vitæ : « Certes, aucune donnée expérimentale ne peut être de soi suffisante pour faire reconnaître une âme spirituelle ; toutefois, les conclusions scientifiques sur l’embryon humain fournissent une indication précieuse pour discerner rationnellement une présence personnelle dès cette première apparition d’une vie humaine : comment un individu humain ne serait-il pas une personne humaine ? Le magistère ne s’est pas expressément engagé sur une affirmation de nature philosophique, mais il réaffirme de manière constante la condamnation morale de tout avortement provoqué. Cet enseignement n’est pas changé, et il demeure inchangeable. C’est pourquoi le fruit de la génération humaine dès le premier instant de son existence, c’est-à-dire à partir de la constitution du zygote, exige le respect inconditionnel moralement dû à l’être humain dans sa totalité corporelle et spirituelle. L’être humain doit être respecté et traité comme une personne dès sa conception, et donc dès ce moment on doit lui reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels en premier lieu le droit inviolable de tout être humain innocent à la vie » (Congrégation pour la Doctrine de la foi, 22 février 1987).
Le Catéchisme de l’Église catholique confirme que l’embryon « doit être traité comme une personne dès la conception » (n 2274).
[13] Tenant l’opinion de l’animation non immédiate de l’ovule fécondé, Philippe Caspar, rappelle et explicite la condamnation morale de tout avortement par s. Thomas dans la Somme théologique, IIa IIæ, q 64, a. 1, et le Commentaire des Sentences, IV, d XXXI : « Le respect de l’embryon non encore animé est imposé par un précepte moral dont la valeur est universelle […]. Avant son animation, le produit de la conception humain a pour finalité la réception de son âme rationnelle. C’est une loi de la nature que Dieu amène, par la création de l’âme, à son achèvement parfait. L’embryon, en conséquence a droit à un respect absolu ». Et encore : « Le processus de l’ontogenèse humaine n’a de sens pour l’Aquinate que dans l’acheminement sous le regard de Dieu du produit de la conception vers la réception de la forme humaine. Avant l’animation, le regard divin s’est déjà posé sur l’embryon » (La saisie du zygote humain par l’esprit, Lethielleux, 1987, pp. 350-356).
[14] Le coït interrompu, grande méthode malthusienne jusqu’à l’apparition des contraceptifs oraux, est tout aussi coupable comme péché d’Onan (Gn 38, 8-10), puni par Dieu de mort. L’encyclique Casti connubii de Pie XI (1930) condamne très solennelle cette pratique : « Tout usage du mariage, quel qu’il soit, dans l’exercice duquel l’acte est privé, par l’artifice des hommes, de sa puissance naturelle de procréer la vie, offense la loi de Dieu et la loi naturelle, et que ceux qui auront commis quelque chose de pareil se sont souillés d’une faute grave ».