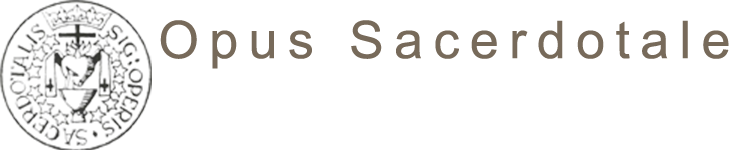Amor Dei congegativus – Pour une ontologie de la division intérieure. Désintégration et réunification de la personne humaine chez S. Thomas d’Aquin – par M. l’Abbé C. Debris, thèse de l’ISTA, Toulouse
Soutenance de la thèse de doctorat en théologie
Toulouse, Couvent des Dominicains, lundi 10 décembre 2012, 15h
Histoire de la thèse
Lorsque l’archevêque de Rouen m’autorisa en 2008, à l’issue de ma licence canonique, à poursuivre durant 2 ans à temps plein des études doctorales en théologie, bien qu’il m’eût proposé de continuer à l’Institut Jean-Paul II sur le mariage et la famille dans l’antenne de Washington, je l’incitai à m’accorder une modification du plan d’études. Je préférai étudier à l’Institut St. Thomas d’Aquin de Toulouse dont plusieurs personnes m’avaient vanté les mérites. Surtout je voulais enfin pouvoir approfondir auprès de vrais thomistes, dans l’Ordre même qui m’est cher et auquel St. Thomas fait honneur, cette pensée quelquefois un peu intimidante pour quelqu’un qui n’aurait pas baigné dedans depuis le noviciat. Certes, la pensée du Bx. Jean-Paul II m’avait enthousiasmé, surtout dans l’approche américaine où à côté de la théologie du corps, j’avais tellement apprécié son anthropologie fondamentale. Car, que l’on ne s’y trompe pas, avant d’être une réflexion sur la théologie morale spéciale (morale familiale ou sexuelle), la pensée de Karol Wojtyła est avant tout une anthropologie fondamentale qui trouve, de manière exemplaire, une illustration dans les questions sexuelles. Mais, quoi qu’en disent certains, le Saint-Père avait reçu une formation thomiste, habituelle à cette époque, qu’il s’était appropriée et qu’il avait continué à élaborer, en la faisant dialoguer avec sa revisitation de la phénoménologie. Personne et Acte, l’ouvrage le plus abouti de la pensée philosophique de Karol Wojtyła, ne paraissait pas abordable en profondeur sans maîtriser un miniumm les outils philosophiques et théologiques de réflexion qui lui furent fournis par l’anthropologie de St. Thomas d’Aquin. La lecture d’un article consacré au « perfectiorisme »[1] m’aida : l’homme devait devenir « plus parfait » (sic : « perfectior » en latin) ou vraiment et pleinement lui-même dans le don, par la communio personarum comme elle se vit dans la Sainte-Trinité à l’image duquel il est créé. Cela a été dogmatisé dans Gaudium et Spes 22 et 24 « le Christ (…) manifeste pleinement l’homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation (…) : l’homme (…) ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même ».
Cela rejoignait une de mes intuitions. À savoir que l’homme souffre de n’être pas ce qu’il devrait être. Je suis frappé souvent de recevoir des confidences qui me le prouvent, à l’occasion d’une conversation profonde et intime avec bien des gens, à la Nicodemusstündchen, en seconde partie d’une soirée lorsque l’assemblée s’étant étiolée, les sujets deviennent plus graves et plus vrais. Lorsque s’éteint le babillage des mondanités, les gens parlent alors sans fard et combien expriment de manière plus ou moins thématiséee la même souffrance de ne pas être la personne que l’on sent que l’on devrait être. Quel hiatus n’y-a-t-il pas entre ce que j’appellerai les deux rives de l’être ! L’être rêvé, idéalisé (souvent pour de mauvaises raisons), et l’être réel, si souvent décevant de médiocrité. Cette dichotomie peut revêtir une multitude d’atours : les frustrations d’études ou professionnelles plaquées sur sa progéniture ; la question des enfants du divorce qui sont comme tués symboliquement puisque l’amour qui devait durer toujours et qui les a fait naître a naufragé et que les parents se sont séparés ; la souffrance de ne pas se sentir accueilli et pleinement reconnu dans son identité sexuelle car tel parent voulait qui un garçon et a eu une fille, qui l’inverse (et alors on peut très vite embrayer sur des problématiques très actuelles liées à l’homosexualité) ; le syndrome du survivant qui fait peser l’atroce menace existentielle sur ceux qui viennent au monde en portant le prénom d’un aîné défunt ou dans une fratrie décimée par le crime de l’avortement : pourquoi ne suis-je pas mort comme tel de mes frères ou de mes sœurs ? Ai-je le droit de vivre la vie que je vis ? On court alors après des fantômes qui toujours échappent à toute emprise mais détruisent la vie !
La littérature vient illustrer par ses œuvres ce genre de problématiques qui souvent sont l’expression sublimée de traumatisme de leur auteur, comme par exemple la fascinante vie de James Matthew Barrie, l’auteur de Peter Pan. Il essaya, à la mort de son frère David à 13 ans, le préféré de la mère, d’acheter sa place dans son cœur en se privant de vivre sa propre vie pour la consoler. James alla jusqu’à s’habiller avec les vêtements du défunt et à imiter son sifflement pour lui offrir un succédané de David. Mais avant tout cela, la scène est déchirante où il rendit visite à sa mère, demeurée prostrée pendant un an après la perte de son préféré :
« Ma mère était allongée dans son lit, avec la robe de baptême à ses côtés. Je l’observais à la dérobée à de nombreuses reprises et me dirigeais vers l’escalier pour m’y asseoir et pleurer. Je ne sais pas si ce fut ce jour-ci, le premier, ou plusieurs jours après, que vint ma sœur, la fille préférée de ma mère . Oui, elle l’aimait encore plus que moi, j’en suis certain. La gloire de cette sœur remonte à mes six ans. L’adolescence la quittait. Elle vint à moi, le visage marqué par l’anxiété et les mains tordues ; elle m’incita à aller au chevet de ma mère, afin de lui dire qu’elle avait toujours un autre petit garçon. Je me rendis donc à son chevet, excité. Mais la chambre était noire et, quand j’entendis la porte se refermer et qu’aucun son ne provint du lit, je fus effrayé. Je me tins sans bouger. Je suppose que je respirai bruyamment ou peut-être que je pleurai, car, après un certain temps, j’entendis une voix apathique, qui ne l’avait jamais été auparavant, dire : ‘Est-ce toi ?’. Je pense que le ton me fit mal, puisque je ne répondis pas. La voix répéta avec plus d’anxiété que la première fois : ‘Est-ce toi ?’. Je pensais qu’elle s’adressait au petit garçon mort et je dis d’une petite voix esseulée : ‘Non, ce n’est pas lui, ce n’est que moi !’. J’entendis un cri et ma mère se retourna dans le lit et, bien qu’il fît noir, je sus qu’elle me tendait les bras » (in Margaret Ogilvy).
La publicité qui encombre notre société a parfaitement compris ce profond ressort de la psychologie humaine. Elle s’efforce de lier une image à un produit : qui veut s’approprier l’image d’un corps parfait, de la beauté etc… est incité à acquérir le produit qui s’en fait le vecteur. Le consommateur achète alors avant tout une part de rêve.
Voulant revenir à l’œuvre essentielle de la pensée de saint Thomas, la Summa Theologiæ, sans se perdre dans les commentaires postérieurs de cette œuvre majeure, cette thèse se propose modestement d’en donner une lecture synthétique sur le thème de la division intérieure. J’ai baptisé ainsi ce thème à partir de GS 10 : « En somme, c’est en lui-même [que l’homme] souffre division » et je cite un peu plus amplement ce passage : « En vérité, les déséquilibres qui travaillent le monde moderne sont liés à un déséquilibre plus fondamental qui prend racine dans le cœur même de l’homme[2]. C’est en l’homme lui-même, en effet, que de nombreux éléments se combattent. D’une part, comme créature, il fait l’expérience de ses multiples limites ; d’autre part, il se sent illimité dans ses désirs et appelé à une vie supérieure. Sollicité de tant de façons, il est sans cesse contraint de choisir et de renoncer. Pire : faible et pécheur, il accomplit souvent ce qu’il ne veut pas et n’accomplit point ce qu’il voudrait [cf. Rm 7, 14 ss]., et c’est de là que naissent au sein de la société tant et de si grandes discordes ». Puisqu’on compare souvent la Somme à une cathédrale, nous ne faisons que proposer une visite guidée thématique, portant un coup de projecteur sur tel détail en particulier lorsque nous voulons nous attarder sur tel point qui apporte à notre réflexion sa moisson d’éléments de réflexion.
- Thèse défendue
Bien qu’attiré par la réflexion psychologique pour traiter cette thématique de la division intérieure, il semble que cette approche montre vite ses limites. Ne serait-ce que parce qu’elle refuse a priori la transcendance et donc qu’au mieux, même si elle aide les hommes à nommer certains nœuds gordiens de leur personnalité, elle les laisse seuls face à un mur, celui de leurs propres contradictions, sans véritable solution. Ce mur de la haine contre soi-même, celui-là aussi que Jésus-Christ est venu abattre[3]. Or, sans la grâce, n’y aurait-il pas de quoi désespérer franchement ? De plus, la psychologie ne permet pas d’atteindre, au-delà des blessures de chacun qui sont nécessairement contingentes, un niveau beaucoup plus profond, et partant, au moins partiellement généralisable. Refusant aussi la notion de péché, la psychologie se ferme à la rédemption et à tout chemin de conversion. La théologie, liée à une saine philosophie de l’être peut apporter sa pierre à ce questionnement contemporain.
Or, la thèse que nous défendons est qu’il doit être possible d’élaborer une réflexion théologique anthropologique mais d’ordre métaphysique, plus précisément ontologique, sur la division intérieure qui désintègre la personne humaine et sur les moyens d’y remédier, par une réunification de l’homme intérieur.
Il nous semble en effet que l’homme est un étant imparfait, marqué dans son être même au coin de l’incomplétude. Son être n’est donc pas totalement dans le déjà-là[4]. Il doit être complété, perfectionné et particulièrement dans l’agir. Mais le péché vient compliquer cet agir. Il est assimilable à un déficit d’être. Nous pourrions l’appeler « inadæquatio entis »[5] dans la mesure où il fait que le pécheur ne suit pas sa forme, qui est rationnelle. Cela est dû à la passibilité de l’homme, ontologique et morale. Ontologique d’abord car : « qui dit passion dit un certain manque, car la passion appartient à un être selon qu’il est en puissance. C’est ce qui explique que chez les êtres plus proches de la perfection suprême, c’est-à-dire de Dieu, on trouve peu de potentialité et de passion ; et davantage chez les autres. De même, dans la première puissance de l’âme, qui est la puissance appréhensive, la raison de passion se vérifie moins bien »[6]. Morale ensuite car emporté par ses passions, l’homme se rabaisse au rang des animaux, voire en-dessous d’eux. Et d’une certaine manière, on devrait soigner ce déficit d’être par un surplus d’être. Mais sa source n’est pas qu’en l’homme, elle est d’abord en Dieu. Dieu qui est acte pur, cherche à Se donner à ce mélange de puissance et d’acte qu’est l’homme : le faisant passer de moins de puissance à plus d’acte en Se L’assimilant par la grâce, les vertus et les dons de l’Esprit Saint. Il nous semble en effet que la vertu est – comme habitus – un entre-deux ontologique entre puissance et acte[7] et qu’une fois possédée, elle consolide l’être par sa permanence car l’habitus devient connaturel et intègre tout ce qui est nécessaire à sa bonté[8].
Comme le sujet de certaines vertus est dans l’appétit sensible, spécificité thomasienne, nous voyons bien que le Docteur Angélique entend ne pas limiter l’intégration aux seules facultés spirituelles de l’âme mais étendre l’emprise de la raison à tout le composé humain, y compris le corporel évidemment. Il s’inscrit dans la logique biblique globale (cf. « le corps n’est pas pour la fornication ; il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps » 1 Co 6, 12) et rejette ainsi tout dualisme anthropologique car il serait trop facile de se contenter d’une unification partielle de la personne humaine. La métaphysique de l’amitié inspirée d’Aristote va dans le même sens. Autrement dit nous pensons que la morale débouche sur la métaphysique, que l’agir implique une répercussion sur l’être même. Que la vie du vrai chrétien (qui doit être un saint) est au fond le seul moyen d’atteindre la véritable perfection comme nous l’enjoigne le Christ lui-même : « soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5, 48).
- Esprit de la recherche
Nous avons donc parcouru, sans évidemment pouvoir prétendre à l’exhaustivité, la Somme de théologie de St. Thomas et avons voulu en faire une lecture transversale. L’intérêt propre de notre travail me semble fourni par sa cohérence, la profonde unité organique de son questionnement. Ce thème de la division intérieure aboutit à produire une synthèse cohérente qui revisite à nouveaux frais (parce que nouvelle et contemporaine est la problématique) une œuvre si traditionnelle. Cette synthèse s’inspire du plan même de la Somme et aussi au fond de la théologie du corps de Jean-Paul II qui après une introduction sur la question du divorce en Mt 19 repart vers le projet divin à l’origine. Il importait donc de voir d’abord quelle était la situation de l’homme avant la chute, dans une sorte de préhistoire théologique comme dirait le Bx. JPII. Puis le péché faisant entrer l’homme dans l’histoire, il fallait en étudier les conséquences au niveau anthropologique. Enfin, l’homme étant racheté par l’Incarnation et la Passion du Christ, il fallait s’attarder sur les moyens que le Fils de Dieu donne pour non seulement guérir (vision un peu trop superficielle et moderne) mais bien être sauvé et partant, atteindre une perfection de l’être par la divinisation. Cette perspective intègre aussi l’exitus-reditus de St. Thomas et va de la protologie à l’eschatologie puisque ce n’est qu’à la fin des temps que se réalisera pleinement la véritable perfection de l’être, même pour les âmes déjà bienheureuses.
Puisque nous ne pouvions accorder le même traitement à tous les thèmes, il me semble intéressant d’énumérer les principaux thèmes sur lesquels nous avons pu nous attarder :
- Le traitement inclusif des passions humaines (pour une intégration profonde de la corporéité), telles qu’elles étaient en Adam (rectitude originelle) et chez le Christ (pro-passions) et doivent le devenir en l’homme vertueux (composant avec ce pouvoir politique et non despotique).
- Parmi les passions, une place éminente est laissée à l’amour (qui vise à aller au profond de l’être et nécessite une certaine « liquéfaction ») et nous étudions ensuite la vertu théologale de charité avec son aspect unificateur.
- Le fomes peccati en ces conséquences, en particulier sur la raison qui ne parvient plus à se faire obéir.
- L’autre faculté supérieure sur laquelle nous nous sommes encore plus appesantis était la volonté humaine et le traitement de ses travers, par contrepoint négatif avec ce qu’on attendrait d’une action juste soumise à la prudence : l’akrasia (faiblesse de volonté), la velléité, la négligence et acédie, la distraction (et le divertissement), l’incontinence. Le modèle pour l’unité des volontés étant bien sûr en Jésus-Christ, exemplaire parfait.
- Le rôle que l’imagination peut jouer dans le péché.
- L’analyse approfondie des vertus cardinales de force et de tempérance qui doivent régler la sensibilité en la plaçant sous le contrôle de la raison.
- La dimension eschatologique incluant les corps glorieux et la signification, pour notre problématique, de leurs propriétés de subtilité et agilité en particulier.
- Principaux apports
L’homme est ontologiquement plus fragile que Dieu ou les anges qui sont respectivement acte pur ou acte unique. Ce passage de la puissance à l’acte est l’un des lieux de la recherche de l’unité puisqu’advient alors le risque de ne pas réaliser toutes ses potentialités. Le composé hylémorphique : une âme qui informe un corps, peut être après la Chute un autre lieu de la tension. Pour être à la hauteur de sa vocation et dignité, l’âme humaine doit contrôler le corps qu’elle informe et lui donner son unité. En effet, le corps peut se laisser éparpiller au gré des sollicitations sensibles perçues. Dans la hiérarchie des étants, plus la forme est élevée et a d’emprise sur la matière, moins elle y est enfoncée.
Déjà ontologiquement parlant, Dieu complète l’essence de l’homme par l’acte premier d’exister (esse) et le met en relation permanente avec Lui. Les actes seconds ou agir de cette substance la perfectionnent. Mais là, les passions jouent un rôle essentiel. Or, elles ne sont pas aussi soumises au pouvoir despotique de la raison et volonté comme les membres du corps, mais jouissent d’une propre autonomie. Ce pouvoir n’est donc que « politique », comme toujours en négociation. Les passions peuvent influer sur la volonté qui est libre dans l’ordre des moyens et peut donc se tromper sur le chemin censé mener à la fin, qui doit être Dieu et la béatitude. Il faut donc l’aimer en tout.
L’amour est centrifuge : il me fait sortir de moi-même (au contraire de l’intellect qui fait entrer la chose à connaître en moi). Mais cela n’éclatera pas ma personne si je m’unis à un être supérieur (Dieu) ou au moins égal (un autre humain mais vertueux), car alors je vais comme partager avec lui la même forme (amitié de bienveillance) qui informe totalement sa matière. Les réalités inférieures, il vaut mieux se contenter de les connaître et non pas s’y attacher par amour pour ne pas contracter de tache (macula). L’amour veut pénétrer jusqu’en l’intime de l’être aimé, ne se contentant pas d’une connaissance superficielle. Cela implique une certaine « division » mais saine, entendue comme liquéfaction (contraire de la congélation, crispation sur soi qui empêche toute rencontre intime), précédant l’extase et le transpercement jusqu’au plaisir. La pensée cartésienne privilégie à tort la vision d’un empiètement sur l’espace propre de liberté (Lebensraum). Or la rencontre de l’autre dans l’amour est la condition de possibilité pour atteindre la vraie joie, suivant le modèle trinitaire.
La passion désigne un mouvement de l’appétit sensible où l’âme se porte vers un bien ou un mal présenté par les sens (élément formel). Elle implique une modification corporelle qui reçoit une nouvelle forme en remplaçant une autre (élément matériel). Les passions sont le lieu de la conquête de l’unité par la pratique des vertus qui recherchent un juste milieu entre deux extrêmes (« médiocrité » des passions) pour en utiliser l’énergie (la colère pour la force par exemple). Seules les passions ressenties « comme il ne faut pas et quand il ne faut pas » sont à rejeter comme excessives, contraires à la raison. Dans son état de rectitude, Adam avait une chaîne de trois maillons d’obéissances successives : l’âme obéissait à Dieu, l’appétit sensible obéissait à la raison et à la volonté, le corps obéissait à l’âme. La rectitude s’accompagnait du don préternaturel de l’immortalité : Dieu empêchant sa corruption faisait que la forme (l’âme) maîtrisait totalement sa matière. Cela fut perdu et commença l’éclatement ou désintégration de la personne. St. Thomas définit ainsi le fomes peccati : « la justice originelle était le lien qui maintenait dans l’ordre toutes les facultés de l’âme. Chacune d’elles, une fois ce lien brisé, tendra à son propre mouvement »[9], d’où un sentiment commun d’éparpillement, comme une dissolution de l’être.
Dans une seconde partie, nous avons traité de de la personne humaine dans l’état post-lapsaire. Le mal est défini comme privation d’un bien attendu, dû suivant la nature de la personne. Il est donc un manque d’être, inadéquation avec la forme rationnelle qu’on attendrait. Le pécheur est prisonnier de ses sens, qui ne lui donnent accès qu’à des particuliers. Il survalorise, par la concupiscence, un bien inférieur sans l’ordonner au Bien Suprême, Dieu. Le péché est donc aversion de Dieu par conversion à un bien inférieur. Cela conduit les pécheurs à une détestation de soi car ils aiment en eux juste l’homme sensible alors qu’ils sont voulus rationnels. Ils ne trouvent pas la paix intérieure (la conscience est remplie de remords). Le péché est donc accidentellement sa propre peine : l’inadéquation à ce qu’on devrait être. C’est comme une punition divine pédagogique, pour le principal péché qu’est l’orgueil, qui surtout s’attribue à soi-même ce qu’il tient de Dieu.
Pour qu’une action soit bonne, il lui faut une quadruple bonté : de son être, de son objet, des circonstances et de l’intention ou fin. S’il manque un seul élément, survient déjà le mal (bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu). Donc à une vertu s’opposent plusieurs vices car le péché est toujours un certain éparpillement alors que le bien unit. Il est presque plus aisé d’être vicieux que vertueux : cela demande un certain effort. Mais la vertu correspond pourtant à notre aspiration profonde puisqu’elle est une perfection naturellement attendue allant jusqu’au fond de l’agir sensible pour qu’y domine la raison. Il n’y a pas de neutralité possible (vouloir les biens inférieurs sans rejeter Dieu).
La raison où siège la prudence perd avec la Chute son ordination au vrai et tombe dans l’ignorance (hébétude et cécité de l’esprit). Ce peut être une faute aussi si cet esprit aveuglé pèche soit en se détournant de ce principe (malice) ou en ayant l’esprit occupé par des biens inférieurs qui l’en éloignent (distraction). Les plaisirs violents sensuels empêchent de s’adonner, en s’extrayant du sensible, à l’activité rationnelle nécessaire à toute vie droite car l’homme est limité et ne peut tout mener de front.
L’imagination ou fantaisie contribue à cette désintégration de la personne. Ayant son siège dans le composé, elle n’est pas totalement dépendante de la raison. Chez l’homme vicié, le jugement est perverti et suit l’apport violent des sensations fait par l’imagination. Or, comme les sens sont un élément essentiel et primordial du processus gnoséologique (« nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu »), il faut apprendre à maîtriser « politiquement » l’imagination, « comme les enfants de la maison qui, d’une certaine manière, mènent et sont menés ».
La volonté où siège la justice perd son ordination au bien et tombe dans la malice (endurcie envers le bien). La volonté doit adhérer au bien absolu, comme l’intellect, et pas qu’à des biens particuliers comme l’appétit sensible. Il peut y avoir une disproportion entre l’acte en son intensité, et l’intention. Par exemple, l’incontinent ne veut pas avec assez d’intensité aimer Dieu et donc renoncer à certains plaisirs (comme le malade absorbe un remède dégoûtant (voluntas ut ratio, boulésis) pour son bien qu’est la santé (voluntas ut natura, thélésis)). La velleitas désigne cette volonté qui n’est pas ensuite appliquée dans la réalité. Il arrive aussi que la volonté, entre deux biens appréhendés comme équivalents, soit hésitante, indécise (donc imparfaite) comme « l’âne de Buridan » : c’est la négligence, défaut dans l’élection (nec eligere). L’homme en reste au plan du « velle aut non velle » (universel) au lieu de descendre au niveau du « velle hoc aut illud » (singulier).
L’acédie est une tristesse accablante poussant l’homme à ne plus agir, en particulier spirituellement. C’est aussi une résistance aux exigences de l’amour, surtout dirigée contre nous-mêmes plutôt que contre Dieu, à la nature duquel nous participons par la charité. On ne veut pas être transformé intérieurement par la grâce, se convertir en payant le prix par des renoncements. Mais l’échappatoire requiert souvent un épuisant effort inverse. Or, la tristesse est fuie, par des distractions, souvent d’ordre corporel.
L’homme est une créature limitée. S’adonner à une activité implique par là-même le renoncement à d’autres. L’homme doit donc choisir les moyens d’atteindre sa finalité. Le démon fait perdre de vue, par amnésie, la bonté initiale de la proposition divine, pour déplacer l’angle vers les seuls renoncements, bref une privation comme pour la tentation chez Eve (Gn 3, 2-5). La distraction est l’état de celui qui se laisse assiéger par de multiples (pré-) occupations pour éviter de passer au stade réel de l’élection, en particulier d’un état de vie. Selon Pascal le divertissement se répand en activités extérieures pour éviter l’intériorité où rencontrer Dieu, donc de se poser la question essentielle du salut et du sens de la vie qui doit le rechercher (en lien avec l’omission).
Donc, il faut que la volonté aille jusqu’au bout, dans l’opération et ne s’arrête pas en chemin. Le monde actuel relativiste où tout se vaudrait sape l’engagement. Pour Pinckaers, la révolution nominaliste a fait éclater le noyau de la personne humaine (en son âme et ses facultés). La liberté d’indifférence est de pouvoir choisir telle chose ou son contraire sans inclination préalable (pure indétermination). Le primat revient à la volonté, hors de la coopération de l’intellect. La finalité ou les inclinations naturelles sont rejetées. Les vertus qui les aident à opérer de manière stable et les perfectionnent sont réduites à de simples habitudes. Chaque acte est valorisé pour lui-même, sans référence au passé (fidélité) ou à l’avenir (promesse). Même Dieu est réduit à de l’arbitraire (il pourrait changer de volonté), puis fut finalement éliminé par des philosophes comme un obstacle à la liberté humaine. Ce non-engagement serait la conséquence d’une absence de Vérité ou Bien Suprême (relativisme).
Les plaisirs sont mauvais s’ils sont contraires à l’activité principale. En particulier, les plaisirs sensibles qui empêchent la contemplation, sont néfastes : soit ils mobilisent toute l’énergie, soit leur excès contrarie la raison, soit ils lient les capacités rationnelles. La division intérieure peut se manifester dans le corps, qui nous est le plus uni. L’incontinence est due à un syllogisme pratique dévié qui n’applique pas à la situation concrète les principes moraux sains auxquels tient la personne (ce qui la fait souffrir). Elle utilise deux majeures qui s’opposent accidentellement : celle suggérée par la passion et celle de la connaissance habituelle. L’acte de l’incontinent est certes volontaire mais ne provient pas d’un choix ! Cela ressortit non pas à un problème âme-corps mais à l’intérieur même des facultés supérieures de l’âme, entre la raison et la volonté qui en est le siège. Elle est provoquée par une modification physique causant une passion excessivement intense qui s’oppose et distrait tout à la fois la personne de sa connaissance universelle habituelle.
Dans une dernière partie, nous avons présenté les moyens que Dieu nous donne dans le difficile combat pour reconquérir l’unité intérieure de la personne humaine. La sanctification ou divinisation est la fin qui nous est assignée, mais elle est totalement hors de portée par nos propres moyens. Dieu donne alors à Ses amis les moyens de L’atteindre. La métaphysique de l’amitié nous attribue comme mérite propre ce que nous aurons laissé Dieu faire de bon en nous : « Ce que nous ne pouvons faire qu’avec le secours divin ne nous est pas tout à fait impossible, car, dit le Philosophe : ‘Ce que nous pouvons par nos amis, nous le pouvons de quelque façon par nous-mêmes’ ». L’homme vertueux est aussi son propre ami (vit en harmonie avec soi-même) car il a fait pleinement l’unité de sa vie.
Toute vertu consolide l’être. Un habitus vertueux est nécessaire à chaque fois que la puissance ne trouve pas en sa propre essence de quoi se perfectionner elle-même comme lorsqu’on veut le bien de Dieu (charité) ou d’autrui (justice). L’habitus entitatif (la grâce qui s’attache à l’essence) ou opératif (vertu), disposition stable de l’âme dans l’agir humain, est un entre-deux ontologique entre la puissance et l’acte. Si l’habitus est un accident, il touche pourtant la profondeur de l’être. La vertu de charité en particulier consolide car elle fait participer de l’être même de Dieu par la communication du St. Esprit qui donne la forme divine. L’homme aimant Dieu passe à un degré d’être plus grand : de moins de puissance à plus d’acte, puisque Dieu est acte pur, sans aucun mélange de potentialité. L’habitus tend à s’assimiler progressivement à la nature (ou essence) par la connaturalité, comme une sédimentation de la bonté des choix précédents qui crée une propension à reconduire ce type d’actes et transforme aussi la personne (actions intransitives).
« Toute action aura autant de bonté qu’elle aura d’être ». La vertu morale perfectionne la partie appétitive de l’âme pour la conformer à la droite mesure de la raison. La vertu permet à la raison de contrôler les puissances inférieures pour leur imposer sa propre règle et en capter l’énergie. Elle est un accident inhérent à la substance (l’âme) par l’intermédiaire d’un autre accident (la puissance perfectionnée). Les vertus ordonnent les passions au lieu de les annihiler, sachant les utiliser quand il faut et comme il faut. Les vertus cardinales consistent donc dans le juste milieu, entre le défaut et l’excès. Par contre la charité et les autres vertus théologales n’ont pas d’excès.
Force et tempérance sont donc les deux seules vertus ayant trait aux passions (du concupiscible et de l’irascible). Elles ont pour objet la personne agissante elle-même, au contraire des autres, orientées vers le prochain (la justice) ou Dieu (les théologales). Et même la tempérance est seule à être uniquement tournée vers la personne (puisque la force se tourne contre le mal). Soumises à la raison, ces deux facultés augmentent le plaisir de l’agir.
De la force nous retiendrons surtout qu’elle comporte la persévérance, qui fait durer dans la tâche difficile, moins face à la mort qu’à la maladie ou à la pauvreté etc.. et dans le combat pour la sainteté. Elle tient toute la vie dans la vertu et empêche la velléité dans la poursuite du bien, comme par fatigue qui peut nous faire rechercher un plaisir compensatoire (par ex. chez les mous, suite à une impulsion passionnelle légère). La patience, qui siège dans le concupiscible, « nous fait supporter nos maux [infligée par les autres] d’une âme égale [équanimité] en souffrant ce qui nuit présentement, de telle sorte qu’il n’en ressent pas une tristesse désordonnée ». Elle permet d’aller jusqu’au bout de la route des vertus et de la vie chrétienne, d’encourir des maux présents pour des biens futurs invisibles dont l’existence n’est affirmée que par la foi et l’obtention que par l’espérance et la charité. La patience est liée intimement à la charité qui fait tout supporter pour l’amour de Dieu. On est loin de la morale du pur devoir kantien.
La tempérance modère les passions concupiscibles, plaisirs ou tristesses en l’absence des délectations. La raison, étant notre différence spécifique, nous distingue du genre animal. Les plaisirs animaux les plus forts relèvent du toucher et concernent la conservation de l’individu (nourriture et sommeil) ou de l’espèce (sexualité). Les vices liés à l’intempérance au sens large sont répandus et durables souvent. Le tempérant n’est pas un insensible : face aux choses de la vie, il « s’en sert autant qu’il faut pour les nécessités de cette vie et de ses tâches, avec la modération de l’usager, et non avec la passion de l’amant’ ». Les plaisirs intellectuels sont plus grands dans l’absolu car on renoncerait à de plus grandes choses pour eux, on leur est lié par la partie qui nous est la plus noble, ils sont plus intimes (ne s’arrêtent pas aux accidents), sont sans mouvement (peuvent être tous ensemble) et plus fermes. Mais les plaisirs sensibles sont plus véhéments car le sensible est plus connu de nous, ils modifient le corps, servent parfois de remèdes contre les tristesses. Le plaisir sensible concerne tout le monde, mais pas l’intellectuel qui exige aussi un effort. La tempérance est finalement moins réfréner les pulsions sensuelles qu’une disposition harmonieuse des parties d’un tout recevant ainsi ordre et unité (Pieper). Elle permet à l’âme de jouer entièrement son rôle ontologique en informant le corps totalement, d’où un rejaillissement de beauté, de tranquillité et joie.
Mais après les vertus cardinales, il faut revenir sur la vertu théologale de la charité. Elle est l’aboutissement de l’unité intérieure qui ne se replie par sur elle-même mais se donne à Dieu en retour car elle s’est reçue de Lui. L’amour se fonde sur la similitude. Le progrès spirituel dans la charité fait passer de l’amitié utile à l’amour d’amitié puisqu’elle commence par relier deux personnes dont l’une seulement a en acte une qualité, vers une relation où les deux la possèdent (malgré la disproportion insurmontable par rapport à Dieu). L’amour de convoitise (amitié utile) unit par causalité efficiente à ce qui perfectionne mon être propre, l’amour d’amitié unit par causalité formelle celui qui est devenu comme un autre moi-même. On distingue ainsi trois manières d’union : substantielle quand c’est l’amour de soi, union de ressemblance pour les autres (quelque chose pour soi ou autre soi-même) et union réelle qui recherche une vie commune. L’amour unifie donc car on veut pour soi le bien auquel on cherche à s’unir et ce bien est soi-même, aimé en Dieu, qui est le modèle par excellence de l’unité de l’être. L’ordo caritatis est fondé sur la communication de la béatitude qui implique d’aimer Dieu en premier car cause de la béatitude, de s’aimer soi qui y participe directement (unitas) ou nous est associé chez nos proches (unio sive consociatio) et enfin qui rejaillit sur notre propre corps. L’amour de soi, justement compris, est dérivé de l’amour pour Dieu (on est uni à Dieu par charité et on aime tout ce qui Lui appartient, dont soi-même).
La paix est le fruit de cet amour d’amitié avec Dieu qui est une conformation : on partage avec Dieu la même forme, ce qui nous pousse à agir comme Lui. La paix est plus large que la concorde car elle n’est pas qu’entre deux personnes ayant un seul cœur et une seule âme, mais aussi en soi, paix de tous les mouvements de l’appétit (sensible ou rationnel, possédant tout ce qui lui convient). La vraie paix ne sera que dans la patrie céleste et ici-bas, elle est imparfaite mais « nous aimons Dieu de tout notre cœur au point de lui rapporter tout ; et ainsi tous nos appétits sont unifiés »[10]. L’homme qui aime Dieu est libéré des sollicitudes (soucis) car il s’en remet à la sollicitude divine (Providence).
L’eschatologie nous informe aussi sur l’unité de la personne humaine, ou au contraire sur l’aboutissement de la division intérieure. En effet, tout le monde n’est pas admis au Paradis. Les réprouvés sont envoyés en enfer où ils sont retenus par leur corps, châtiment de l’âme qui lui interdit l’exercice de sa volonté pour agir comme elle veut. Cette âme aussi unie au feu en conçoit une indicible horreur. Comme ces damnés ont été dispersés en appétant une multitude de biens inférieurs durant leur vie, ils seront punis par une multitude de peines. Après la Résurrection finale, les vers seront les souffrances rejaillissant de l’âme sur le corps, les pleurs seront la peine pour l’ancienne délectation dans la faute, affliction partant de l’intérieur du corps. Au contraire, le corps glorieux des bienheureux a plusieurs propriétés. Le don de subtilité se rapporte à l’âme en tant que forme : la matière du corps est totalement pénétrée et informée par l’âme sans aucun obstacle. La personne est totalement ce qu’elle doit être. À cette perfection dans l’acte premier s’ajoute celle dans l’acte second : l’agilité se rapporte à l’âme en tant que moteur du corps « pour qu’il soit effectivement rapide et habile à obéir à l’esprit en tous ses mouvements et dans toutes les actions de l’âme ». L’homme fait ce qu’il doit faire. La clarté sera le reflet corporel de la gloire de l’âme « comme un vase de cristal reflète la couleur de l’objet qu’il renferme ». Enfin, l’impassibilité désigne l’impossibilité d’être conformé ad extra à une forme mauvaise, contraire au bien de sa nature (donc par défaillance de sa forme propre). Le fomes peccati sera dépassé car la potentialité de l’être sera totalement liée par l’âme.
[1] Wojtyła, Karol, « In search of the Basis of Perfectiorism in Ethics », in Person and Community : Selexted Essays, transl. by Theresa Sandok, OSM, Peter Lang Publishing, New York, 1994, p. 45-55.
[2] Cf. Jc 4, 1 : « D’où viennent les guerres, d’où viennent les conflits entre vous ? N’est-ce pas justement de tous ces instincts qui mènent leur combat en vous-même ? ».
[3] « Car c’est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n’en a fait qu’un, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine » (Eph 2, 14).
[4] Pourtant ô combien essentiel car il est tellement minoré aujourd’hui (la tabula rasa du nominalisme).
[5] Transposition de la définition de la vérité qui est solide, enracinée dans un juste rapport au réel. Cf. I, 16, 1 : « quaedam definitio Avicennae, veritas uniuscuiusque rei est proprietas sui esse quod stabilitum est ei. Quod autem dicitur quod veritas est adaequatio rei et intellectus potest ad utrumque pertinere ».
[6] I-II, 22, 2, ad 1.
[7] I-II, 71, 3 : « Habitus medio modo se habet inter potentiam et actum ». I, 77, 1, ad 5 : la puissance se situe entre l’accident (pris comme l’un des 5 prédicables) et la substance. I-II, 50, 4, obj. 2.
[8] Cf. I-II, 56, 1, ad 3 (d’où l’on déduit que la vertu est un accident, mais entitatif) et I-II, 78, 2. Cf. I-II, 18, 1 : « omnis actio, inquantum habet aliquid de esse, intantum habet de bonitate, inquantum vero deficit ei aliquid de plenitudine essendi quae debetur actioni humanae, intantum deficit a bonitate, et sic dicitur mala, puta si deficiat ei vel determinata quantitas secundum rationem, vel debitus locus, vel aliquid huiusmodi ».
[9] I-II, 82, 4, ad 1 : « soluto vinculo originalis iustitiae, sub quo quodam ordine omnes vires animae continebantur, unaquaeque vis animae tendit in suum proprium motum ».
[10] II-II, 29, 3.