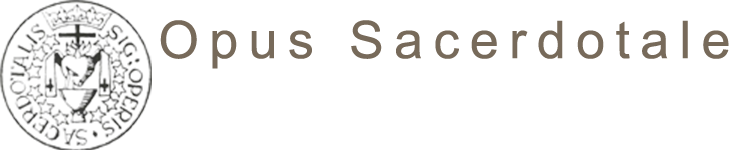Res Novæ – décembre 2024
L’ultime cri de Bernanos
Nous publions ici, avec l’aimable autorisation des Éditions de L’Homme nouveau, l’introduction à l’Encyclique aux Français. Le testament politique de Bernanos, que nous recommandons vivement de commander : Encyclique aux Français – L’Homme Nouveau
« Ce qui s’est prodigieusement affaibli dans l’Église depuis deux cents ans, c’est la vertu de Force. Sans la vertu de Force, la charité elle-même se dégrade et s’avilit. » Les pages de Georges Bernanos ici publiées sont, à la lettre, testamentaires. Il les a rédigées en avril et mai 1948 sur deux cahiers en y portant le titre : Encycliques. Les éditeurs ont pris le parti de titrer Encyclique aux Français. Il est probable en effet, que ce texte était une suite de la Lettre aux Anglais, toute aussi puissante, rédigée en 1940-1941, et qu’il annonçait une troisième encyclique destinée aux Allemands[1].
Georges Bernanos écrit ce testament politique alors qu’il vient à peine d’achever les dialogues d’un film inspiré par La dernière à l’échafaud, de Gertrud von Le Fort, que lui a demandés le P. Bruckberger, Dialogues des carmélites, qui représentent véritablement son testament spirituel. Rentré du Brésil en juin 1945, il est bien vite tombé dans un grand sentiment de solitude, de vide. Il est profondément déçu par la France telle qu’il la retrouve, médiocre, ravagée par le mensonge et les idéologies, y compris chez les catholiques dont la foi « est aussi dépréciée que le franc », écrit-il à une amie. Il fait alors paraître en France son dernier roman, le plus sombre, écrit et publié au Brésil, Monsieur Ouine (qu’il appela d’abord La paroisse morte). Ses articles, toujours furieux, radicaux, bloyens, provoquent des ripostes d’autant plus vives qu’on estimait stupidement qu’avec les Grands Cimetières sous la lune le vieux royaliste avait en 1936 viré sa cuti. Des échanges violents ont lieu, notamment avec Temps présent, de Stanislas Fumet. On l’accuse de « taper au petit bonheur », de décrier une démocratie sauvée par des héros (combien étaient-ils de courageux dans la Résistance, demande-t-il ? Une poignée, et maintenant tout le monde a résisté : quelle « blague », quel « bluff » !) Il multiplie les conférences, en France, dans les pays francophones, au Maghreb. En 1946, il publie La France contre les robots, livre écrit au Brésil en 1944, où il vaticine contre le machinisme et les techniciens d’un monde qui s’américanise. Et puis, il y a cette bouleversante conférence donnée à Tunis, en 1947 : « Nos amis les saints ».
C’est alors qu’il commence l’Encyclique aux Français, qu’il n’achèvera pas. Sous prétexte de conférences, la famille Bernanos a quitté la France et pérégrine en Tunisie, pour se fixer à la fin à Gabès. Georges Bernanos a soixante ans. Il souffre d’un cancer, non encore diagnostiqué, qui déjà ronge son foie. C’est sur son lit de malade qu’il rédige cette dernière épître. En mai, son mal va empirer et il sera transporté en France, où il mourra, le 5 juillet 1948, à l’hôpital américain de Neuilly.
Telles quelles, ces pages inachevées pourraient paraître une charge prophétique dont une part de l’intérêt serait dans la démesure stylistique. Il n’en est rien. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, Bernanos y donne une analyse nuancée de ce qui restait de chrétienté à la fin du XIXe siècle, lorsque se produisit la déflagration de l’encyclique de Léon XIII sur le Ralliement, non en sociologue ni en historien universitaire, mais en journaliste, au sens noble que ce terme avait, dans la ligne des Veuillot, Laurentie.
Son texte est tout entier consacré au thème majeur du Bernanos de combat : le caractère au maximum funeste des consignes d’adhésion à la République issue de la Révolution données par Léon XIII aux catholiques français, en 1892, dans l’encyclique Au milieu des sollicitudes. Il en voit les conséquences sous ses yeux, après la dernière guerre, où les catholiques n’ont plus aucune capacité de résistance à une société mortifère qui vide les individus de toute respiration d’âme, sauf de celle de l’angoisse : « Pour condamner en temps utile cette Société moderne prétendue libérale, mais où la Liberté n’était déjà que le masque de la soumission la plus abjecte à l’économique, préfiguration aveuglante de la servitude totalitaire, ce n’est pas la Charité qui fit défaut à l’Église, mais la Force. »
Ce qui restait de la chrétienté après la Révolution
Dans la première partie de son Encyclique à lui, la plus longue, Bernanos défend en quelque sorte… la bourgeoisie bien-pensante de la fin du XIXe siècle, non comme telle, mais pour ce qui lui restait de sens chrétien. Ces considérations historiques se fondent aussi sur de l’introspection : c’est le fils du tapissier-décorateur du quartier de la Madeleine qui parle d’une monde social qu’il a connu, dont bien des membres, comme son père, lisaient Drumont, et ont vu leurs fils s’engager chez les Camelots du Roi pour faire le coup de poing avec les républicains. Ce qui restait alors de société chrétienne était « une chrétienté de chrétiens moyens avec ses disciplines particulières, ses fidélités politiques légitimes, un esprit de corps. » Elle valait mieux qu’une masse de chrétiens moyens, ces chrétiens des « classes moyennes du salut », pour évoquer Joseph Malègue, car elle était un corps, ou était en capacité de le redevenir. Encore eût-il fallu que les hommes d’Église contribuassent à reformer cette société française. « Cette modeste chrétienté bourgeoise ne valait certainement pas les grandes communautés médiévales du même type, mais elle avait de l’honneur », structurée par une élite, certes assez pâle, qui se résumait en une bourgeoisie restée catholique ou redevenue catholique à partir de 1848 : « Cette bourgeoisie catholique était une espèce de chrétienté, bien dégénérée sans doute, bien affaiblie, mais elle était tout de même une espèce de chrétienté. »
Le polémiste la défend, un demi-siècle plus tard, contre ceux qui en sont issus et qui l’attaquent, à savoir des bourgeois catholiques de l’après-guerre, démocrates-chrétiens du Mouvement républicain populaire (MRP), qui battent leur coulpe sur la poitrine de leurs pères, coupables selon eux de n’avoir manifesté qu’égoïsme vis-à-vis du peuple. Entre-temps, il est vrai, l’idée de chrétienté avait été poignardée par le pape lui-même : les chrétiens du MRP sont fils de ceux du Sillon, qui ont obéi avec ferveur à Léon XIII et qui en revanche, comme Mauriac, disent de saint Pie X : « Ce saint-là n’est pas de ma paroisse ! » Cette démocratie chrétienne apparaît du coup à Bernanos « comme la bourgeoisie du XIXe siècle au dernier stade de sa déchéance » par la faute de ses chefs religieux.
Son représentant en est donc François Mauriac, qui de bout en bout de l’Encyclique lui sert de tête de Turc. Bernanos, qui venait d’écrire de lui dans L’Intransigeant : « [M. Mauriac] ne jouissait que de voir humilier et déshonorer une société bourgeoise qui n’avait plus rien à lui donner pour l’apaiser, car il lui avait tant demandé » (Bernanos, Essais et écrits de combat, II, op. cit., p. 1211). Il décernait les mêmes sarcasmes à ses qualités de « chrétien avancé » qu’à celles de son équivalent ecclésiastique, le souple et démo-chrétien cardinal Suhard, archevêque de Paris : « De 1940 à 1945, le Cardinal a fait maintes fois la preuve qu’il n’était pas un homme contrariant et n’est qu’avancé en âge » (ibid, p. 1213).
Mauriac vit en effet, après la guerre, sa période pro-MRP, comme la plupart des évêques de France. Il défend le parti de Georges Bidault contre le Rassemblement du Peuple français (RPF) du général de Gaulle, qui siphonne comme on dit une partie de son capital électoral. Auquel RPF, Bernanos sollicité par Malraux a refusé d’adhérer : son gaullisme à lui s’exprime en articles sous forme de Messages imaginaires du général de Gaulle, censé parler aux Français de la décomposition de la France et de son avilissement. En fait, Bernanos n’a pas toujours exécré Mauriac, mais ne l’a jamais vraiment aimé. Entre eux, la main tendue a toujours été celle de Mauriac qui, en 1938, le saluait comme « le seul romancier de la sainteté que nous possédions », et en faisait un frère romancier haïssant la fadeur de la fausse vertu : « Le gibet où il cloue son curé de campagne se détache sur des ténèbres pleines de crime » (François Mauriac, Journal, Mémoires politiques Robert Laffont, 2008, p. 247). Après la guerre, Mauriac avait proposé à Bernanos revenu du Brésil de lui ouvrir les portes de l’Académie française, ce que ce dernier avait refusé. Déception de Mauriac, qui ne parvient pas à entendre que le combat politique de Bernanos n’est pas sur le même registre que le sien : « Où est Péguy, demandait Mauriac en 1946 ? Pourquoi ses fils se taisent-ils ? C’est à cette place vide que nous attendions Bernanos, c’est cette place que je lui montrais et il ne m’a répondu que par des outrages » (ibid. p. 435).
Bernanos accuse donc Mauriac et ses amis démocrates-chrétiens, qui « aiment le peuple et n’en sont pas aimés », de maudire avec pharisaïsme l’ancienne bourgeoisie dont ils sortent eux-mêmes, parce qu’elle n’a pas rempli son « devoir social », ce devoir qu’ils pensent quant à eux avoir découvert avec Marc Sangnier. Mais les catholiques sociaux l’étaient bien avant les prêtres démocrates du Sillon et les prêtres-ouvriers d’après-guerre : « La doctrine du Comte de Chambord, et celle du Comte de Paris, remarque Bernanos, n’étaient nullement réactionnaires, il suffit de dire que la première inspirait des hommes tels que M. de Mun, La Tour du Pin, le jeune Lyautey. » Si d’ailleurs Bernanos n’accorde pas une grande importance à Rerum novarum et à ce qu’on a appelé ensuite la « doctrine sociale de l’Église », ce n’est pas qu’il soit opposé à ce que propose l’encyclique « sociale », bien au contraire, mais c’est parce qu’il regrette ce qu’elle ne dit pas. Il eût voulu qu’elle intégrât son enseignement en faveur des classes laborieuses à une croisade antimoderne totale, sociale certes, mais aussi politique : « Encore un coup, je ne déplore nullement l’importance grandissante donnée au Social depuis cinquante ans par une certaine partie de l’opinion catholique. Je déplore seulement que cette croisade sociale qui aurait dû être celle de la Libre Chrétienté contre le Monde Moderne, se soit faite presque exclusivement contre la Bourgeoisie française. »
Et puis les démocrates-chrétiens se font quelques illusions sur le peuple qu’ils plaignent. Comme il n’a jamais été encadré par des chefs dignes de ce nom, il est devenu un instrument aux mains des politiciens de gauche « beaucoup moins intéressés par la justice sociale que par l’anticléricalisme le plus bas ». Au reste, si « le pharisaïsme de M. Mauriac est d’opposer dans le passé une bourgeoisie étroitement égoïste et formaliste à une classe dont il feint de croire qu’elle ne demandait modestement que sa place dans la Société », il devrait comprendre que ces prolétaires subjugués par des chefs marxistes, voulaient en réalité prendre les commandes de la société ou plutôt permettre à ces chefs de les prendre.
Il est vrai que « la bourgeoisie du XIXe siècle n’était pas une classe de maîtres ». Il précise : « je veux dire de chefs. » Elle n’avait rien de vraiment commun avec celle d’Ancien Régime. Au commencement, elle fut un ensemble de parvenus enrichis par l’acquisition des biens de l’Église et des émigrés. Mais elle a été domestiquée par l’ascèse administrative que lui a imposée Napoléon et elle a vite obtenu « quelques-unes des vertus d’une véritable classe ». Ses membres étaient des rustres devenus des patrons, pas vraiment des maîtres d’un peuple devenu prolétariat, les premiers exerçant sur le second « la dureté naturelle au paysan parvenu ». Mais cette bourgeoisie, du moins la bourgeoisie moyenne, était honnête, travailleuse, patriote. Éduquée dans les pensions religieuses, elle avait peu à peu rallié le catholicisme. Elle paraissait terre à terre, mais elle avait pourtant formé son imagination dans les livres de Walter Scott et d’Alexandre Dumas. Ceux de ses garçons qui étaient fils de royalistes cultivaient la mémoire de Cadoudal ou de Charrette, mais ils vibraient aussi au souvenir des grenadiers moustachus de Waterloo. Ceux qui étaient fils de bonapartistes dévoraient les récits de la guerre de Vendée et pleuraient les Suisses héroïques égorgés pour la défense du roi.
Ces hommes n’étaient certes pas des hommes de l’ancienne France, mais on comptait chez eux « un grand nombre de commerçants et de petits industriels d’une honnêteté scrupuleuse à la manière de César Birotteau, des fonctionnaires exemplaires, magistrats, officiers, professeurs, fiers de servir l’État qu’ils ne confondaient pas avec la République, et dans lequel leur naïveté croyait encore reconnaître la Patrie. » Dans Nous autres Français, Bernanos avait écrit : « Nous demandons à l’Église d’entretenir dans le monde assez d’esprit chrétien pour que la Chrétienté reste possible ». Possible avec ce matériau appauvri. Mais justement, c’est pour ces hommes-là, une chrétienté possible qu’il fallait faire advenir, que Léon XIII et ses prélats diplomates vont faire exactement le contraire en leur disant que tous les Syllabus et toutes les encycliques antimodernes n’étaient au fond que des paroles incantatoires et qu’il leur fallait servir loyalement la démocratie de Rousseau…
La déflagration du Ralliement
La seconde partie de l’Encyclique aux Français développe – commence à développer ce que la maladie a empêché de poursuivre – les conséquences d’Au milieu des sollicitudes, qui fit que « des millions de braves gens comprirent qu’ils étaient dupes ». Depuis la Révolution l’enseignement romain avait condamné sans relâche le monde moderne et les principes de la démocratie née de la Révolution (et il continuera de le faire jusqu’à Vatican II). Les « braves gens » qui allaient à la messe le dimanche avaient donc constamment entendu « la rhétorique enflammée des mandements de carême et des lettres épiscopales dénonçant la persécution et faisant appel aux martyrs ». Sans doute les accommodements pratiques avaient-ils été déjà nombreux et seront-ils plus nombreux encore après l’encyclique du pape Pecci. Mais elle eut valeur de promulgation, écrivant noir sur blanc que toutes les condamnations du monde moderne fulminées par les prédécesseurs de Léon XIII, et plus encore par lui-même, et avec la plus grande précision doctrinale (entre autres, l’encyclique Immortale Dei sur la constitution chrétienne des États, en 1885), n’étaient pas à prendre trop au sérieux. Les catholiques français comprirent que tout cela n’avait au fond « pas beaucoup plus de signification que celle des professions de foi électorales ».
Eh bien, « ces bourgeois moyens [qui] paraissaient vraiment moyens » ont compris qu’on s’était moqué d’eux. À moins qu’ils n’aient été scandalisés, au sens exact du terme, poussés eux aussi à la duplicité et à la trahison, comme les paroissiens d’un curé qui défroque sont soulagés pour eux-mêmes de voir que la morale qu’il leur prêchait avait peu de valeur. Les prélats de la Secrétairerie d’État, et le pape avec eux, avaient cru faire là une combinaison de haute diplomatie, un « contournement » génial des républicains anticléricaux en leur fabriquant des petits frères républicains cléricaux qui, sans changer le système politique, aménageraient les lois antireligieuses. Mais les « braves gens » auxquels s’adressaient les prélats romains « n’étaient pas tellement étrangers à leur temps qu’ils ne fussent capables de reconnaître dans le Ralliement quelque chose du caractère de ces combinaisons politiques et de finance déjà si communes alors, et comme une espèce de coup de bourse. »
« Jamais chefs ne trahirent et ne déshonorèrent plus effrontément des serviteurs coupables seulement d’avoir cru à la sincérité de leurs apostrophes et malédictions. Jamais le « Politique d’abord » tant reproché à M. Charles Maurras ne trouva d’application plus cynique. » Les conséquences s’enchaînèrent. D’abord, « les jeunes générations bourgeoises ne renièrent pas pour autant l’Église, elles achevèrent seulement de perdre l’esprit du Royaume de Dieu, et le sens de l’honneur chrétien. » Autrement dit, disparut de l’âme catholique le désir de reconstruire la Cité chrétienne. Ce qui explique certainement, dit Bernanos, l’extraordinaire fortune du nationalisme laïque, remplaçant ou s’annexant la fidélité à la France chrétienne, chez Barrès plus encore que chez Maurras.
Ensuite – mais c’est sur cela que le développement de Bernanos s’interrompt – les consignes de Ralliement vont « détacher une part considérable de l’opinion française catholique de l’Église, ou plus exactement du clergé. » Est-ce à dire qu’assistant après la guerre à la montée de la sécularisation au début de l’ère consumériste des Trente Glorieuses, constatant les premiers grands craquements dans le catholicisme à moins de quinze ans de l’ouverture de Vatican II, Bernanos rendait responsables de tout cela les consignes de Ralliement ? Oui, pour partie seulement, mais pour la partie la plus importante, celle qui tient au fait que « rien n’enhardit autant l’audace des méchants que la faiblesse des bons », comme disait saint Louis-Marie Grignion de Montfort. La trahison des chefs a provoqué celle des soldats. Ce fut grand dommage, car si « ces gens-là n’étaient pas des hommes de l’ancienne France, ils étaient peut -être seulement en train de le devenir ». Le « peut-être » tempère un trop grand optimisme. Il n’empêche, c’est bien le sensus de chrétienté qui a été alors atteint. « Avant de tarir, il fallait que la Chrétienté se vidât, il fallait que les immenses épargnes du spirituel se corrompissent dans l’organisme même au point de devenir pour lui une matière à éliminer, un simple produit d’élimination. »
Et voilà que cette élimination de la construction du Royaume de Dieu était accueillie comme une « rénovation » par les démocrates-chrétiens. Viendra bientôt une « rénovation » plus totale, un « nouveau Printemps de l’Église » où le Syllabus sera renié non seulement en pratique, mais en principe. Dieu a fait à Georges Bernanos la grâce de le rappeler à lui sans avoir à le connaître.
Abbé Claude Barthe
[1] Peut-être aussi, l’appellation d’encyclique voulait-elle signifier que l’auteur adressait une contre-encyclique, pour faire pièce à celle adressée aux Français par Léon XIII, et dont les conséquences sont le sujet de ce dernier texte bernanosien. Une partie de cet écrit (« Ces démocrates-chrétiens aiment le peuple, mais le peuple ne les aime pas… ») a été publiée dans Combat, le 7 mars 1950. Jean-Loup Bernanos a ensuite donné au public le texte en son entier chez Plon, en 1975, en même temps que six articles publiés au Brésil en 1942, sous le titre La Vocation spirituelle de la France. Cette Encyclique aux Français figure dans l’édition critique de la Pléiade : Bernanos, Essais et écrits de combat, II, Gallimard, pp. 1247-1236.
Navigation de l
Le mal-être des « nouveaux prêtres »
Un fort intéressant – et significatif – ouvrage collectif, Les sacrements en question. Qui peut les recevoir ? Pour quels fruits ?, sous la direction de Thibaud Guespereau, Henri Vallançon, prêtres, et Thibaud Collin, philosophe[1], fait état de la souffrance de prêtres « voyant comment les sacrements qu’ils donnent sont reçus. » Ainsi constatent-ils que des baptisés adultes en nombre ne retournent pas à la messe dès le dimanche qui suit leur baptême, que des mariés qu’ils ont préparés au sacrement se séparent un an plus tard. Ajoutons qu’ils voient l’ensemble des assistants de toutes les messes communier toujours, cependant qu’un nombre infime se rendent parfois au confessionnal. D’où l’éternelle question pastorale, mais qui se pose de manière brûlante au sein d’un monde catholique malade aux frontières très poreuses avec la société indifférente qui l’enserre : « [Un pasteur] doit-il discerner et refuser aux demandeurs qui n’ont pas la foi et/ou vivent de façon désordonnée ? Ne risque-t-il pas alors de créer une Église de purs ? Ou en sens inverse, s’il accepte trop largement ne risque-t-il pas d’offenser Dieu, et de porter préjudice à l’Église et aux demandeurs eux-mêmes ? »
On trouve dans ce livre des considérations tout à fait opportunes sur la crise de la prédication des fins dernières, l’altération de la notion de péché mortel dans la théologie contemporaine, et aussi l’exemple d’une paroisse du Midi où un sérieux discernement est appliqué aux demandes de sacrements. Appliqué aux demandes de mariage et de baptêmes pour soi-même ou pour un enfant : du moins, c’est ce que l’on suppose, car l’ouvrage reste souvent allusif. On comprend cependant la prudence nécessaire d’un ouvrage destiné au grand public. Tel quel, dans le monde catholique présent, il est une sorte de bombe, parce qu’il secoue le laisser faire, laisser passer pastoral. Mais il l’est surtout par ce que révèle ce fait massif : aucun évêque ne se trouve parmi les auteurs ou préfaciers de ce livre où l’on explique tout bonnement ce qu’est l’état de grâce et le péché mortel qui l’enlève.
Là est le point qui fait mal : entre les évêques et une bonne partie de ceux qui forment les jeunes générations de prêtres il y a un fossé d’incompréhension. Il est bien connu que les fidèles appartenant à ce qu’il est convenu d’appeler les « forces vives » qui subsistent encore ont le sentiment d’être des brebis sans pasteurs. Mais il faut savoir qu’un nombre non négligeable de prêtres diocésains sont dans une situation semblable. D’où le mal-être profond de ces clercs que l’on qualifie de « classiques » ou de « nouveaux prêtres » abandonnés ou même suspectés par leurs supérieurs.
Abbé Claude Barthe
[1] Auquel ont participé entre autres, le P. Pascal Ide, Mgr Christophe J. Kruijen, l’abbé Guillaume de Menthière, Gabrielle Vialla (Artège, 2024).