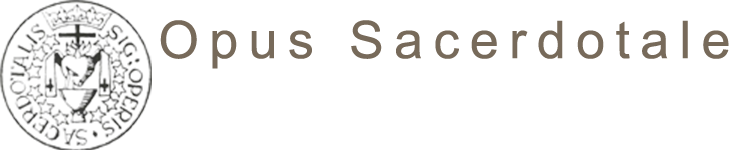Réfutation de l’annihilation des damnés – Mgr C. Kruijen, Revue Thomiste 122 (2022)
Homines quod volunt credunt
Ex falso sequitur quod libet
(Locutions latines)
Entrée en matière
En 2017 ont été publiés coup sur coup deux ouvrages consacrés au thème de l’enfer et dont le point commun est de défendre l’idée selon laquelle les damnés ne seraient pas tourmentés sans fin, mais cesseraient purement et simplement d’être après leur mort ou après la résurrection et le jugement général[1]. On parle à ce sujet de la théorie de l’annihilation ou annihilationisme, ou encore du conditionalisme, puisque la ‟survivance” éternelle dans l’au-delà dépendrait d’une condition, à savoir : faire partie des sauvés.
Compte tenu du fait que les idées avancées dans ces ouvrages d’inégale longueur interfèrent avec plusieurs doctrines de la foi catholique, directement attaquées ou du moins remises en question, il a paru opportun de procéder en deux étapes. Dans un premier temps, nous esquisserons une présentation succincte de ces deux publications, au cours de laquelle seront insérées quelques observations critiques (A). Dans un second temps, nous proposerons des éléments de réflexion théologiques et doctrinaux plus développés, en vue d’une évaluation critique des thèses ou hypothèses en présence (B).
A. Présentation succincte des ouvrages
1. Le livre du professeur Michel Fromaget
L’ouvrage en question est intitulé De l’enfer introuvable à l’immortalité retrouvée[2]. Son auteur est présenté comme étant anthropologue, maître de conférence honoraire de l’Université de Caen-Normandie et auteur de nombreux essais d’anthropologie spirituelle[3].
a. Propos et position de l’auteur
Au lecteur pressé, il suffira de lire l’introduction de l’ouvrage pour connaître les idées maîtresses défendues par M. Fromaget. À savoir, avant tout, que la damnation consisterait non en un tourment sans fin, mais en une disparition complète ou annihilation des mauvais. Cette position contraint l’A. à défendre aussi ses deux corollaires que sont, d’une part, l’inexistence de l’enfer – celui-ci « n’existe pas, il est la mort, il est le néant » (p. 202) – et, d’autre part, la négation de l’immortalité naturelle de l’âme humaine (p. 52 ; 69-76). En outre, l’A. est conduit logiquement à postuler également la mortalité du diable et de ses anges, en se référant pour cela notamment à Tatien (p. 248-249). À la vie éternelle ne s’opposerait donc pas l’enfer, mais la mort (p. 10) : « Les méchants mourront définitivement à la fin de l’histoire » (p. 13).
Si l’A. situe à l’occasion sa thèse sur le plan de l’hypothèse (p. 97 ; 103) et de la probabilité – il parle d’un « risque d’erreur minime jusqu’à être parfaitement négligeable » (p. 15) et de « probabilité d’exactitude confinant à la certitude » (quatrième de couverture) – il s’agit là de simple cautèle rhétorique. En effet, l’A. est catégorique dans son refus ou sa négation de l’enfer (p. 14 ; 59 ; 242), pleinement conscient du fait que son ‟hypothèse” d’une destruction totale des damnés par le feu infernal « contredit de manière frontale le dogme de l’enfer éternel » (p. 97).
Même s’il se reconnaît « non-spécialiste » (p. 261), l’ambition de l’A. est en réalité considérable : bien conscient que la position qu’il défend n’est pas neuve, M. Fromaget estime cependant être le premier à la défendre de manière systématique et avec tous les arguments convenables (p. 15). Persuadé avec Sergueï N. Boulgakov que l’Église n’a rien défini au sujet de l’enfer éternel comme on le verra plus avant, l’A. souhaite inciter les théologiens à prendre conscience de la nécessité de changer la dogmatique de « l’immortalité de l’homme » (sic) et de l’enfer au moyen d’un « développement dogmatique » (p. 261).
À cet endroit, il peut être utile de préciser la position défendue par l’A. Commençons par dire qu’il ne partage pas la thèse de l’espérance d’un salut universel (enfer hypothétique), aujourd’hui en vogue, encore qu’elle lui paraisse légitime (p. 65), pas plus que celle de l’apocatastase, qu’il rejette fermement (p. 57-66). Pour l’A., il ne fait guère de doute qu’il y aura une séparation entre les sauvés et les damnés (p. 61-62 ; 82-83), sauf que ces derniers finiront par disparaître complètement au lieu d’être condamnés en enfer. En somme, l’A. soutient simultanément que tous les hommes ne seront pas sauvés et que personne ne souffrira éternellement en enfer. Remarquons en passant que si l’homme risque tout de même de disparaître à jamais dans le néant s’il refuse Dieu, on comprend mal comment l’A. peut souscrire aux propos de Maurice Zundel, selon lequel l’homme serait déchargé du souci de son salut (p. 275).
Le scénario proposé par l’A. correspond dans les grandes lignes à ce qui suit : à leur mort, tous les hommes descendent aux enfers[4] (Hadès ou shéol) (p. 194), où il serait encore possible d’accéder à la seconde naissance et à la metanoia ouvrant à la vie éternelle (la mort n’est donc pas considérée comme la fin du status viae, p. 184 ; 196)[5]. La mort physique ou première mort ne fait pas disparaître l’homme, dont l’âme est dotée d’une immortalité naturelle « relative » et donc « temporaire » (p. 142), qui lui permet de subsister jusqu’au jugement dernier. L’A. ne défend donc pas la théorie de la « mort totale » (Ganztodtheorie) au sens habituel de cette expression (p. 143 ; 189), selon laquelle l’homme disparaîtrait corps et âme à sa mort, pour être recréé au moment de la résurrection[6]. Lors du jugement universel, l’homme peut accéder à l’immortalité véritable et absolue s’il est rené à l’Esprit, mais il peut aussi expérimenter la seconde mort, « cette mort totale, absolue, qui anéantit l’être pour l’éternité » (p. 76), s’il refuse délibérément de croire en Jésus Christ.
Pour le bien comprendre, il faut considérer qu’à la première naissance, qui transmet une vie « obligée, partielle, relative et temporaire », l’A. oppose la seconde naissance, qui confère une vie « libre, totale, absolue et éternelle » (p. 184). La première correspond à l’homme naturel ou psychique, doué d’un corps et d’une âme mortelle (p. 77), l’esprit n’étant que « virtuel » à ce stade. La seconde correspond à l’homme spirituel doté d’un corps, d’une âme (immortelle) et d’un esprit (p. 176). À cette double naissance correspondent deux modes de résurrection, binaire et ternaire : les pécheurs endurcis qui auront refusé de naître à la vie éternelle ressusciteront dans leur état naturel, corps et âme, pour une vie seulement naturelle et temporaire qui, s’épuisant, aboutira à l’anéantissement de la seconde mort. Les justes, eux, ressusciteront, corps, âme et esprit, pour une vie éternelle (p. 196-198). Notons que la ‟damnation” semble se réduire ici à un processus naturel, quasi physiologique, et dans lequel le jugement dernier ne joue apparemment plus de rôle.
Il importe de saisir qu’aux yeux de l’A. il est capital que l’homme puisse choisir d’accepter ou de refuser une vie qui doit durer éternellement. Autrement dit, si l’homme n’a pas choisi de naître, il doit pouvoir être libre de refuser l’immortalité, s’il le désire, car seule une immortalité gracieuse, non imposée, serait digne de l’amour de Dieu (p. 72). Ce qui implique que l’homme doit avoir, et a de fait, « la faculté de disparaître » dans le non-être (p. 77).
Probablement afin d’éviter de donner l’impression de défendre l’impunité des damnés qui pourraient ainsi se dérober à leurs responsabilités en s’échappant dans le néant, l’A. avance que le processus conduisant à leur mort totale, et donc à leur annihilation, sera accompagné de grandes souffrances, qui auront cependant un terme (p. 87-88 ; 91sv ; 194), puisque le feu est destructeur (p. 97) et s’éteint après avoir tout consumé (p. 88).
Observons pour terminer, l’absence, dans ce contexte, des doctrines du jugement particulier, du purgatoire et de la possibilité de l’accès à la vision béatifique dès l’état intermédiaire. Ce silence se comprend en partie, dans la mesure où l’A. entend se concentrer sur ce qu’il considère être le donné de l’Écriture sainte et du « christianisme originel ».
b. Argumentation et méthode
Les arguments essentiels avancés par M. Fromaget sont au nombre de deux, auxquels il convient d’en ajouter un troisième, de moindre importance. Le premier argument est le donné de l’Écriture sainte (lue dans la traduction d’Émile Osty), et plus particulièrement celui du Nouveau Testament (chap. 6 à 12). L’A. propose concrètement de prendre en considération un ensemble de 336 versets néotestamentaires[7] informant – selon lui – sur le sort ultime des damnés et qu’il classe en 9 catégories thématiques[8].
S’agissant de la méthode appliquée à l’étude de ce corpus, l’A. déclare choisir celle des sémioticiens qui ont pour usage de se fier « au texte, rien qu’au texte et, si nécessaire, à tout le texte » (p. 12), se limitant à demander : de quoi parlent les auteurs ? Comment en parlent-ils ? (p. 12). Au lieu d’une lecture « dogmatique » qui « ajoute au texte » du Nouveau Testament un sens qu’il n’a pas (p. 11) – lecture attribuée aux défenseurs de l’enfer éternel –, le lecteur est convié à une lecture « simple et sobre » de l’Écriture (p. 14 ; 26 ; 79 ; 277). Et de fait, les références à de grands commentaires bibliques ou à des dictionnaires spécialisés sont rares[9]. De se limiter à un minimum d’instruments exégétiques, d’« aller au plus simple », « à ras du texte », en faisant l’économie de toute érudition et de tout savoir extérieur au texte, bref de « s’en remettre sobrement au texte seul », permettrait de découvrir la « doctrine originelle » ou la « véritable doctrine concernant le sort ultime des méchants » (p. 12-13). En cas de doute, des « arguments très simples » (prise en compte du contexte, distinction entre sens figuré et sens propre, etc.) sont censés permettre de dégager l’interprétation la plus plausible des versets difficiles (p. 11).
Sur le plan scripturaire, l’A. développe deux thèses majeures. La première consiste à dire qu’à la vie éternelle le Nouveau Testament n’oppose pas l’enfer, mais la mort (outre Gn 2, 17, l’A. avance notamment Jn 8, 52 ; 11, 26 ; Rm 6, 16 ; 1 Jn 5, 16), à savoir une mort totale et douloureuse (chap. 7-8). La seconde est que le feu éternel est un feu destructeur (p. 95sv) et donc inapte à signifier un châtiment qui laisserait en vie (p. 105 et, plus largement, chap. 9-10). Le feu infernal serait éternel seulement quant à son effet destructeur, mais non quant à l’existence (p. 113 ; 120 ; 122). Ajoutons ici que l’A. postule l’équivalence entre certains termes affirmant la destruction ou l’anéantissement des réprouvés (comme phthora, olethros ou katargein) et l’annihilation ontologique de ces derniers, ce qui est contestable comme on le verra plus tard[10].
La conclusion que tire l’A. de son exégèse néotestamentaire est qu’aucun des 336 versets sélectionnés n’accrédite l’existence de l’enfer éternel, aucun n’est incompatible avec la mort-anéantissement des damnés, tandis que 278 d’entre eux réfutent formellement l’enfer (p. 82 ; 85 ; 257). Et, certes, ce résultat ne saurait surprendre s’« il n’y a pas de lecture objective des Écritures » et si le lecteur « doit décider ce qu’il lit » (p. 277 citant Marie Balmary en l’approuvant). Avec un auteur ancien, on est tenté ici de penser à « la tendance qu’ont généralement les hommes à croire ce qu’ils désirent[11] » : si l’enfer ne peut pas, ne doit pas exister, aucun texte en sens contraire ne sera jugé probant.
Le second argument essentiel avancé par l’A. est l’eschatologie développée par les Pères apostoliques, chez lesquels il ne se trouverait aucune mention de l’enfer éternel (p. 156-157), et quelques autres Pères de l’Église ou auteurs chrétiens des trois premiers siècles (chap. 13-15). L’A. accorde une importance particulière à saint Irénée de Lyon, suivi d’autres auteurs tels que saint Justin Martyr, Origène, Théophile d’Antioche et Tatien. On remarquera que le conditionalisme défendu apparemment par ce dernier correspond exactement à celui de M. Fromaget :
En soi, ô Grecs, l’âme humaine n’est pas immortelle, mais mortelle. Il est vrai qu’elle peut aussi ne pas mourir. Si elle ne veut pas reconnaître la vérité, tout en survivant à la mort du corps, elle entre dans le douloureux processus de la mort. Puis, à la fin du monde, elle resurgira avec son corps pour être dissoute avec lui. Par contre, elle ne mourra pas […] si elle est instruite de la connaissance de Dieu[12].
Concernant l’anthropologie néotestamentaire et celle des Père apostoliques, l’A. insiste sur leur dimension ternaire ou tripartite : corps, âme et esprit (chap. 14-15). Contrairement au modèle anthropologique binaire grec corps / âme, où l’âme est divine et ne peut donc pas perdre la vie, d’après le modèle ternaire l’âme ne possède pas la vie en elle-même, mais elle ne l’a que par participation à la vie de l’Esprit divin et aussi longtemps que Dieu veut la lui communiquer (p. 172-173). Ainsi, lors du jugement, à moins d’une seconde naissance par « le consentement libre et conscient de l’âme à l’esprit » (p. 182)[13], l’âme cessera de recevoir la vie de Dieu et disparaîtra de cette manière avec le corps. Au terme des deux chapitres consacrés à l’« anthropologie apostolique », l’A. va jusqu’à insinuer une origine diabolique du « double dogme » de l’immortalité naturelle de l’âme et de l’enfer éternel pour clore, sans surprise, sur ce qui s’apparente à une tautologie : « S’il n’y a pas la moindre trace de ce dogme dans l’enseignement apostolique originel, c’est bien parce qu’il ne pouvait y en avoir aucune » (p. 203).
Le troisième argument avancé par l’A. est constitué par un ensemble de onze documents magistériels ayant trait à l’enfer (chap. 19). Après seulement cinq pages, M. Fromaget retient que les dogmes de l’enfer et de « l’immortalité naturelle de l’être humain » (sic) sont « dénués de valeur dogmatique véritable » (p. 269). En simplifiant, le procédé suivi par l’A. peut être réduit au syllogisme suivant : 1/ Seules les vérités de foi définies sont absolument dogmatiques et s’imposent absolument au croyant (p. 261). 2/ Or l’Église n’a rien défini au sujet de l’enfer (p. 263 ; 269 citant S. Boulgakov). 3/ Donc, rien ne s’impose dogmatiquement en matière d’enfer. On verra plus tard que l’approche de l’A. relativise les énoncés du magistère en les subordonnant à la raison critique individuelle. On relèvera aussi l’absence significative de la prise en compte du magistère ordinaire universel dans ce contexte.
Ajoutons qu’en plus d’une série de représentants de la pensée chrétienne des deux ou trois premiers siècles, l’A. sollicite par ailleurs un grand nombre d’auteurs à l’appui de ses thèses, y compris des philosophes comme Thomas Hobbes, Pierre Bayle, Montesquieu, le baron d’Holbach et Diderot. Parmi les auteurs contemporains, on relèvera notamment Jean Elluin, Gaston Fessard, Gustave Martelet, François Varillon, Hans Urs von Balthasar, Yves Congar, Edward Schillebeeckx, Henri Lassiat, Georges Minois, Charles Péguy, Sergueï Boulgakov, Paul Evdokimov, Alexandre Turincev, Nicolas Berdiaev et Maurice Zundel. L’A. accorde une estime particulière à ce dernier, auquel il consacre les dernières pages de son livre (p. 273-276). Zundel aurait su parler de l’enfer comme personne ne sut le faire avant lui, en adoptant une perspective « exactement semblable » (sic) à celle des Pères des deux premiers siècles de l’ère chrétienne en matière d’anthropologie et d’eschatologie (p. 273).
Signalons pour terminer que l’on demeure perplexe de devoir constater que l’A. se laisse aller par deux fois à colporter – on ne saurait dire autrement – un propos apocryphe faussement attribué à sainte Thérèse de Lisieux, qui aurait déclaré : « Je veux bien croire à l’enfer éternel à condition qu’il n’y ait personne ! » (p. 14 ; 59)[14].
2. Le livre du chanoine Yvon Kull
Le second ouvrage est intitulé Revisiter l’enfer ou comment devenir immortel[15]. Dépourvu de bibliographie et d’index, cet ouvrage, parfois un peu décousu, est caractérisé notamment par un fréquent usage de mots écrits en majuscules, comme si la force de persuasion dépendait de la taille des lettres. Son auteur est prêtre, membre de la Congrégation des chanoines réguliers du Grand-Saint-Bernard, retiré dans la vie contemplative depuis une dizaine d’années[16].
a. Une expérience subjective
Plus qu’une question intellectuelle, et comme chez Jean Elluin, l’enfer semble avoir été l’objet d’un tourment existentiel pour le chanoine Y. Kull. Encore jeune novice, travaillé par les mystères de la mort et celui de la mort éternelle, l’A. affirme avoir expérimenté une « illumination » au terme d’une nuit d’insomnie : la damnation serait en fait « la cessation définitive et totale de la vie » (p. 113). En 1975, ses Supérieurs qualifièrent cette illumination d’hérétique et exigèrent de l’A. qu’il rétractât formellement son idée, sous peine de ne pas être ordonné prêtre, ce qu’il fit, non sans colère et révolte intérieure (p. 114).
On relèvera par ailleurs que l’A. rapporte avoir fait plus d’une fois l’expérience subjective d’être damné, prisonnier du mal pour toujours, ce qu’il appelle une « conscience démoniaque de [lui]-même » (p. 92 ; 121-122).
Enfin, l’A. confie avoir souffert pendant plus de dix ans d’une sévère dépression qui lui valut dix hospitalisations, dont six en hôpital psychiatrique (p. 120). Toutes ces conditions laissent pressentir une approche très subjective et affective de la question traitée[17], et ce au détriment de cette sérénité indispensable à un travail théologique solide et fructueux.
b. Propos et position de l’auteur
La position de l’A. est résumée aux p. 21-23 (« position du problème ») : la possibilité de l’enfer est donnée en raison de la liberté de l’homme et de la nature de l’amour de Dieu qui ne s’impose pas. La question est alors de savoir ce que vont devenir les damnés éventuels. Entre la négation pure et simple de la possibilité de l’enfer et un enfer de souffrances éternelles, tous deux difficilement conciliables avec cet amour, l’annihilation des damnés est proposée comme troisième voie : « Nous pouvons dire non à Dieu pour toujours sans pour autant devoir souffrir éternellement » (p. 22). Le refus définitif de Dieu, source de la vie, consiste à renoncer pour toujours à la vie et à sombrer dans la seconde mort ou mort éternelle, la cessation totale et définitive de la vie. Or « là où il n’y a plus de vie, il n’y a plus de souffrance » (ibid.), il n’y a « plus rien. C’est la mort absolue, corps et âme » (p. 23)[18], car l’âme peut aussi périr (l’A. renvoie à Mt 10, 28). L’éternité de l’enfer serait donc à comprendre au sens où il réduit le ‟damné” à un état d’« absence totale et éternelle » (p. 23) et non plus de peine éternelle.
L’A. présente sa position comme une hypothèse théologique qui « n’a pas l’approbation formelle du magistère de l’Église catholique » (p. 21). En fin d’ouvrage, cependant, il écrit que tout son travail « consiste à démontrer que cette révélation ‟surnaturelle”[19] nous apprend […] que l’homme – ou son âme – n’est pas nécessairement immortelle [sic] mais que c’est à lui d’en décider » (p. 208). Entendre démontrer l’immortalité seulement conditionnelle de l’âme, qui est au fondement de la thèse de l’annihilation des damnés, va bien au-delà d’une simple hypothèse. L’A. « conteste » en réalité l’enseignement traditionnel de l’enfer éternel (p. 92), qu’il juge « inacceptable » (p. 120) : il admet qu’un enfer éternel puisse être une possibilité pour chacun, mais ne croit pas que cet enfer soit « ‟une vie sans fin” dans la souffrance et le malheur éternels » (p. 22-23). D’ailleurs l’A. le sait : « Il n’y aura jamais de vie sans fin malheureuse » (p. 89).
En ce qui concerne le rapport au magistère ecclésiastique, l’A. est conscient du fait que sa manière d’envisager l’enfer ne correspond pas à ce qu’il appelle « l’enseignement ‟officiel” de l’Église » (p. 185). Il admet en effet que son hypothèse « semble » contredire certaines affirmations de la doctrine catholique, mais met cette contradiction sur le compte d’un « malentendu philosophique » que son ouvrage veut dissiper (p. 22). La déclaration d’adhérer de tout cœur au magistère de l’Église catholique (p. 21) et de se soumettre à son jugement (p. 186) demeure néanmoins verbale, dans la mesure où l’A. défend en réalité une conception de l’enfer et de la damnation qui n’est pas celle du magistère, comme il sera précisé par la suite. Y. Kull destine d’ailleurs son livre en particulier au magistère, en nourrissant l’espérance avouée que ce dernier fasse de sa position la doctrine de l’Église (voir sa postface, p. 185-187, ainsi que p. 31)[20] ! En somme, l’A. suggère que l’Église devrait repenser son enseignement sur l’enfer, compte tenu des réflexions de son livre et de la catéchèse de la jeune Église du IIe siècle (p. 107). Par exemple, à ceux qui objecteraient l’existence des démons contre sa position, l’A. répond, sûr de lui, que c’est plutôt son hypothèse qui pourrait remettre en question ce que nous croyons savoir des démons (p. 114, n. 1).
Concernant l’existence de ‟damnés” (qui disparaîtraient donc), on notera qu’à la différence de M. Fromaget, l’A. déclare se rallier entièrement à la position de Hans Urs von Balthasar, selon laquelle il serait permis d’espérer, mais non d’affirmer que tous les hommes seront sauvés (p. 189). En même temps, l’A. écrit que sa position correspond exactement à celle d’Olivier Clément, d’après lequel l’apocatastase doit être espérée et ne doit être rejetée que comme certitude (p. 190)[21].
On relèvera pour terminer que l’A. conteste le fait que la résurrection des morts aura lieu à la fin des temps et affirme qu’il n’y a pas d’âmes séparées de leur corps après la mort, suggérant ainsi l’idée d’une résurrection au moment de la mort (p. 141-143).
c. Argumentation
À l’instar de M. Fromaget, l’A. fait de saint Irénée de Lyon le champion du conditionalisme. Y. Kull dépend ici étroitement de l’interprétation d’Irénée par Henri Lassiat. Ce dernier distingue chez l’évêque de Lyon, et plus largement dans la « Tradition apostolique », une économie de la création, qui correspond à la première naissance, et une économie de la filiation, qui correspond à la seconde naissance. Tandis que la première est imposée et dotée d’un ordre impliquant une sanction en cas de refus, la seconde est proposée comme un don qui n’implique aucune punition en cas de refus (annexe 3, p. 197-198)[22]. Parmi les textes invoqués figure le passage fameux où saint Irénée écrit que le Verbe a rendu Dieu visible aux hommes par de multiples économies, « de peur que, privé totalement de Dieu, l’homme ne perdît jusqu’à l’existence[23] » (p. 103, n. 4). Dans le même ordre d’idée, l’A. déduit la disparition d’une créature séparée totalement de Dieu du fait que la créature dépend ontologiquement de Dieu (p. 88 ; 192). Il restera à voir plus avant ce qu’il faut penser du conditionalisme attribué à saint Irénée.
Concernant l’Écriture sainte, l’A. exploite moins systématiquement cette source que ne le fait M. Fromaget. Il n’empêche que son livre propose à l’Église catholique de renoncer définitivement aux « lunettes déformantes de la philosophie platonicienne », à travers lesquelles les tenants de l’enfer éternel sont censés lire la Bible (p. 96). En particulier, et toujours en dépendance d’Henri Lassiat, l’A. reprend la thèse ancienne voulant que le qualificatif « éternel » n’ait pas le même sens selon qu’il s’applique à Dieu ou à des réalités créées, comme le feu (p. 146-147). Le feu étant destructeur, le feu éternel cessera lorsque les impies seront totalement détruits.
Dans le sixième chapitre de son ouvrage, l’A. s’efforce de démontrer que le présupposé fondamental de sa thèse-hypothèse, à savoir l’immortalité seulement conditionnelle de l’âme, est acceptable du point de vue philosophique, scripturaire, traditionnel et magistériel. Partant d’un passage de l’Adversus haereses, où il est dit qu’« à ceux qui l’obtiennent, l’amitié de Dieu procure l’incorruptibilité[24] », Y. Kull est persuadé que l’immortalité nous est proposée de manière conditionnelle, si bien que celui qui refuse l’amitié de Dieu n’y accède pas (p. 128). Différents arguments sont avancés en ce sens. Sur le plan scripturaire, l’A. cite 1 Tm 6, 16 où il est affirmé que Dieu est « le seul qui possède l’immortalité », en en déduisant que cette dernière ne peut être une propriété naturelle de l’âme, mais seulement une grâce surnaturelle offerte à sa liberté (p. 89). En ce sens, l’immortalité est toujours bienheureuse, car divine ou offerte par Dieu à la créature. L’A. cite par ailleurs un article dans lequel Xavier Léon-Dufour affirme que, dans la Bible, « l’âme peut mourir (Nb 23, 10 ; Jg 16, 30 ; Ez 13, 19), être livrée à la mort (Ps 78, 50)[25] ». Ces passages scripturaires ne parlent en réalité guère que de la mort en un sens usuel, sans impliquer l’idée d’un anéantissement total.
Sur le plan philosophique, l’A. se réfère à Claude Tresmontant pour expliquer que l’âme tient son existence non de son essence, mais de Dieu, chez qui seul il y a identité de l’essence et de l’existence. Il s’ensuivrait que l’âme, qui reçoit l’être, est aussi susceptible de le perdre (p. 130-131). L’idée sous-jacente à cette pensée est que pour être immortelle par nature, l’âme humaine devrait être de nature divine[26]. En affirmant que l’âme n’est pas simple, puisque composée de son essence et de son existence (p. 207), l’A. suggère qu’elle est décomposable et donc corruptible (p. 194)[27].
Sur le plan de la tradition ecclésiale, l’A. s’appuie là encore principalement sur des textes de saint Irénée de Lyon et les commentaires qu’en a fait Henri Lassiat. Parmi les passages cités, on trouve le suivant :
Il en va de même des âmes, des esprits et de tous les êtres créés sans exception : tous les êtres créés reçoivent le commencement de leur existence, mais ils durent aussi longtemps que Dieu veut qu’ils existent et qu’ils durent. […] Celui qui garde le don de la vie […] recevra aussi « la longueur des jours pour les siècles des siècles » ; mais celui qui rejette ce don […] et qui refuse de reconnaître le Donateur, celui-là se prive lui-même de la durée pour les siècles des siècles[28].
Concernant le magistère, et plus particulièrement la définition de l’immortalité de l’âme humaine par le cinquième concile du Latran (1513), l’A. se contente de citer longuement Henri Lassiat qui affirme rapidement que l’intention de ce concile n’était pas de définir l’incorruptibilité naturelle de l’âme (p. 153).
Pour tenter d’étayer sa thèse, l’A. convoque encore bien d’autres auteurs, tels Alexandre Men (p. 161) ou Maurice Zundel, auquel il accorde une estime particulière et dont on notera les accents marcionites[29]. Il cite à l’occasion Joseph Ratzinger écrivant que « l’immortalité n’est pas inhérente à l’homme même[30] ». On notera que J. Ratzinger ne dit nullement que l’immortalité n’est pas inhérente à l’âme, mais seulement qu’elle n’appartient pas à la nature de l’homme, ce qui ne fait que rejoindre l’expérience commune de notre mortalité. De plus, cette citation est extraite d’une annexe dans laquelle le théologien allemand soulignait précisément l’importance de l’âme comme support de la « continuité indestructible du moi humain au-delà de la mort[31] », dans ce que l’on appelle l’état intermédiaire (état contesté par Y. Kull), ce qui ne s’harmonise guère avec la thèse de la mortalité de l’âme.
L’A. essaie de s’appuyer par ailleurs sur un passage de l’encyclique Spe salvi de Benoît XVI, dans laquelle la situation de l’enfer est décrite comme la « dissipation irréparable du bien » chez le damné (no 45, cité par l’A., p. 156). L’A. avance également une homélie dans laquelle Benoît XVI affirmait que « l’homme est l’unique créature libre de dire oui ou non à l’éternité, c’est-à-dire à Dieu[32] » (p. 157).
Signalons pour terminer que l’A., peut-être emporté par son élan, finit par dépasser la mesure en taxant, toujours avec Henri Lassiat, l’immortalité naturelle ou inconditionnelle de l’âme d’« illusion luciférienne » et peut-être même comme étant l’essence du satanisme[33], dans la mesure où cette doctrine reviendrait à se prendre pour Dieu ou à vouloir devenir Dieu sans Dieu, en prétendant se sauver par soi-même (p. 172-173). On serait tenté de croire que « l’illusion luciférienne » en question serait plutôt de penser que l’Église aurait erré sur la question de l’enfer à partir du IIIe siècle, et ce jusqu’à l’« illumination » de quelques auteurs contemporains.
B. Évaluation critique
Étant donné que la thèse de l’annihilation des damnés remet notamment en cause l’immortalité de l’âme, nous commencerons par étudier les fondements de cette doctrine avant d’aborder plus directement la thèse en question.
1. Au sujet de l’immortalité de l’âme[34]
a. Remises en cause anciennes
Au cours de l’antiquité chrétienne, un certain nombre d’auteurs ont défendu le thnétopsychisme, selon lequel l’âme ne survivrait pas à la mort du corps, mais en partagerait la corruption, pour ne revivre avec lui qu’au temps de la résurrection. Eusèbe de Césarée, notamment, a attesté l’existence de cette doctrine dans l’Arabie du IIIe siècle[35]. Cette thèse erronée reposait sur un triple motif : premièrement le matérialisme qui assimilait l’âme au corps ; en second lieu, la volonté de souligner le caractère créé et mortel de l’homme tout entier, corps et âme, par opposition à Dieu qui seul est immortel ; enfin la lutte contre le dualisme gnostique qui opposait l’âme et le corps[36]. Justin Martyr (dans certains textes), Tatien, Théophile d’Antioche, Irénée[37], Clément d’Alexandrie et Arnobe de Sicca sont avancés comme ayant défendu le thnétopsychisme ou du moins l’idée selon laquelle l’immortalité ne fait pas partie de la nature de l’âme, mais est un don de la grâce à ceux qui croient et obéissent à Dieu, une participation à sa vie dépendant de la volonté divine, encore qu’il faille tenir compte du caractère souvent mouvant et parfois obscur des positions exprimées[38].
b. Éléments doctrinaux
L’immortalité « naturelle » de l’âme n’est pas un « soi-disant dogme », comme le prétend la quatrième de couverture du livre de M. Fromaget ; elle est une doctrine de foi définie par le magistère ecclésiastique universel. Le concile de Latran V a enseigné que l’âme « est à la vérité immortelle, sujette à la multiplicité selon la multiplicité des corps dans lesquels elle est infusée, effectivement multipliée et sujette à être multipliée à l’avenir[39] ». Ce faisant, l’assemblée conciliaire présidée par Léon X désirait réagir à l’opinion, soutenue en particulier par le philosophe humaniste Pietro Pomponazzi, selon laquelle l’immortalité de l’âme ne peut être démontrée par la raison, mais seulement être crue[40]. M. Fromaget reconnaît que le texte cité relève du magistère ex cathedra, mais en relativise radicalement la portée en affirmant qu’il ne visait que la mort naturelle ou première mort, au motif qu’il s’opposait à la doctrine de Pomponazzi, qui aurait soutenu que l’âme humaine s’éteint à la mort du corps (thnétopsychisme). Autrement dit, la bulle Apostolici regiminis se serait contentée d’affirmer que l’âme humaine survit à la mort naturelle (ou première mort), mais n’aurait rien dit à propos de l’âme de ceux qui sont condamnés à la seconde mort (les damnés)[41]. Quant à Y. Kull, on a vu qu’il se contente de citer Henri Lassiat qui affirme que « l’Église, faute de textes scripturaires, a refusé de définir si l’âme était d’une nature spirituelle et incorruptible comme celle de Dieu[42] ».
Force est de constater, cependant, que la bulle ‟conciliaire” de Léon X ne distingue pas entre immortalité conditionnelle et immortalité naturelle ou inconditionnelle, comme le font les auteurs susmentionnés, mais se contente d’affirmer absolument – sur le point qui nous intéresse – le fait de l’immortalité de l’âme intellective. Le même texte ne permet en rien de limiter la portée de son affirmation à l’état intermédiaire entre la mort et la résurrection et le jugement général. Par ailleurs, le fait qu’une définition doctrinale ait été promulguée pour répondre à une contestation bien déterminée ne supprime pas la portée générale de la doctrine énoncée. Il s’ensuit que la thèse d’une immortalité seulement conditionnelle de l’âme humaine s’oppose à la définition de Latran V et doit, par conséquent, être rejetée.
En réalité, la vérité de foi définie de l’immortalité de l’âme a été réaffirmée à diverses reprises par le magistère. Pie XI a ainsi rappelé que l’homme « possède une âme spirituelle et immortelle[43] ». L’Instruction du Saint-Office Piam et constantem sur la crémation des corps (5 juillet 1963) a rangé l’immortalité de l’âme humaine parmi les dogmes chrétiens[44]. Le concile Vatican II a enseigné à son tour au sujet de l’homme (en général) : « Lorsqu’il reconnaît en lui une âme spirituelle et immortelle, il n’est pas abusé par une fiction fallacieuse de l’imagination qui provient des seules conditions physiques et sociales ; bien au contraire, il atteint la vérité même de la réalité dans sa profondeur[45]. »
Réagissant aux remises en cause contemporaines, la Congrégation pour la doctrine de la foi a rappelé en 1979 la réalité de l’âme et sa nécessité conceptuelle :
L’Église affirme la continuation et la subsistance après la mort d’un élément spirituel qui est doué de conscience et de volonté en sorte que le « moi humain » subsiste, mais dans le temps intermédiaire sans le complément de son corps. Pour désigner cet élément, l’Église emploie le mot « âme » consacré par l’usage de l’Écriture et de la Tradition. Sans ignorer que ce terme prend dans la Bible plusieurs sens, elle estime néanmoins qu’il n’existe aucune raison sérieuse de le rejeter et considère même qu’un outil verbal est absolument indispensable pour soutenir la foi des chrétiens[46].
Même si ce texte n’énonce pas explicitement l’immortalité de l’âme, sa subsistance après la mort est énoncée purement et simplement, sans qu’aucun élément permette de la relativiser. Au contraire, la précision relative au temps intermédiaire, où l’âme est privée du corps, laisse supposer qu’elle continuera à subsister après ce ‟temps”, lorsqu’elle aura retrouvé « le complément du corps ».
Il est important de relever ensuite que la Congrégation pour la doctrine de la foi énumère la « doctrine sur l’immortalité de l’âme spirituelle » parmi les « doctrines de foi divine et catholique que l’Église propose comme divinement et formellement révélées et, comme telles, irréformables[47] » (il s’agit des vérités désignées par le premier alinéa de la formule conclusive de la profession de foi publiée par cette même Congrégation le 1er juillet 1988). La note théologique – la plus haute possible – attribuée ici à l’immortalité de l’âme implique logiquement que la négation obstinée de cette doctrine doit être considérée comme une hérésie[48].
On notera pour terminer que le Catéchisme de l’Église catholique rappelle lui aussi que l’âme est immortelle (cf. CÉC, no 366).
Au vu de ces textes doctrinaux, le concept d’une immortalité naturelle « relative » ou « temporaire[49] » entre la mort et le jugement dernier apparaît comme une innovation pure et simple.
c. Éléments bibliques
Dans l’Ancien Testament, le mot nèfèsh / psuchê, rendu par âme, revêt des sens divers selon le contexte où il est employé. L’haleine (neshamah) de vie insufflée par Dieu fait de l’homme une ‟âme (nèfèsh) vivante” (Gn 2, 7) et en vient à désigner la personne elle-même (et parfois un animal). Parallèlement à neshamah et à nèfèsh, on trouve encore le terme de roûah̲ / pneuma, souvent traduit par esprit (comme force vitale), pour désigner le souffle de vie[50]. Principe vital, l’âme est souvent assimilée à la « vie » temporelle – ainsi en Ex 21, 23, où « nèfèsh pour nèfèsh » peut être rendu par « vie pour vie » –, mais ce sens inclut aussi une ouverture à une vie future, éternelle. Jésus joue sur ces différents sens lorsqu’il enseigne qu’il faut être prêt à renoncer à sa psuchê (au sens de vie terrestre, physique) pour trouver la psuchê, entendue cette fois-ci au sens de vie éternelle impliquant le salut de la personne tout entière (cf. Mt 16, 25)[51].
Concernant la survie de l’âme, Xavier Léon-Dufour fait observer qu’« à la différence de l’esprit dont jamais il n’est dit qu’il meurt, mais dont on affirme qu’il retourne à Yahweh (Jb 34, 14s ; Ps 31, 6 ; Qo 12, 7), l’âme peut mourir (Nb 23, 10 ; Jg 16, 30 ; Ez 13, 19), être livrée à la mort (Ps 78, 50)[52] ». Le même auteur ajoute cependant que l’âme descend au shéol, où mènent une existence diminuée les refâ’ïm, qui sont à comprendre comme l’ombre de l’homme entier, plutôt que des âmes par opposition aux corps. Si certains textes vétérotestamentaires suggèrent une véritable dissolution de l’être du défunt (cf. Jb 7, 8.21 ; Ps 39, 14), l’existence même de la notion de shéol manifeste que, dans son ensemble, l’homme de la Bible n’a jamais pensé à une cessation ontologique de l’existence après la mort, et ce même aux stades les plus archaïques de l’eschatologie[53]. Qu’il suffise simplement de penser à la pratique de la nécromancie (cf. 1 S 28, 3-19) et, plus largement, au culte des ancêtres pratiqué dans de nombreuses cultures, ainsi qu’aux offrandes déposées dans les tombes, déjà attestées il y a 300 000 ans[54]. Par ailleurs, le fait que le fidèle remette son esprit (roûah̲), et avec lui son être même, dans la main de Dieu (Ps 31, 6) laisse deviner une espérance en une ‟survie” personnelle auprès de Dieu (voir en ce sens Ps 16, 10 [cité dans Ac 2, 27] ; 49, 16 ; 73, 24).
Tout ce donné constitue le présupposé pour les notions plus tardives de résurrection[55] et de rétribution après la mort. De son côté, le judaïsme hellénistique semble avoir adopté un modèle où l’âme seule est objet de la rétribution (cf. Sg 2, 21-22 ; 3 ; 4, 7–5, 23) et où les justes cultivent l’espérance de l’immortalité (cf. Sg 1, 15 ; 3, 4 ; 4, 1).
Au stade du Nouveau Testament, l’« esprit » (pneuma) « reçoit d’ordinaire un sens plus philosophique. L’esprit de vie (Jc 2, 26 ; Ap 11, 11) subsiste, après avoir quitté le corps (Lc 8, 55 ; 23, 46, citant Ps 31, 6 ; Jn 19, 30 ; Ac 7, 59), au ciel (He 12, 23 ; voir Dn 3, 86) ou aux enfers (1 P 3, 19 ; voir HenEt 22, 3-13)[56] ». (Au sujet de la relation entre l’« esprit » et les défunts, on notera que pneuma peut aussi avoir le sens de spectre d’un mort ou fantôme, cf. Lc 24, 37.39[57].) Alexander Sand observe de même, mais cette fois-ci au sujet du principe de vie que représente la psuchê :
Dans la mort, la force vitale se dissout et continue à vivre en un lieu hors du monde (Ac 2, 27 [citant Ps 16, 8-11b LXX] ; 2, 31 t. r. ; Ap 6, 9 ; 20, 4. […] Il n’y a pas non plus identité [entre la psuchê] et la vie physique […] ; car la vie de l’homme exprimée dans la ψυχή ne s’achève pas dans la mort (Ac 2, 27 ; cf. 1 Co 15, 50sv.)[58].
On relèvera dans ce contexte que cette persistance dans l’être n’est pas réservée aux justes, comme en témoignent les représentations sous-jacentes à la parabole du mauvais riche et de Lazare (cf. Lc 16, 19-31). Dans le cas de Judas Iscariote, cette persistance est discrètement évoquée lorsqu’il est dit qu’après sa mort il s’en est allé « à sa place à lui » (Ac 1, 25).
d. Éléments de réflexion théologiques et philosophiques
Même si la révélation biblique elle-même et sa transmission subséquente en divers courants théologiques ont été exposées à des influences philosophiques et mythiques extérieures (platonisme et néoplatonisme, stoïcisme, gnose, hermétisme, orphisme, etc.) dans le domaine de la conception de l’âme, elles n’ont pas manqué d’exclure d’entre les éléments assimilés les contenus incompatibles avec cette même Révélation. Cela se vérifie notamment pour les quatre points suivants : 1/ « L’âme humaine, tout en étant de nature intellectuelle et immortelle, n’est pas divine par nature : elle est seulement capable d’être progressivement déifiée, par une libre participation que Dieu lui accorde[59] » ; elle n’est donc pas pars divinae substantiae ni une émanation de la divinité, mais créée comme toutes les autres créatures ; 2/ elle n’est pas préexistante au corps[60] ; 3/ son union au corps ne constitue pas une chute, conséquence d’une faute ; 4/ elle n’est pas susceptible de migrer dans un autre corps après la mort (métempsycose). En tout cas, on ne saurait identifier représentations bibliques et représentations juives ni éliminer les éléments hellénistiques de l’Écriture, comme si seuls les éléments proprement juifs étaient véritablement inspirés[61].
La notion d’incorruptibilité (aphtharsia) ou d’immortalité (athanasia) de l’âme est contenue dans le Livre de la Sagesse[62]. Cependant, il faut admettre que dans ces textes l’immortalité est entendue généralement comme une récompense que Dieu accorde aux justes. Ainsi, lorsqu’il est dit que « la justice est immortelle » (Sg 1, 15), cela peut se comprendre au sens où « celui qui pratique la ‟justice” (cf. 1, 1) est assuré de l’immortalité[63] ». Ce sont les âmes des justes qui sont « dans la main de Dieu » et leur espérance qui était « pleine d’immortalité » (Sg 3, 1.4). « L’attention aux lois, c’est la garantie de l’incorruptibilité » (Sg 6, 18). Il n’est donc pas étonnant de constater que des exégètes réfutent l’idée d’une immortalité intrinsèque de l’âme. Werner Bieder écrit ainsi : « Si ce qui est mortel doit revêtir l’immortalité (1 Co 15, 53.54), il est clair pour Paul que l’immortalité n’est rien d’inhérent à l’homme ou à son âme[64]. » Claude Tresmontant écrivait de même : « Ce n’est pas en vertu de sa nature que l’âme est immortelle, c’est en vertu d’un don surnaturel et gracieux que l’homme est appelé à participer à la vie même de Dieu[65]. » Il y aurait donc une contradiction entre les résultats de l’exégèse et les affirmations du magistère.
S’ensuit-il qu’il faille souscrire à la thèse d’une immortalité seulement conditionnelle de l’âme ? À notre avis, la réponse est affirmative seulement si l’on tend à assimiler l’immortalité de l’âme à la vie éternelle auprès de Dieu et donc au salut[66]. Or ces deux réalités doivent être distinguées conceptuellement (même si elles tendent, il est vrai, à se confondre dans le Livre de la Sagesse, notamment). L’immortalité de l’âme est accompagnée de la vie éternelle (la béatitude) seulement dans le cas des bienheureux. Par contre, lorsque la Sainte Écriture évoque le sort des condamnés, par exemple en Dn 12, 2 ; Sg 4, 19 ; Mt 25, 46, elle présuppose implicitement une immortalité ‟neutre” de l’âme, au sens d’une simple permanence dans l’existence du noyau personnel[67]. La distinction entre l’immortalité comprise comme vie en présence de Dieu et l’immortalité en un sens plus philosophique de maintien dans l’existence existe en germe dès l’eschatologie primitive de l’Ancien Testament, où l’« on n’attend pas une survie après la mort (cf. 2 S 12, 15-24) », ce qui « n’empêche pas les Israélites de croire que les trépassés continuent d’exister dans le royaume des morts[68] ». Il faudra garder à l’esprit cette distinction importante lorsqu’il sera question plus avant du concept de « seconde mort ». On peut dire que l’existence pure et simple est ici moins que vivre et plus que de ne plus être du tout.
En réalité, aucun auteur sensé n’a pensé que l’immortalité de l’âme impliquait que la vie éternelle était inhérente à la nature humaine, sans quoi la prière de l’Église pour avoir part à cette vie n’aurait aucun sens[69]. Cette immortalité n’exclut pas la damnation éternelle, comme en témoigne par exemple l’auteur de l’épître à À Diognète à la fin du IIe siècle[70], car l’accès à la vie éternelle (bienheureuse) est conditionné. Saint Pacien de Barcelone (fin du IVe siècle) écrit ainsi : « Ce qui est propre à l’homme, c’est ce que le Christ lui a donné par son Esprit : la vie perpétuelle, si toutefois nous ne péchons plus désormais[71]. »
De manière générale, lorsqu’il est question d’un accès conditionnel à l’immortalité, c’est l’accès des élus à une condition où la mort n’existe plus qui est visé. Pour Théophile d’Antioche (IIe siècle), Dieu a ainsi créé l’homme ni mortel ni immortel par nature, « mais disposé pour être l’un ou l’autre […], pour qu’il reçût de lui comme récompense l’immortalité et devînt dieu s’il tendait à l’immortalité en observant le commandement de Dieu, et que, si au contraire il se tournait vers les œuvres de mort en désobéissant à Dieu, il fût la cause de sa propre mort[72] ». Faudrait-il voir dans cette « mort » un anéantissement ? Cependant, le même auteur oppose ailleurs la vie éternelle, que recevront de Dieu ceux qui recherchent l’incorruptibilité, aux « châtiments éternels » et au « feu éternel » que subiront les incrédules[73]. M. Fromaget affirme rapidement que « Théophile a appris de ce châtiment qu’il est la mort », sans quoi sa conception de la double condition de l’homme (ni mortel ni immortel) aurait été privée de sens[74]. Il est clair, toutefois, que le concept de mort et celui de châtiment éternel ne s’excluent pas l’un l’autre ; au contraire, l’À Diognète évoque « la véritable mort, réservée à ceux qui auront été condamnés au feu éternel[75] » (voir aussi l’économie de la parabole du riche et de Lazare). Par ailleurs, la destruction de la mort annoncée en 1 Co 15, 26 n’empêche pas l’Écriture de développer un discours sur le châtiment sans fin des réprouvés ; les deux sont donc distincts. Ajoutons un autre passage, inspiré visiblement de 1 Co 15, 52-53 ; 2 Co 5, 2.4, dans lequel Théophile d’Antioche ne semble pas exprimer autre chose que l’espérance qu’avec la résurrection le croyant tout entier, chair et âme, devienne participant de l’immortalité divine : « Quand tu auras déposé ce qui est mortel et revêtu l’incorruptibilité, alors, selon ton mérite, tu percevras Dieu. Car Dieu ressuscite ta chair, pour la rendre immortelle, avec l’âme. Si désormais tu as foi en lui, alors tu percevras, étant immortel, l’immortel[76]. »
Il est d’autant plus souhaitable de distinguer l’immortalité de l’âme et la vie éternelle entendue comme salut, que la catégorie sotériologique fondamentale du Nouveau Testament est l’attente de la parousie et la résurrection / transformation (1 Co 15, 51-52) pour « être avec le Christ » pour « toujours » (Ph 1, 23 ; 1 Th 4, 17). En rigueur de termes, « l’immortalité au sens de l’immortalité de l’âme n’est pas une catégorie de salut, mais fonctionne comme continuum entre l’existence historique et la vie de ressuscité[77] ». P. Hoffmann était parvenu à une conclusion similaire dans un article plus ancien : « L’immortalité de l’âme, comme telle, n’est pas encore pour les auteurs [du Nouveau Testament] significative de salut. Aussi, bien qu’elle puisse être présupposée, elle n’est pas exprimée[78]. » Le chrétien n’attend pas son salut de l’immortalité de son âme, mais de la communion avec le Christ glorifié. La reprise de la doctrine de l’immortalité de l’âme par la théologie chrétienne a été comprise en ce sens non comme une adaptation ou une assimilation de la foi aux catégories de pensée hellénistiques[79], mais comme la condition de possibilité d’un discours intelligible sur la résurrection :
À l’encontre du scepticisme concernant l’au-delà et du manque d’espérance régnant dans le monde païen du Ier siècle avant l’ère chrétienne[80] jusqu’au IIIe siècle après J.-C., la théologie chrétienne s’allia avec la philosophie platonicienne et ses arguments en faveur d’une immortalité de l’âme. Il ne s’agissait pas, en l’occurrence, d’une hellénisation de la foi, mais « de créer une position à partir de laquelle la doctrine de la résurrection pouvait être exposée »[81].
Il faut résoudre ici un paralogisme courant consistant à déduire du fait que, selon la métaphysique de type platonicien, l’âme est immortelle parce que divine par nature, la proposition suivante : « Si l’homme est créé, l’immortalité ne saurait être un privilège de nature, une propriété ontologique inhérente à la nature même de l’âme, mais une espérance, fondée non sur la nature de l’âme, mais sur la fidélité de Dieu[82]. » À l’encontre de cette déduction erronée, la doctrine chrétienne affirme simultanément la nature créée de l’âme et son immortalité ou incorruptibilité. Il appartient en effet au pouvoir divin de produire des créatures (anges et âmes humaines) dont la nature est immatérielle et simple et qui, de ce fait, ne sont pas soumises à la corruption[83]. Cela n’implique en rien que ces créatures seraient éternelles, et donc divines comme Dieu, puisque créées par lui de rien[84], ni qu’elles ne dépendraient pas ontologiquement de la causalité universelle de Dieu qui doit les maintenir dans l’existence comme toute autre créature[85]. Cela signifie que, sur le plan de la création ou de la nature, et non de la grâce surnaturelle, Dieu a voulu faire de l’âme humaine « une réalité incorporelle et subsistante[86] », la dotant intrinsèquement de l’être qu’il lui donne continuellement et indéfiniment, de manière qu’elle ne puisse pas le perdre[87].
Saint Thomas d’Aquin explique que si la matière se corrompt, c’est parce que la forme se sépare de la matière ; or, l’âme rationnelle ou intellective étant une forme subsistante – elle est « par elle-même forme du corps humain[88] » –, elle ne peut perdre de forme car elle ne saurait être séparée d’elle-même. Que l’être ne puisse être enlevé à la forme, c’est parce que « l’être convient de soi à la forme, qui est un acte[89] ». Seul un acte d’anéantissement de la part de Dieu pourrait donc supprimer l’être de l’âme. C’est ce qu’il faut comprendre lorsque l’on dit que « l’âme rationnelle a l’être [esse] par soi[90] » ou qu’elle est un être nécessaire sur le plan de l’essence. Non que les âmes seraient nécessaires sur le plan de l’être comme l’est Dieu seul, en qui l’essence coïncide avec l’acte d’être ou esse (plutôt que l’existence), puisqu’elles ont besoin d’une cause pour être et sont donc contingentes sur le plan de l’être auquel elles participent et qu’elles reçoivent de Dieu, mais au sens où, une fois créées, elles ne possèdent en elles « aucune puissance à être ou à ne pas être : à leur création [elles] ont reçu de Dieu un être éternel [sempiternum esse][91] ». Commentant ce passage de saint Thomas, le Père Jean-Pierre Torrell apporte les éclaircissements suivants :
Leur nécessité [celle des anges et des âmes humaines] se perçoit au mieux par rapport à la contingence des êtres matériels dont la caducité est inscrite dans leur nature même : tout ce qui est composé est appelé à se défaire un jour. À l’inverse, les substances spirituelles sont bien des êtres créés, mais comme leur essence ne s’identifie pas à leur existence (cas de Dieu seul), elles ont besoin d’une cause efficiente pour venir à l’être, et Dieu est libre de les créer ou pas[92], comme éventuellement aussi de les supprimer[93]. Une fois créées cependant ces substances n’ont pas en elles-mêmes de puissance à n’être pas ; elles sont incorruptibles et c’est en ce sens qu’elles sont éternelles[94].
Dans un texte traitant des anges, mais qui vaut également ici pour les âmes, l’Aquinate nous aide à mieux comprendre en quel sens l’âme peut être dite ‟nécessaire” et pourquoi sa nature créée ne contredit pas son incorruptibilité :
Il y a des êtres nécessaires dont la nécessité a une cause. Il n’est donc pas contradictoire que l’être d’une chose nécessaire et incorruptible dépende d’une autre comme de sa cause. Lorsque S. Grégoire dit que tous les êtres, même les anges, retomberaient dans le néant si Dieu ne les soutenait dans l’être, il ne veut donc pas dire que les anges renferment un principe de corruption, mais que leur être dépend de Dieu comme de sa cause. Une chose est dite corruptible, non point parce que Dieu peut la réduire à néant en lui retirant son action conservatrice, mais parce qu’elle renferme en elle-même un principe de corruption, ou une contrariété, ou au moins la puissance de la matière[95].
On retiendra donc que l’âme humaine fait partie des êtres à la fois créés et nécessaires par essence, parce qu’ils ne possèdent pas en eux de principe intrinsèque de corruption. En ce sens, l’immortalité de l’âme humaine découle de son essence. Étant une forme simple (directement actualisée par l’esse, alors que l’esse actualise le composé d’âme et de corps chez l’animal), cette essence est de soi incorruptible, à la différence des êtres corporels dont l’esse ou acte d’être actualise une nature de soi composée et donc décomposable[96].
Les mises au point qui précèdent auraient vraisemblablement permis de dissiper bien des méprises, par exemple lorsque M. Fromaget et Y. Kull déduisent de 1 Tm 6, 16, où il est dit que Dieu seul possède l’immortalité, que celle-ci ne peut être une propriété naturelle de l’âme humaine, mais seulement une grâce surnaturelle[97]. Ce raisonnement dénote à notre avis une articulation déficiente entre le plan naturel et le plan surnaturel. La grâce vient parfaire la nature comme l’on sait[98] et, de manière générale, Dieu « pourvoit à tous les êtres conformément à leur nature[99] ». Appliqué à notre propos, cela veut dire que le don de l’immortalité bienheureuse aux élus comme grâce n’est intelligible (et possible selon la puissance ordonnée de Dieu) que parce que ceux-ci possèdent naturellement une âme immortelle, au sens d’une simple pérennité dans l’être (immortalité ‟neutre”), et par là apte à recevoir une telle grâce. En d’autres mots, l’âme humaine doit être « préadaptée » (C. Tresmontant) ou prédisposée à recevoir l’immortalité en son acception plénière de vie éternelle[100] : celle-ci est certes un don, mais un « don préparé » dans la création naturelle[101]. L’existence d’une âme spirituelle naturellement immortelle est en réalité présupposée par le caractère éternel ou définitif du jugement (cf. He 6, 2), en tant qu’il détermine une rétribution éternelle (sans fin), à la fois pour les bienheureux et les réprouvés. L’affirmation de l’immortalité naturelle de l’âme humaine ne contredit pas 1 Tm 6, 16 car seul Dieu possède l’immortalité de manière absolue, au sens où il ne pourrait pas ne pas la posséder, tandis que l’âme (et non l’homme !) la possède en tant que créature, et donc toujours en dépendance d’une libre disposition du Créateur de la nature.
Après réflexion, on a parfois l’impression que M. Fromaget se bat contre des moulins à vent, notamment lorsqu’il croit devoir critiquer une anthropologie censée défendre l’immortalité naturelle de l’homme[102]. Mais qui a dit que « l’homme ne peut mourir, parce qu’il est fait de corps et d’âme et que son âme est immortelle[103] » ? Le Christ lui-même, dont la mort est confessée dans le Credo, n’a-t-il pas été affranchi de la mort seulement après sa résurrection (cf. Rm 6, 9) ? Et lorsque le même auteur affirme que « l’homme biblique est mortel par lui-même, il n’est pas naturellement immortel[104] », il ne fait qu’énoncer un truisme. L’immortalité naturelle de l’âme ne revient pas non plus à se prendre pour Dieu et à vouloir se suffire à soi-même[105] car elle ne se confond pas avec la vie éternelle, mais en forme seulement la condition de possibilité[106]. Puisque « le fils d’homme n’est pas immortel » (Si 17, 30), les chrétiens partagent le lot de la mortalité commune et ils croient que ce n’est qu’au travers de la résurrection que leur être corruptible pourra revêtir l’incorruptibilité et que leur être mortel pourra revêtir l’immortalité (cf. 1 Co 15, 53-54). L’immortalité / incorruptibilité de l’homme tout entier, corps et âme, ne correspondent cependant à la glorification que chez les prédestinés (cf. Rm 8, 30). En ce sens, elles demeurent un objet d’espérance et de prière[107] (on a parlé de « vocation à l’immortalité[108] »), tout en supposant une vie fidèle au Christ et une mort « dans le Seigneur » (Ap 14, 13). Saint Ignace d’Antioche pouvait ainsi exhorter saint Polycarpe de Smyrne : « Sois vigilant comme l’athlète de Dieu. L’enjeu en est l’incorruptibilité et la vie éternelle[109]. »
Une observation pour terminer : on a vu que, selon Y. Kull, l’affirmation de l’immortalité naturelle de l’âme correspondrait à une sorte d’hybris « luciférienne » d’un homme qui se voudrait Dieu. Cela ne l’empêche pas d’écrire que c’est à l’homme de décider si son âme – ou lui-même – sont immortels ou non[110], autrement dit, « c’est à moi de décider si mon existence durera pour toujours ou prendra fin pour toujours[111] ». Mais n’est-ce pas là précisément une manifestation de l’hybris contemporaine que de vouloir décider de son être ou de son non-être ? Que de ne plus accepter que la nature humaine soit un donné qui ne dépend pas de nous, mais d’un projet créateur qui nous précède[112] ? Et, en dernière analyse, de ne plus accepter le concept même de nature, en l’occurrence d’une nature humaine dotée d’une âme qui existera toujours, quoi que nous fassions ? Certes, il est juste de retenir que le devenir éternel de l’homme dépend aussi de sa liberté, mais penser que l’homme est le seul artisan de sa pérennité dans l’être (cas des élus) ou de sa disparition ontologique (cas des réprouvés) contredit non seulement sa nature créée qui le rend ontologiquement dépendant de Dieu, mais obscurcit également le primat et la souveraineté de l’agir divin, tels que les manifestent notamment la prédestination et la prédétermination[113].
2. Au sujet de l’annihilation des damnés ou conditionalisme
a. De quoi parle-t-on ? Précisions sur le concept d’annihilation
En philosophie, l’annihilation est définie comme une destruction de l’être lui-même, par opposition au simple changement[114]. Elle correspond à la suppression de tout l’être d’un étant, donc non seulement de sa forme substantielle, mais également de la matière, de manière que de cet étant il ne subsiste plus de puissance réelle. Il existe par conséquent une différence essentielle entre l’annihilation et la dissolution ou destruction d’un étant, dont les parties constitutives sont dissoutes ou transformées, mais dont l’existence n’est de ce fait pas encore totalement supprimée[115]. Klaudius Jüssen notait à juste titre que l’annihilation correspond à une mutation métaphysique à l’instar de la création ex nihilo et de la transsubstantiation, ce qui implique qu’elle ne peut être réalisée que par la toute-puissance divine[116]. À supposer que Dieu annihilait un être, ajoute l’auteur au même endroit, il le ferait par simple soustraction de son action conservatrice positive et permanente à l’égard des êtres créés, sans laquelle ceux-ci ne peuvent subsister dans l’être. En effet, un agir divin positif dont le terme immédiat serait le non-être ne saurait être pensé[117].
Précisons ici que la thèse dont il est question est généralement désignée indifféremment par les termes d’annihilationisme ou de conditionalisme, même si, en rigueur de termes, il conviendrait de distinguer les deux. En effet, le premier cas de figure suppose une action annihilatrice (négative ou positive) de la part de Dieu à l’égard des réprouvés, tandis que le second suppose que la résurrection et l’immortalité de l’âme sont conditionnées par l’état de salut, de sorte que les damnés sont laissés par Dieu indéfiniment dans la mort. Dans ce cas, il faut cependant admettre que celle-ci équivaut à une cessation de l’existence (théorie de la « mort totale » ou Ganztodtheorie), du moins après le jugement universel[118]. Conscient de la distinction qui vient d’être faite, nous emploierons toutefois les deux termes pratiquement comme des synonymes puisque l’aboutissement visé est identique : la disparition des damnés et donc aussi de celle de l’enfer au sens où l’entend la doctrine catholique. Les auteurs ne sont d’ailleurs pas toujours très clairs sur la manière dont les réprouvés passent de l’être au non-être, passage métaphysique dont on peut d’ailleurs se demander comment ou s’il est possible de le penser sans une intervention divine. Dans notre cas, M. Fromaget tend nettement vers l’annihilation des impies, tandis qu’Y. Kull suppose une sorte de suicide métaphysique : en disant non à Dieu, l’impie se coupe de la vie et sombre dans la seconde mort[119].
On a vu que l’un des arguments majeurs avancés par M. Fromaget consistait à dire que pour désigner la damnation, l’Écriture employait fréquemment les catégories de la mort et du feu, la symbolique du feu, en particulier, évoquant une « destruction complète », et même une « annihilation totale[120] ». Or nous venons de voir que la destruction d’un étant, même complète, n’équivaut pas à son annihilation ontologique. Le feu physique détruit ainsi ce qu’il consume en le décomposant en ses différents éléments, mais sans leur enlever l’être. Une chose similaire peut être dite de l’action corruptrice de la mort à l’égard du corps : celle-ci signe, certes, la fin de l’existence de l’homme comme unité hylémorphique puisqu’un composé de matière et de forme cesse d’exister dès que l’une est séparée de l’autre[121]. Pour autant, elle n’entraîne ni la disparition de l’âme ni l’annihilation de la matière corporelle. De la sorte, ni la catégorie de la mort ni celle du feu ne sont réellement aptes à suggérer un anéantissement des damnés. C’est ce qu’il faut garder à l’esprit lorsque les Saintes Écritures, notamment les écrits pauliniens, suggèrent une destruction ou un anéantissement des réprouvés par l’emploi de termes comme phthora, olethros ou katargein.
b. Survol historique et première appréciation
Il existe une diversité d’opinions au sujet du châtiment de la géhenne et de la résurrection des impies dans les écrits rabbiniques du Ier siècle et au-delà[122]. La notion de damnation éternelle côtoie ainsi l’idée selon laquelle « les impies ne seront ressuscités que pour être jugés et détruits, les cendres de leur âme dispersées sous les pieds des justes[123] ». Dans l’école de Hillel, on trouve l’idée selon laquelle certains pécheurs moins coupables sont châtiés dans la géhenne pendant douze mois, avant que leurs corps ne soient détruits et que leurs âmes ne soient brûlées (renvoi est fait à Ml 3, 21), au point qu’ils cesseront d’exister, semble-t-il[124]. Friedrich Lang retient lui aussi que dans le judaïsme contemporain au Nouveau Testament, l’idée d’un anéantissement total des condamnés coexistait avec celle d’une peine éternelle[125]. Cependant, l’idée d’un tel anéantissement demeure discutée[126]. Ainsi, selon Simon Légasse, « l’ancien judaïsme, qu’il soit hellénistique ou palestinien (y compris celui de Qumrân) n’envisage jamais un anéantissement des impies[127] ».
Au cours des premiers siècles de l’ère chrétienne, les gnostiques en général, comme les valentiniens, nièrent de facto l’enfer dans la mesure où, d’après eux, les hyliques (les hommes matériels par opposition aux psychiques et aux spirituels), qui ne se sont pas libérés de la matière, sont destinés à la dissolution ou à la destruction par le feu (cette manière de voir étant mêlée chez eux à l’idée de la destruction finale de la matière)[128]. L’apologète Tatien[129] et saint Justin sont parfois considérés comme partisans de l’annihilationisme. Les Homélies pseudo-clémentines comportent elles aussi l’idée d’une ‟extinction” des impies après un temps de châtiment par le feu, même si l’on y trouve simultanément l’affirmation d’un châtiment éternel des âmes des impies[130]. Ainsi, les négligents qui n’adhèrent pas à la religion définie par Dieu lui-même « seront totalement anéantis par le plus grand châtiment[131] ». Pour l’idée d’extinction, on peut citer le passage suivant :
Les non-repentis recevront leur fin du châtiment par le feu, même s’ils sont par ailleurs absolument religieux ; comme je l’ai dit, quand ils auront été châtiés par le feu éternel pendant le cinquième de la durée de cet âge, ils s’éteindront. Car ils ne peuvent plus exister pour toujours, ceux qui ont été impies envers le Dieu qui est pour toujours et qui est unique[132].
Tout à la fin du IIIe siècle, l’apologète africain Arnobe de Sicca propose à nouveau l’idée – déjà rencontrée chez Tatien et Théophile d’Antioche – d’une immortalité conditionnelle des âmes ; celles-ci « sont de qualité intermédiaire, comme l’a enseigné l’autorité du Christ, et susceptibles à la fois de périr si elles ont ignoré Dieu, et d’être exemptées de perdre la vie si elles ont été attentives à ses menaces et à ses bontés[133] ». L’importance d’Arnobe pour notre sujet tient au fait qu’il est apparemment le premier auteur chrétien à décrire explicitement comme un véritable anéantissement la mort véritable (mors vera) que subiront les âmes des impies après leur mort corporelle et un très long supplice. Défendant le discours chrétien sur les « géhennes » et les « feux inextinguibles » contre les moqueries des païens, l’auteur évoque dans le second livre de son Adversus nationes le sort de ces âmes au milieu « des fleuves brûlants de tourbillons de feu et affreux avec leurs remous fangeux » :
Elles y sont jetées, et réduites à néant [ad nihilum redactae], elles se dissipent [vanescunt] dans la frustration d’une mort éternelle. […] La véritable mort de l’homme, la mort qui ne laisse rien derrière elle [nihil residuum faciens] – car celle que saisit notre regard est la séparation des âmes d’avec les corps, et non le terme ultime de l’anéantissement – la véritable mort de l’homme, dis-je, la voici : c’est lorsque les âmes ignorantes de Dieu, livrées à de très longues tortures, seront consumées par un feu cruel ; les y jetteront des êtres d’une cruauté féroce, inconnus avant le Christ et révélés par lui, le seul qui sache[134].
Le patrologue Brian E. Daley signale encore deux auteurs syriaques, le premier étant le nestorien Narsai le « Lépreux » († 502 ou 503), fondateur de l’école de Nisibe après avoir dirigé celle d’Édesse. Celui-ci affirme que le Christ apparu en gloire annihilera l’Antichrist – un être humain totalement possédé par Satan – à la fois en son corps et en son âme, en soulignant le caractère exceptionnel et miraculeux de cette annihilation, étant donné que l’âme est indestructible par nature[135]. En second lieu, l’évêque monophysite Philoxène de Mabbog ou Mabboug (Hiérapolis), mort en 523, avance que le mal et, pour le moins, les mauvais esprits seront annihilés à la fin des temps[136].
Ces quelques exemples d’auteurs favorables à l’idée de l’annihilation ou considérés comme tels par certains, ne doivent pas faire oublier que l’écrasante majorité des auteurs chrétiens anciens croyaient fermement au châtiment définitif des réprouvés[137]. Mise à part une résurgence parmi les sociniens au XVIe siècle[138], la compréhension de la seconde mort comme anéantissement disparut pratiquement jusqu’au milieu du XIXe siècle, quand un certain nombre de théologiens protestants libéraux reprirent à leur compte la théorie du conditionalisme[139]. Par la suite, celle-ci s’est surtout développée au sein de différentes dénominations du monde protestant et / ou évangélique aux États-Unis. On peut nommer ici les adventistes ou « Église adventiste du septième jour[140] » (mais pas toutes ses fractions[141]), l’« Advent Christian Church » (anéantissement des mauvais après la résurrection), la « Life and Advent Union » (anéantissement dès la mort)[142] et certains « baptistes du septième jour ». Les « témoins de Jéhovah », quant à eux, considèrent qu’au terme d’une épreuve finale de mille ans après la résurrection, le petit groupe des obstinés inconvertibles subira un ‟anéantissement naturel”[143]. Dans la théologie contemporaine, les auteurs favorables au conditionalisme, tel l’anglican John Stott, continuent à provenir majoritairement des diverses dénominations protestantes ou évangéliques[144].
En considérant les deux millénaires du christianisme, on peut retenir avec Marcel Richard que, dans l’ensemble, « le conditionalisme n’a jamais été bien répandu nulle part[145] ». Ce constat est encore plus net parmi les auteurs catholiques, ce qui explique que la thématique en question n’est généralement que brièvement traitée ou même laissée de côté dans les manuels ou les monographies consacrés à l’eschatologie[146]. Le caractère marginal qui distingue le conditionalisme – entendu ici comme ailleurs dans le sens de l’annihilation finale des damnés – n’est pas seulement d’ordre quantitatif, mais touche avant tout le plan doctrinal. En effet, force est de constater qu’il n’a été proposé que dans le cadre de courants manifestement hétérodoxes (comme la gnose ou les sociniens) ou du moins en marge de l’orthodoxie chrétienne, ou encore en dehors du christianisme (comme dans le cas des « témoins de Jéhovah »). Cela vaut non seulement pour l’Église indivise, mais également pour les communautés issues de la Réforme, où le conditionalisme n’a été ou n’est défendu que par des groupes séparés des grandes confessions historiques. Il est également significatif à cet égard qu’Arnobe, qui est vraisemblablement l’auteur ancien ayant défendu le plus explicitement l’annihilationisme et que M. Fromaget ne mentionne pas, curieusement, a indéniablement défendu des positions s’éloignant de la doctrine chrétienne[147]. À plus forte raison, la même chose pourrait être dite au sujet de Tatien, auteur hérétique[148] que M. Fromaget cite à plusieurs reprises parce qu’il défendait l’immortalité conditionnelle de l’âme[149], si tant est que l’auteur du Diatessaron ait effectivement défendu l’annihilation des réprouvés.
En définitive, comme on le verra encore, sur le long terme la thèse annihilationiste n’a été défendue indubitablement par aucun théologien chrétien de premier plan. En ce sens, elle fait figure d’option encore plus marginale que l’apocatastase qui, elle, a au moins été soutenue par tout un courant de pensée, dont quelques auteurs chrétiens très importants de l’antiquité chrétienne. En tout cas, lorsqu’on passe en revue les promoteurs du conditionalisme à travers les siècles, on peut leur appliquer ce que Emil Brunner écrivait au sujet de la « lignée d’ancêtres vraiment pas très illustre des partisans de l’apocatastase », à savoir que « cet arbre généalogique doit donner à réfléchir[150] ».
c. Éléments scripturaires
On l’a vu, pour M. Fromaget damnation et anéantissement sont « rigoureusement indissociables[151] ». Or le Nouveau Testament parle de l’état de damnation non comme d’une suppression des damnés, mais comme d’un état de souffrance : « là seront les pleurs et les grincements de dents » (Mt 22, 13 ; 25, 30). Le mauvais riche ne cesse pas d’être dans l’Hadès, mais il est « en proie à des tortures » (Lc 16, 23). Les Écritures ne parlent pas seulement du feu inextinguible, mais aussi du « châtiment éternel » (Mt 25, 46 ; 2 P 2, 9). Si Mt 10, 28 pourrait suggérer une annihilation des réprouvés, la géhenne (11 occurrences dans les évangiles synoptiques), dans laquelle Dieu peut faire périr l’âme et le corps, renvoie dans le Nouveau Testament à un lieu de tourment perpétuel après la résurrection et le jugement dernier[152]. En tout cas, « l’attestation par des sources multiples est suffisamment large pour que l’on puisse considérer que Jésus envisageait l’enfer comme un lieu de tourments continus[153] ». Le dernier livre de la Bible souligne à la fois la perpétuité et le caractère ininterrompu du tourment : « Quiconque adore la Bête et son image […] subira le supplice du feu et du soufre, devant les saints Anges et devant l’Agneau. Et la fumée de leur supplice s’élève pour les siècles des siècles ; non, point de repos, ni le jour ni la nuit, pour ceux qui adorent la Bête et son image, pour qui reçoit la marque de son nom » (Ap 14, 9-11).
Pas plus que la première (la mort corporelle), la seconde mort ne correspond à une cessation de l’être[154], mais désigne le châtiment définitif[155]. Privés de l’immortalité bienheureuse octroyée aux justes, les réprouvés ne sont pas anéantis pour autant – leur erreur est précisément de croire que les morts seront comme s’ils n’avaient jamais existé (cf. Sg 2, 1-5) –, mais plutôt précipités dans l’Hadès, « objet d’outrage parmi les morts à jamais [aiônos] », « dévastés, en proie à la douleur, et leur mémoire périra » (Sg 4, 19). « L’étang de feu et de soufre », dans lequel sont jetés tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie (cf. Ap 20, 15), et qui est identifié à la « seconde mort » en Ap 20, 14, ne correspond pas à une annihilation, mais à un châtiment perpétuel : « Alors le diable, leur séducteur, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, y rejoignant la Bête et le faux prophète, et leur supplice durera jour et nuit, pour les siècles des siècles » (Ap 20, 10). Commentant ce passage, l’exégète Ugo Vanni réfute explicitement l’idée d’un anéantissement des damnés :
L’image de « l’étang de feu qui brûle dans le soufre » indique une situation définitive et circonscrite (l’étang) dans laquelle s’actualise continuellement une destruction (feu) qui rend la vie impossible (soufre). […] Les protagonistes du mal ne sont pas anéantis : […] cette situation constitue un tourment qui se situe dans le temps transcendant des « siècles des siècles ». […] Il y a – mais sans aucune précision descriptive ou de coloris – l’idée d’une punition permanente[156].
Le caractère définitif du châtiment de la géhenne est encore exprimé par « le feu qui ne s’éteint pas » ou « inextinguible » (asbestos) (Mt 3, 12 ; Mc 9, 43.48 ; Lc 3, 17), ainsi que par « le ver qui ne meurt point » (Mc 9, 48). Ces textes s’inspirent notamment de Is 66, 24 où l’idée de mort (« les cadavres des hommes révoltés ») est combinée avec celle d’un tourment sans fin par le ver et le feu[157]. Même si Is 66, 24 a été interprété par certains exégètes dans le sens d’une corruption physique ou d’une destruction totale (Totalvernichtung), la compréhension dans le sens d’un châtiment éternel est bien plus probable, comme l’atteste d’ailleurs l’apocalyptique postérieure :
Le ver qui ne meurt pas décrit un processus de décomposition sans fin du corps, que l’âme du mort éprouve comme douleur (cf. Is 50, 11 […]) ; il est donc signe de la damnation éternelle, liée à la souffrance. […] En tout cas, plus tard l’apocalyptique a compris la tournure dans le sens d’une souffrance éternelle[158].
Dans le but de contester cette notion d’un châtiment perpétuel, M. Fromaget et Y. Kull recourent en particulier à trois arguments. Le premier, classique, consiste à relativiser la portée du mot « éternel », aiônios, lorsqu’il se rapporte au châtiment ou au feu, pour ne l’appliquer au sens plénier qu’à Dieu ou à la participation à sa vie[159]. Nous avons déjà eu l’occasion de répondre ailleurs de manière détaillée à cet argument proposé de nouveau dans l’ample étude d’Ilaria Ramelli[160]. Contentons-nous ici de reprendre quelques éléments de notre réponse. Dans le Nouveau Testament, aiônios se rapporte à l’éternité divine, aux biens du salut eschatologique et à des états sans commencement ou sans fin[161]. L’adjectif est ainsi appliqué à Dieu (Rm 16, 26), à l’Esprit (He 9, 14), à la vie (Mt 19, 16 ; 25, 46), au salut (He 5, 9) et au Royaume (2 P 1, 11), mais aussi à des maux, comme celui du péché « éternel » (Mc 3, 29), le feu infernal (Mt 18, 8 ; 25, 41), le châtiment (Mt 25, 46), la ruine ou la perte (2 Th 1, 9). Horst Balz écrit : « Plus fortement encore qu’avec l’accentuation positive [d’aiônios], la signification sans fin, perpétuel est soulignée avec cette accentuation négative[162]. » Les sémitismes caractéristiques « pour / dans les siècles des siècles » (eis tous aiônas tôn aiônôn ou eis aiônas aiônôn), qui soulignent au plus haut point l’éternité[163], sont appliqués dans le livre de l’Apocalypse à la vie du Christ glorieux (1, 18) et de Dieu (4, 9), au règne du Christ (11, 15) et des élus (22, 5), mais aussi au supplice des adorateurs de la Bête (14, 11) et à celui du diable, de la Bête et du faux prophète (20, 10). Même en tenant compte de la spécificité théologique de l’éternité divine et des biens qui y participent, il serait arbitraire d’accepter ou de nier la dimension perpétuelle ou définitive qu’impliquent ces expressions, selon qu’elles s’appliquent à des biens ou à des maux. Signalons enfin que dans le lexique consulté, les trois emplois d’aiônios en Mt 25, 41.46 sont rapportés à une durée sans fin[164].
Le second argument avancé s’appuie sur l’emploi de la notion du feu pour caractériser la peine des réprouvés dans la Bible. À ce sujet, nous avons déjà exposé plus haut pourquoi cette notion ne nous semble pas apte à suggérer un anéantissement des damnés[165]. M. Fromaget défend la dimension symbolique du feu infernal qui signifierait la consommation / destruction de ceux qui sont totalement impurs[166]. Le même auteur propose ailleurs de comprendre le feu éternel comme « un feu qui ne s’éteint pas avant d’avoir consumé la totalité de ce qui lui est donné de brûler[167] ». Le feu serait donc éternel non quant à son existence, mais quant à son résultat[168]. Les textes scripturaires parlent cependant purement et simplement d’un feu qui ne s’éteint pas (asbestos). Par ailleurs, on demeure perplexe lorsqu’il est question d’« un feu absolu, qui vaporise dans le néant les malheureux qu’il consume[169] » : comment un feu de nature symbolique pourrait-il avoir un effet sur l’être ? Cet étrange physicisme, qui est au fondement de la thèse selon laquelle le feu ‟éternel” ne peut durer toujours au motif qu’il est de la nature du feu de s’éteindre après avoir consumé ce qu’il détruit[170], ne tient pas compte de la nature transcendante du feu infernal[171]. De fait, les théologiens ayant maintenu le caractère réel ou corporel de ce feu soulignent simultanément que sa nature diffère du feu de ce monde-ci[172]. Pour sa part, J. Ratzinger avait interprété le feu de l’enfer à partir de la dimension cosmique de l’enfer, qui ne permet pas de le réduire à une dimension psychologique interne à la conscience[173].
Le troisième argument avancé en faveur de l’annihilationisme consiste à dire que la damnation est fréquemment décrite par les termes de mort ou de destruction. De fait, chez saint Paul il est question de phthora (ruine, destruction, anéantissement, corruption)[174], de thanatos (mort)[175], d’apôleia (perdition, plutôt que destruction)[176], d’apollumenois (ceux qui se perdent)[177], d’olethros (perte, ruine, anéantissement)[178], de katargein (faire disparaître, détruire)[179], d’orgê et de thumos (colère, fureur, voir Rm 2, 8). L’emploi d’un langage plus abstrait et théologique pour évoquer la damnation[180] ne peut guère servir à suggérer un anéantissement ontologique, étranger aux représentations bibliques, mais peut s’expliquer par l’auditoire pagano-chrétien de Paul qui ignorait le concept de géhenne. Il reste que « même si Paul ne propose pas de description imagée de l’enfer, il parle cependant en toute clarté de la perdition éternelle après le jugement final[181] », ce à quoi le préparait sa formation dans la tradition pharisienne qui connaissait un tel châtiment des mauvais après la mort[182].
- Fromaget avance par ailleurs l’idée selon laquelle la liberté d’être, que Dieu a conférée à l’homme, implique que celui-ci ait aussi la liberté de ne pas être et donc de disparaître[183]. En d’autres termes, l’homme devrait avoir la possibilité « de refuser, sans représailles », le don de la vie (éternelle) fait par Dieu, en s’échappant en quelque sorte dans le non-être[184]. Mais, comme l’avait bien entrevu Marcel Richard qui y voyait l’erreur radicale du conditionalisme, une telle représentation méconnaît la signification théologique de la condition créée et ses corollaires : d’une part, le fait que la créature participe à l’être, mais n’en dispose pas ; d’autre part, la souveraineté de Dieu par rapport à l’être et à la vie[185]. Au sujet du lien entre la condition créée et l’impossibilité de s’extraire de la dépendance ontologique d’avec le Créateur, on peut citer ce texte de sainte Catherine de Sienne :
Sache que personne ne peut sortir de mes mains, parce que Je suis celui que Je suis, et vous n’êtes pas par vous-mêmes, mais vous êtes faits par moi qui suis créateur de toutes choses qui participent à l’être […]. Mais de moi ils [les hommes pécheurs] ne peuvent sortir ; ou ils y sont pour la justice à cause de leurs fautes, ou ils y sont pour la miséricorde[186].
De fait, d’après le donné révélé, la vie repose entre les mains de Dieu (cf. 1 S 2, 6 ; Ps 104, 29-30), de sorte que l’homme, qui ne s’appartient pas, n’en est point le maître (cf. 1 Co 6, 19 ; CÉC, no 2280). Nulle créature n’est en mesure de se soustraire à l’omniprésence de Dieu : « personne n’échappe à sa main » (Tb 13, 2 ; cf. Ps 139 ; Am 9, 2-4). Cela vaut également pour l’impie qui, ne pouvant échapper au châtiment (cf. He 10, 29 ; 12, 25), doit s’attendre à la perspective « effroyable » de « tomber aux mains du Dieu vivant » (He 10, 31). Admettre que l’homme serait à même de pouvoir se soustraire à Dieu, qui donne l’être, remettrait enfin en cause les doctrines fondamentales de la rétribution et du jugement (particulier et général) comme prérogatives divines, selon lesquelles le sort éternel de l’homme dépend d’abord de la sentence divine et non du seul choix humain.
d. Éléments du christianisme ancien
Comme l’immortalité de l’âme, la doctrine de l’éternité de l’enfer ne serait que le fruit d’une exégèse « tardive » et « improbable[187] », en contradiction avec le « christianisme originel ». Or la doctrine catholique de l’enfer entendu comme châtiment perpétuel n’est pas due aux systématisations de saint Augustin ou de saint Thomas d’Aquin, mais ses éléments fondamentaux sont en place dès l’âge des Pères apostoliques, postapostoliques et des apologistes (Ier-IIIe siècles)[188]. L’idée que Dieu « réserve aux rebelles punition et tourment[189] » se trouve ainsi dans la Prima Clementis, attribuée à saint Clément de Rome (vers 96). Dans sa description de la voie des ténèbres, l’Épître de Barnabé (Ier-IIe siècles) combine de manière très intéressante l’idée de mort éternelle avec celle des tourments : « La voie du Noir [Satan] […] est, dans sa totalité, la voie de la mort éternelle [thanatou aiôniou] dans les tourments[190]. » Pour saint Ignace d’Antioche († vers 110), les hérétiques corrompant la foi et ceux qui les écoutent iront « au feu inextinguible[191] ». On lit dans ce qui semble être la première homélie chrétienne conservée (première moitié du IIe siècle)[192], attribuée autrefois à saint Clément de Rome : « En accomplissant la volonté du Christ, nous trouverons du repos ; mais si ce n’est pas le cas, rien ne nous délivrera du châtiment éternel [aiôniou kolaseôs], si nous désobéissons à ses commandements[193]. » Le même écrit évoque plus loin « ceux qui ont manqué le but et nié Jésus, par leurs paroles ou leurs actes, [et qui] sont châtiés par des tortures terribles, d’un feu qui ne s’éteint pas[194] ».
Dans tous ces textes, le feu éternel dont Dieu menace les impies ne correspond pas à un anéantissement total, mais à un châtiment. Pour le Pasteur d’Hermas (vers le milieu du IIe siècle), « les pécheurs seront brûlés parce qu’ils ont péché et ne se sont pas repentis[195] ». Au proconsul Quadratus menaçant de le faire brûler vif s’il ne maudit pas le Christ[196], saint Polycarpe de Smyrne rétorque en opposant le feu terrestre et le feu du jugement qui demeure : « Tu me menaces d’un feu qui brûle un moment et peu de temps après s’éteint ; car tu ignores le feu du jugement à venir et du supplice éternel [aiôniou kolaseôs], réservé aux impies[197]. » Pour l’auteur de l’À Diognète (fin du IIe siècle), il s’agit de mépriser la mort physique et de redouter « la véritable mort, réservée à ceux qui seront condamnés au feu éternel [pur to aiônion], châtiment définitif [telous kolasei] de ceux qui lui auront été livrés[198] ».
Chez saint Justin Martyr († vers 165), il est vrai, on trouve certains passages au moins potentiellement conditionalistes ; ainsi, lorsqu’il dit que les âmes des méchants « sont châtiées tant que Dieu veut qu’elles existent et soient châtiées[199] » ou lorsqu’est évoquée « la destruction de l’ensemble de l’univers qui doit mettre fin à l’existence de tout ange, démon et homme malfaisants[200] ». Dans l’ensemble, cependant, l’apologète insiste lourdement et fréquemment sur le fait que ceux qui sont devenus chrétiens « croient que seront punis dans un feu éternel les criminels et les débauchés[201] ». Si tous avaient conscience que « chacun s’achemine, selon le mérite de ses œuvres, vers un châtiment ou un salut éternel », « personne ne choisirait le mal, ne fût-ce qu’un seul instant, sachant qu’il s’achemine vers une condamnation éternelle au supplice du feu[202] ». Le caractère perpétuel du supplice infernal est souligné de manière spéciale : « Le châtiment que subiront les coupables, dans leurs propres corps unis à leurs âmes, durera éternellement, et non point uniquement, comme le prétendait ce philosophe [Platon], pour une période de mille ans[203]. » Soucieux de justifier la possibilité d’une telle peine, Justin écrit que « les âmes des méchants subissent un châtiment parce qu’elles conservent, même après la mort, la faculté de sentir[204] ». Pour ce qui est du corps, il renvoie à Is 66, 24 pour affirmer que « les membres de ceux qui ont transgressé doivent être rongés par ‟un ver et un feu perpétuel”, demeurant immortels pour servir de spectacle à toute chair[205] ».
Les nombreux textes cités jusqu’ici démontrent à quel point est dénuée de fondement l’affirmation stupéfiante selon laquelle il n’y aurait aucune mention de l’enfer éternel chez les auteurs chrétiens majeurs, depuis la fin du premier siècle jusqu’à la fin du second[206]. Il est d’ailleurs remarquable d’observer que la littérature apologétique ancienne comprend des textes réfutant explicitement la thèse de l’annihilation. Ainsi, pour saint Justin, penser que toutes les âmes meurent « serait véritablement une aubaine pour les méchants[207] ». Vers 177, Athénagore d’Athènes écrit pour sa part : « Si nous chutons avec les autres, notre sort sera pire, dans les flammes – car Dieu ne nous a pas façonnés comme du petit bétail ou des bêtes de somme, comme une chose futile pour que nous soyons détruits et que nous disparaissions[208]. » Au cours de la première moitié, voire du premier tiers du IIIe siècle, Minucius Félix dénonce à son tour l’erreur de ceux qui imaginent disparaître après la mort pour échapper au châtiment :
La plupart des gens, conscients de ce qu’ils méritent, forment le vœu qu’il n’y ait rien après la mort, plutôt qu’ils ne le croient ; ils préfèrent disparaître complètement plutôt que d’être restaurés pour des supplices. […] Et il n’y a ni mesure ni terme à ces supplices. Là-bas, un feu doué d’intelligence brûle les membres et les reconstitue[209].
Toujours au cours de la première moitié du IIIe siècle, saint Cyprien insiste sur le caractère irréversible et douloureux du châtiment de la géhenne, qui atteindra le corps et l’âme des damnés : « De ses flammes inextinguibles, ce châtiment les dévorera ; et ils ne disposeront d’aucun moyen pour qu’un jour leurs tortures puissent connaître répit ou fin. Ils sont préservés, corps et âmes, dans d’infinies souffrances, pour leur tourment[210]. »
Étant donné que M. Fromaget et Y. Kull invoquent tous deux saint Irénée de Lyon comme un témoin majeur du conditionalisme, il convient d’accorder une attention particulière à cet auteur. Remarquant que « le feu éternel n’a pas été préparé principalement pour l’homme », mais pour le diable et ses anges, Irénée ajoute cependant que « c’est ce même feu que subiront aussi en toute justice ceux qui, à l’instar de ces anges, dans l’impénitence et l’obstination, auront persévéré dans les œuvres mauvaises[211] ». Plus loin, Irénée affirme explicitement que la damnation des réprouvés n’aura point de terme :
De même que [dans le Nouveau Testament] le soin à apporter à la vie morale s’est étendu, […] de même la perdition de ceux qui n’obéissent pas au Verbe de Dieu, méprisent sa venue et retournent en arrière, s’est amplifiée elle aussi, n’étant plus temporelle, mais étant devenue éternelle. Car tous ceux à qui le Seigneur dira : « Allez-vous-en loin de moi, maudits, au feu éternel », seront condamnés pour toujours[212].
Rien, dans ce texte, ne permet de supputer que les « maudits » ne subsisteront pas pour toujours. De même, dans le passage qui suit, il semble pour le moins hasardeux de vouloir identifier la « mort » à un anéantissement ontologique, et ce d’autant plus qu’Irénée maintient par ailleurs l’immortalité (et l’incorporéité) de l’âme[213] :
À tous ceux qui se séparent volontairement de lui [Dieu], il inflige la séparation qu’eux-mêmes ont choisie. Or la séparation d’avec Dieu, c’est la mort ; […] c’est la perte de tous les biens venant de lui. Ceux donc qui, par leur apostasie, ont perdu ce que nous venons de dire, étant privés de tous les biens, sont plongés dans tous les châtiments : non que Dieu prenne les devants pour les châtier, mais le châtiment les suit par là même qu’ils sont privés de tous les biens[214].
À l’encontre de l’idée de l’anéantissement des impies (et par conséquent de la non-éternité des peines de l’enfer) qu’Henri Lassiat attribuait à saint Irénée, Dom Adelin Rousseau, spécialiste de l’œuvre d’Irénée qu’il a traduite et éditée dans la collection des « Sources chrétiennes », a souligné explicitement que celui-ci professait l’éternité des peines infernales :
Sur ce mystère redoutable, Irénée ne fait que témoigner de la foi de l’Église de son temps, et cette foi n’est elle-même que l’écho des grandes affirmations de l’Écriture : il ne saurait faire de doute que, pour lui, à l’éternelle béatitude des élus dans le sein de Dieu ne fasse pendant l’éternelle et inexprimable souffrance de ceux qui, en se livrant au mal, se seront eux-mêmes exclus de la communion divine. C’est cet enseignement même […] que l’Église consacrera par la suite dans les interventions de son magistère solennel et qu’elle professera jusqu’à nos jours[215].
Au terme de cette section, on peut retenir que le discours sur l’enfer à l’époque des Pères apostoliques et des apologistes demeure « largement marqué par un simple réalisme biblique[216] », ces auteurs se contentant en général de rappeler qu’un feu inextinguible attend les pécheurs[217]. En tout cas, l’attribution de l’annihilation des réprouvés au « christianisme originel » est manifestement contredite par le donné scientifique comme le suggère aussi, entre autres, le fait que le conditionalisme n’est mentionné nulle part dans les pages que B. E. Daley consacre aux Pères apostoliques et aux apologètes[218].
e. Éléments magistériels
L’Église a toujours maintenu que tant la béatitude des bienheureux que le châtiment des damnés n’auront pas de terme : « Derrière les mystérieuses portes de la mort se profile une éternité [aevum sempiternum] de joie dans la communion avec Dieu ou de peine dans l’éloignement de Dieu[219]. » En particulier, la thèse de l’annihilation des réprouvés se situe en opposition frontale avec l’enseignement constant du magistère ordinaire ou extraordinaire au sujet du caractère perpétuel des peines de l’enfer. Elle est encore implicitement contredite par l’affirmation de l’universalité de la résurrection de tous les morts, justes et injustes, à la suite de Jn 5, 28-29 ; Ac 24, 15 (cf. CÉC, no 998). Quelques textes devront suffire ici pour le démontrer.
Exposant la foi catholique nécessaire au salut, le Symbole Quicumque, dit de saint Athanase (vers 430-500), affirme qu’à la venue du Christ, « ceux qui ont bien agi iront dans la vie éternelle, mais [- !] ceux qui auront mal agi, au feu éternel[220] ».
S’il est vrai que la condamnation de l’apocatastase dans le cadre du concile particulier de Constantinople en 543 ne visait pas expressément la thèse qui nous intéresse, il reste qu’elle l’englobe indirectement, en tant que cette thèse nie précisément l’éternité des peines de l’enfer : « Si quelqu’un dit ou pense que le châtiment des démons et des impies est temporaire, et qu’il prendra fin après un certain temps […], qu’il soit anathème[221]. » La relativisation de la valeur de cette condamnation[222], approuvée très vraisemblablement par le pape Vigile lors de son séjour forcé à Constantinople entre 547 et 555[223], néglige notamment le fait que le concile de Florence a répété la condamnation de l’apocatastase[224].
La Fides Pelagii professe au sujet des impies que le Christ « les livrera par son très juste jugement aux peines du feu éternel et inextinguible afin qu’ils brûlent sans fin[225] ».
Citant la lettre de saint Fulgence de Ruspe à Eugippius, le pape Adrien Ier affirme que « pour les méchants, [Dieu] n’a pas préparé des volontés mauvaises ou des œuvres mauvaises, mais il leur a préparé des supplices justes et éternels[226] ».
Le concile de Latran IV définit qu’à la fin des temps, « tous ressusciteront avec leur propre corps qu’ils ont maintenant, pour recevoir, selon ce qu’ils auront mérité en faisant le bien ou en faisant le mal, les uns un châtiment sans fin avec le diable, les autres une gloire éternelle avec le Christ[227] ».
Innocent IV ne dit pas autre chose : « Si quelqu’un meurt sans pénitence en état de péché mortel, il ne fait pas de doute qu’il sera tourmenté pour toujours par les feux de l’enfer éternel[228]. »
En 1955, le pape Pie XII a rappelé que « le fait de l’immutabilité et de l’éternité [du] jugement de réprobation et de son accomplissement est hors de toute discussion[229] ».
Dans sa Profession de foi solennelle du 30 juin 1968, le pape Paul VI a réaffirmé l’enseignement traditionnel quant au sort final des hommes : « Ceux qui auront répondu à l’amour et à la bonté de Dieu iront dans la vie éternelle, mais ceux qui les auront refusés jusqu’à leur fin [leur mort] seront voués au feu qui ne s’éteindra jamais[230]. »
En 1979, la Congrégation pour la doctrine de la foi a déclaré que « l’Église, dans la fidélité au Nouveau Testament et à la Tradition […], croit qu’une peine attend pour toujours le pécheur qui sera privé de la vue de Dieu, et à la répercussion de cette peine dans tout “l’être” du pécheur[231] ».
On peut lire enfin dans le Catéchisme de l’Église catholique, qui renvoie à de nombreux textes du magistère : « L’enseignement de l’Église affirme l’existence de l’enfer et son éternité. Les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort dans les enfers, où elles souffrent les peines de l’enfer, “le feu éternel” » (CÉC, no 1035)[232].
Ces textes ou d’autres qui leur sont similaires sont écartés trop légèrement par M. Fromaget[233]. En raison de son enracinement dans la Révélation et les définitions de foi dont elle a fait l’objet (voir notamment le texte de Latran IV), la doctrine ecclésiastique sur l’enfer doit être considérée comme une vérité de foi divine et catholique et, partant, infaillible. À ce titre, on ne saurait la réduire à « l’enseignement devenu traditionnel dans l’Église[234] », comme si elle était de même nature que la doctrine sur la guerre juste (cf. CÉC, no 2309) ou la tradition affirmant que Lucifer pécha par orgueil et qu’il entraîna un tiers des anges dans sa chute (en référence à Ap 12, 4).
Si « la thèse conditionnaliste [sic], comme telle, n’a pas été condamnée[235] », cela n’est vrai que sur le plan purement formel car, du point de vue du contenu, elle s’oppose non seulement à l’enseignement positif de l’Église sur l’enfer, mais encore à sa doctrine sur l’immortalité de l’âme, dont on a déjà montré qu’elle est de fide definita. L’absence d’une définition magistérielle censurant explicitement le conditionalisme peut s’expliquer par le caractère marginal de cette théorie et n’implique pas qu’il soit légitime de la défendre. En effet, de même que seules certaines vérités ont été définies par le magistère au cours des âges[236], seules certaines propositions hétérodoxes ou erronées ont été condamnées par lui en bonne et due forme.
f. Pourquoi Dieu n’annihile pas : réflexions complémentaires
L’homme n’est pas en mesure de supprimer son être en raison de sa dépendance ontologique en tant que créature : à ce titre, l’être auquel il participe lui est communiqué par le Créateur et il ne dépend pas de lui de le posséder – Dieu doit le conserver dans l’être[237] – ou d’en être privé. Reste alors l’hypothèse que le Créateur prive sa créature de l’être. D’un point de vue plus spéculatif et métaphysique, il convient d’observer à ce propos que si Dieu décrétait l’annihilation des damnés, il poserait par là même un acte difficilement compréhensible, voire contre nature (au sens large) sur le plan de l’ontologie, puisqu’il ferait passer de l’être au non-être, alors que, d’après saint Augustin, « celui [Dieu] qui n’est pas comptable du néant n’est pas cause de déficience, c’est-à-dire d’un penchant au néant, étant la cause qui fait être, causa essendi, si l’on peut dire[238] ». Sur ce point, l’Aquinate apporte les précisions suivantes :
Le non-être n’a pas de cause par soi, car rien ne peut être cause sinon en tant qu’il est de l’être ; et l’être, à proprement parler, est cause d’être. C’est pourquoi Dieu ne peut être cause d’une tendance au non-être. Cette tendance, la créature la possède par soi, en tant qu’elle vient du néant. Cependant Dieu peut être cause par accident de l’anéantissement des choses : il suffirait qu’il leur retire son action conservatrice[239].
Le Créateur de tout n’est-il pas précisément un Dieu qui « appelle le néant à l’existence » (Rm 4, 17 BJ), i. e. qui « appelle à l’existence ce qui n’existe pas » (Rm 4, 17 TOB) ? Le Dieu de la Bible crée et maintient dans l’existence (cf. Sg 11, 25 ; He 1, 3) ; il n’annihile pas, fût-ce des créatures totalement perverties et endurcies sur le plan moral. On observera à ce sujet que la fin du monde ne signifiera pas non plus l’anéantissement total de la création, dont la destruction par le feu (ekpyrôsis, voir 2 P 3, 10-12) est à conjuguer avec le renouvellement ou la régénération (palingenesia, Mt 19, 28) du monde en une création nouvelle (cf. Ap 21, 5).
Il faut encore tenir compte du fait que la foi catholique affirme que la substance de tous les êtres est bonne[240], ce qui implique que le mal est d’ordre moral et non ontologique. Il n’existe donc pas de substance du mal, ce qui vaut aussi pour le diable, et donc a fortiori pour les damnés[241]. Il s’ensuit qu’un acte d’annihilation impliquerait que Dieu soit à l’origine d’une diminution d’être et donc du bien, ce qui est difficilement compatible avec l’image biblique de Dieu. De fait, l’Écriture affirme que Dieu « a tout créé pour l’être » (Sg 1, 14 BJ) ou « a créé tous les êtres pour qu’ils subsistent » (Sg 1, 14 TOB)[242]. Il aime tout ce qui existe (en tant qu’il existe) et n’aurait pas créé quelque chose pour l’anéantir ensuite (cf. Sg 11, 24). Qo 3, 14 va jusqu’à dire que « tout ce que Dieu fait sera pour toujours[243] ». En particulier, Dieu, qui « n’a pas fait la mort » (Sg 1, 13), « a créé l’homme pour l’incorruptibilité » (Sg 2, 23). Klaudius Jüssen conclut en ce sens : « Comme le laissent entendre les témoignages de la Révélation et l’enseignent unanimement les théologiens, Dieu […] n’annihilera aucune créature, bien qu’il pourrait le faire, absolument parlant. […] Les êtres doués de raison subsisteront éternellement in individuo[244]. »
De plus, au vu du bien de l’être en soi, l’annihilation des damnés devrait logiquement être, du moins sur le plan objectif, un châtiment pire encore que la damnation éternelle qui, elle, prive certaines créatures du bien de la vision béatifique, mais sans leur retirer le bien de l’être tout court[245]. À l’objection invoquant Mt 26, 24, où Jésus affirme que mieux eût valu pour Judas de ne pas naître, le Docteur commun répond que cet exemple « ne signifie pas que le non-être soit attirant en soi ; il ne l’est que par accident, en tant qu’il enlève un mal ; c’est cette suppression qui est désirable, en tant que ce mal est privation d’être[246] ». Jean-Louis Chrétien commente avec sagacité à ce propos :
Le non-être peut être désiré sub ratione boni si le seul être qui nous soit offert est un être décapité, amputé de la perfection qui l’achève. De là provient le vœu de néant des damnés. […] Ce vœu est l’expression d’un désordre, son expression et sa conséquence à la fois. Le désordre du péché, qui les a conduits à cet endurcissement définitif dans le mal, fait que les damnés veulent mal tout ce qu’ils veulent, même quand ils veulent un bien. Ainsi leur inclination naturelle pour l’être, à laquelle s’oppose leur volonté délibérée du non-être, devient elle-même perverse, du fait que ce bien qu’est l’être n’est plus ordonné par eux au bien suprême. Ils sont deordinati ab ultimo fine[247].
Si l’on voulait objecter que ce n’est pas Dieu qui annihile les damnés, mais que ce sont les damnés eux-mêmes qui se précipitent, pour ainsi dire, dans le néant de la seconde mort, il faudrait redire qu’en raison de son statut de créature, il n’est pas dans le pouvoir de l’homme de passer de l’être au non-être, pas plus qu’il n’est en son pouvoir de passer du non-être à l’être. Le seul qui pourrait, de puissance absolue, annihiler une créature, en cessant de la maintenir dans l’être, est Dieu. Saint Thomas fonde cette possibilité de principe sur le fait que Dieu n’a pas produit les choses dans l’être par nécessité de nature, mais par sa libre volonté, d’où il suit : « De même qu’avant la création des choses, il pouvait ne pas leur communiquer l’être et, de la sorte, ne pas les produire ; de même, une fois les choses réalisées, il peut cesser de leur communiquer l’être : elles cesseront alors aussitôt d’exister. C’est cela les réduire à néant[248]. » L’Aquinate ne manque cependant pas d’ajouter que, de fait, Dieu n’opérera jamais une telle annihilation, comme on le verra encore plus loin. En effet, un anéantissement ontologique représenterait une mutation métaphysique à l’exact opposé de l’acte créateur. Possible en soi, une telle éventualité contredirait ainsi l’idée chrétienne de création, selon laquelle Dieu a produit tout ce qui existe par sa sagesse et sa parole créatrice, et le maintiendra dans l’existence[249] (ce qui ne n’exclut pas des transformations).
Saint Thomas envisage l’hypothèse d’une réduction à néant successivement selon le cours naturel des choses, puis hors de l’ordre naturel (cas du miracle). Dans le premier cas,
les natures des créatures montrent que nulle d’entre elles n’est réduite à néant ; car ou bien elles sont immatérielles, et il n’y a pas en elles de puissance au non-être ; ou bien elles sont matérielles, et elles subsistent toujours, au moins quant à la matière, qui est incorruptible, car elle subsiste comme sujet de la génération et de la corruption[250].
Reste alors l’hypothèse d’une intervention miraculeuse de la puissance divine consistant à faire passer une créature de l’existence au non-être. Un tel acte serait cependant privé de sens car les miracles sont ordonnés à manifester l’ordre supérieur de la grâce. Or
la réduction d’une chose à néant ne saurait se rattacher à la manifestation de la grâce, car la puissance et la bonté divines sont davantage manifestées par la conservation des choses dans l’être. Il faut donc conclure purement et simplement qu’absolument rien n’est réduit à néant[251].
En définitive, il y a une infinité de choses que Dieu pourrait faire s’il le voulait[252], comme anéantir l’ensemble de la création[253], mais dont nous pouvons savoir certainement qu’il ne les fera jamais[254].
3. Au sujet de la méthode
a. Rappel de quelques fondamentaux
Les réalités de l’enfer et de la damnation comptent parmi les mystères de la foi les plus difficiles et les théologiens ont toute liberté pour chercher à en donner une meilleure intelligence, mais pas à n’importe quelles conditions. Comme toute discipline de l’esprit, la théologie possède une méthode et des exigences qui lui sont propres. En l’occurrence, la recherche du théologien « s’inscrit à l’intérieur d’un savoir rationnel dont l’objet est donné par la Révélation, transmise et interprétée dans l’Église sous l’autorité du Magistère, et reçu par la foi[255] ». On dira plus simplement que cette recherche doit toujours s’exercer à l’intérieur de la foi de l’Église[256]. Ignorer ce principe revient à cesser de faire de la théologie[257]. Par ailleurs, l’utilisation, par la théologie, d’éléments et d’instruments conceptuels provenant d’autres disciplines, comme l’anthropologie, « exige un discernement qui trouve son principe normatif ultime dans la doctrine révélée[258] ».
À la lumière de ce qui vient d’être dit, et au-delà du contenu de la thèse développée par les auteurs des deux ouvrages examinés dans cet article, nous essayerons de mettre succinctement en évidence le caractère problématique de leur démarche, et notamment un usage souvent inadéquat des sources du travail théologique.
b. L’hypothèse d’une rupture dans la Tradition
La thèse défendue par M. Fromaget et Y. Kull présuppose une rupture nette entre la compréhension de l’immortalité de l’âme et de la damnation par « Jésus-Christ, les évangélistes, les apôtres et les premiers Pères de l’Église[259] », d’une part, et ce qui a été cru et enseigné dans et par l’Église au cours des siècles postérieurs, jusqu’au magistère contemporain, d’autre part. En d’autres termes, à partir des IIIe-IVe siècles, environ, l’Église aurait globalement erré dans l’interprétation et la transmission de certains contenus de la Révélation. Cette hypothèse s’oppose à la compréhension catholique de la transmission de la Révélation divine. En effet, l’Église croit que Dieu « a disposé que [la Révélation] demeure toujours en son intégrité et qu’elle soit transmise à toutes les générations[260] ». Cette disposition divine garantissant l’intégrité de la transmission du dépôt de la foi « ad nos usque[261] » se concrétise notamment en deux institutions fondamentales étroitement imbriquées entre elles. La première est la Tradition apostolique qui, moyennant l’assistance du Saint-Esprit et la succession apostolique, assure la transmission ininterrompue et fidèle de la Parole de Dieu à chaque génération[262]. La seconde est le magistère ecclésiastique qui découle du charisme certain de vérité lié à la succession apostolique[263]. Grâce à lui, l’unique dépôt sacré de la Parole de Dieu, et donc le dépôt divin de la foi transmis par les apôtres, sont gardés saintement et exposés avec fidélité et autorité dans l’Église[264], « colonne et support de la vérité » (1 Tm 3, 15). En définitive, c’est grâce à l’assistance générale du Saint-Esprit promis à l’Église par le Christ (cf. Jn 16, 7.13), que les fidèles dans leur ensemble sont dotés d’un sens surnaturel de la foi qui les empêche de se tromper en matière dogmatique[265]. Cette vérité de foi se manifeste notamment au travers du charisme de l’infaillibilité, dont le Christ a pourvu son Église pour définir la doctrine en matière de foi et de mœurs[266].
Certes, ces principes irréfragables n’impliquent pas que toutes les affirmations de ces témoins privilégiés de la Tradition que sont les Pères et les docteurs de l’Église – et encore moins celles des autres théologiens – aient été exemptes d’erreurs ou d’ambiguïtés (que l’on pense simplement aux diverses formes de millénarisme ou de monarchianisme / subordinatianisme défendues par nombre de Pères ou de théologiens des premiers siècles). De la sorte, à supposer même que saint Irénée, par exemple, ait effectivement défendu le conditionalisme, cela n’autoriserait pas pour autant de le suivre sur ce terrain contre la doctrine générale de l’Église, dont l’autorité prime sur celle de ses membres en particulier, même éminents[267]. Sur le plan théologique, il est par conséquent aberrant, en partant de quelques auteurs anciens, d’en appeler à « l’authentique tradition catholique » ou à « la Tradition apostolique et de la jeune Église du IIe siècle[268] » pour contester la doctrine des peines éternelles de l’enfer, transmise précisément jusqu’à nous par la Tradition vivante et sanctionnée par le magistère.
c. Une lecture inadéquate des Saintes Écritures
Selon M. Fromaget, « la véritable doctrine concernant le sort ultime des méchants semble faire partie de ces trésors que le Créateur a cachés aux sages et aux savants[269] ». Et d’en appeler, comme on l’a vu, à une lecture de l’Écriture allant au plus simple, en faisant l’économie de toute érudition. Mais surtout, le moyen de faire émerger le sens du texte inspiré serait de « s’en remettre au texte seul[270] », à la manière des sémioticiens. Cet ‟allègement” exégétique préconisé par l’auteur ne fait pas seulement montre d’une certaine naïveté, dans la mesure où il semble ignorer que la lecture d’un texte ne peut faire complètement abstraction d’un certain nombre de présupposés, et donc d’une certaine précompréhension de la part du lecteur. Il implique surtout le rejet, au moins implicite, du grand principe catholique de l’interprétation des Saintes Écritures, à savoir d’en faire une lecture cum Ecclesia, commune, à la lumière de « la Tradition vivante de toute l’Église[271] », par opposition à une interprétation privée, c’est-à-dire particulière du donné révélé (cf. 2 P 1, 20).
Le motif de cette exigence est le fait que « tout ce qui concerne la manière d’interpréter l’Écriture est finalement soumis au jugement de l’Église, qui exerce le ministère et le mandat divinement reçus de garder la Parole de Dieu et de l’interpréter[272] ». Ce mandat appartient de manière spéciale au magistère ecclésiastique[273].
d. Concernant le magistère
On relèvera tout d’abord, chez M. Fromaget en particulier, la tendance nette à une sorte de positivisme théologique ou magistériel limitant ce qui est ‟dogmatique”, et donc contraignant en terme d’adhésion de foi, aux vérités définies comme telles par le magistère ecclésiastique[274]. Or « il n’est nullement nécessaire que tout ce qui fait partie de la foi […] devienne expressément un dogme[275] ». Si « certaines vérités » (quaedam veritates) ont été définies au cours de l’histoire[276], toutes ne l’ont pas été. L’absence d’une définition ex cathedra sur un point de doctrine ne signifie donc pas nécessairement que cette doctrine puisse être considérée comme n’étant pas de foi et niée, le cas échéant[277]. La vérité d’une doctrine, qui découle essentiellement de son appartenance à la Révélation, doit en effet être distinguée du mode concret par lequel l’autorité de l’Église reconnaît cette appartenance. En d’autres mots, la valeur doctrinale d’un texte magistériel dépend d’abord de son contenu, plus que de ses caractéristiques formelles et du degré d’autorité que l’autorité entend lui conférer. On peut citer à ce propos Tarcisio Bertone :
On confond souvent la question de l’infaillibilité du Magistère et la question de la vérité de la doctrine, […] en faisant dépendre la vérité et le caractère définitif d’une doctrine de l’infaillibilité ou non de la déclaration magistérielle. En réalité, la vérité et le caractère irréformable d’une doctrine dépendent du depositum fidei, transmis par l’Écriture et la Tradition, alors que l’infaillibilité ne se réfère qu’au degré de certitude de l’acte d’enseignement magistériel[278].
Ainsi, par exemple, n’ayant pas été l’objet de contestations significatives (jusqu’au XXe siècle), l’existence du diable et des démons n’a jamais été définie explicitement en tant que telle par le magistère[279], même s’il existe des textes dogmatiques traitant de leur nature, présupposant de ce fait leur existence[280]. Pourtant, l’on ne saurait nier cette dernière sans quitter l’enseignement biblique et ecclésiastique[281]. Le motif en est que l’existence des démons est attestée dans l’Écriture sainte et la tradition de l’Église, et qu’elle fait partie du magistère ordinaire et universel qui s’impose à l’adhésion des fidèles[282] et que J. Ratzinger avait identifié à « la forme normale de l’infaillibilité de l’Église[283] ». Dans notre cas, il ne fait nul doute que le magistère ordinaire et universel, dont l’importance n’est pas suffisamment honorée par M. Fromaget, tient que la damnation consiste en des peines éternelles. On ne saurait donc défendre le conditionalisme en arguant de l’absence d’une décision doctrinale ou définition ex cathedra dont le but immédiat aurait été d’affirmer les peines éternelles de l’enfer contre la thèse de l’anéantissement des damnés. Une telle définition n’aurait d’ailleurs été vraisemblable que si ladite thèse avait représenté une vaste remise en cause de la doctrine catholique sur l’enfer, ce qui n’a jamais été le cas.
Ensuite, au sujet du degré d’impérativité de l’adhésion aux contenus dogmatiques, M. Fromaget écrit que « pour avoir entière valeur de dogme, la définition en question doit refléter la foi commune, la tradition unanime du peuple chrétien. Elle doit aussi être issue d’un examen critique de la vérité qu’elle formule[284] ». Et l’auteur d’ajouter en note que cette exigence fait qu’« une ‟vérité de foi” n’est telle que si elle est formulée, ou maintenue, à la suite d’un examen critique et contradictoire[285] ». S’il est vrai qu’une définition dogmatique ne peut faire abstraction du phénomène de réception, i. e. de son appropriation effective dans la vie de l’Église, sur le plan théorique il y a cependant ici, à notre avis, méconnaissance de la nature du magistère comme autorité charismatique dont est dotée l’Église pour reconnaître l’appartenance d’une vérité au dépôt de la foi et pour en proposer une formulation normative à la foi des fidèles. Certes, dans la dynamique de la fides quaerens intellectum, l’adhésion aux vérités énoncées par le magistère engage pleinement l’intelligence des fidèles et la raison critique des théologiens, en particulier, a toute sa place pour rechercher la portée et la teneur exactes de la vérité définie. Toutefois, ce travail indispensable de la raison n’est pas le motif de l’acte de foi, mais seulement sa condition. La valeur dogmatique d’une vérité enseignée par le magistère dépend essentiellement de son fondement dans la Révélation, et non de son examen critique de la part du fidèle. Nous croyons aux vérités révélées à cause de l’autorité de Dieu qui les révèle, et non parce qu’elles nous apparaissent comme vraies et intelligibles à la lumière naturelle de notre raison (rationalisme)[286]. Mais cette obéissance de la foi inclut également un acte d’obéissance envers le magistère[287], dont l’autorité s’exerce au nom de Jésus Christ (cf. Lc 10, 16) et auquel il revient d’interpréter de façon authentique la Parole de Dieu, écrite ou transmise[288]. L’adhésion aux vérités de foi ne peut donc être rendue dépendante des démonstrations de leur crédibilité, comme l’a enseigné le concile Vatican I[289]. Si tel n’était pas le cas, les énoncés dogmatiques seraient subordonnés à la raison critique individuelle, instituée de ce fait en juge du magistère.
e. Le problème du dissentiment
Il est un fait que les deux auteurs qui nous intéressent font publiquement état de leur désaccord avec la doctrine catholique sur l’enfer, et ce avec plus ou moins de véhémence. À ce sujet, il convient idéalement de remémorer les recommandations de la Congrégation pour la doctrine de la foi aux théologiens continuant à éprouver des difficultés à admettre le bien-fondé de l’enseignement du magistère, au terme d’un examen sérieux et « mené dans une volonté d’écoute sans réticences[290] » (ce qui n’est pas vraiment le cas ici). En particulier, « même si la doctrine de foi ne lui apparaît pas être en cause, le théologien ne présentera pas ses opinions ou ses hypothèses divergentes comme s’il s’agissait de conclusions indiscutables[291] ».
On a vu que Y. Kull, notamment, nourrit l’espoir que le magistère finisse par abandonner l’enseignement ‟traditionnel” sur l’enfer, pour adopter sa propre position. En présence d’une telle ambition démesurée, il convient de rappeler que, de manière générale, le travail théologique présuppose un débat objectif et « une disponibilité à modifier ses propres opinions ». En particulier, les propositions nouvelles avancées par les théologiens pour l’intelligence de la foi « ne sont qu’une offre faite à toute l’Église. Il faut beaucoup de corrections et d’élargissements dans un dialogue fraternel jusqu’à ce que toute l’Église puisse les accepter[292] ».
f. Une forme de rationalisme
Pour justifier que le châtiment éternel dont il est question en Mt 25, 46 ne doit pas être pensé comme devant durer éternellement, M. Fromaget écrit, entre autres : « Imagine-t-on, en effet, Dieu passant son éternité à juger, châtier, perdre les pécheurs ? Certainement non ! C’est impensable et même stupide[293]. » Mais faire de la possibilité à être pensé le critère du réel et du vrai en matière de foi revient à verser dans le rationalisme théologique qui n’admet dans les dogmes que ce qui semble logique et satisfaisant selon la lumière naturelle[294]. Si la théologie recherche la raison de la foi[295], elle ne peut cependant soumettre la foi à la raison. On peut appliquer de manière spéciale à la réalité de la damnation ce qui vaut pour les mystères révélés en général, à savoir qu’ils « demeurent encore recouverts du voile de la foi, et comme enveloppés dans une certaine obscurité », tant que nous cheminons ici-bas. C’est dire que, même éclairée par la foi, la raison ne parvient qu’à une « certaine intelligence » (aliquam intelligentiam) des mystères divins qui, de par leur nature, dépassent l’intelligence créée[296].
Conclusion
Fondamentalement, la thèse du conditionalisme contemporain apparaît comme le produit d’un raisonnement visant à échapper au caractère abrupt et psychologiquement heurtant de la doctrine catholique des peines éternelles de l’enfer, en élaborant une troisième voie entre l’enfer éternel, jugé trop difficile à accepter aux yeux de la lumière naturelle de la raison, et l’affirmation d’un salut universel, considérée à juste titre comme étant dépourvue de fondement dans la Révélation.
On admettra sans difficulté qu’au travers de leurs ouvrages respectifs, Michel Fromaget et Yvon Kull ont eu le mérite de se confronter franchement à la problématique de la damnation, sans en esquiver le caractère dramatique par la suggestion illusoire d’un salut de tous, aujourd’hui courante. Il n’est pas si fréquent, en effet, que soit admis sans ambages que la Bible annonce un salut soumis à des conditions[297] et comprend – du moins dans le cas de M. Fromaget –l’idée d’une séparation finale entre sauvés et réprouvés. En ce sens, les ouvrages en question évitent l’universalisme sotériologique ambiant qui édulcore le mystère du refus du salut, en le reléguant au rang d’une possibilité évanescente ou théorique. On admettra également la critique d’un enfer purement conceptuel et aseptisé, qui n’a plus le courage de regarder en face l’horreur infernale, comme le faisaient les descriptions populaires de l’enfer[298].
Cela étant dit, la volonté de proposer une solution apparemment plus acceptable qu’un enfer de souffrances sans fin, sous la forme d’une annihilation des damnés, devait inévitablement se heurter au double rempart des vérités de foi que sont les peines éternelles de l’enfer et l’immortalité de l’âme. Dans la mesure où le conditionalisme implique la négation délibérée de ces vérités, il doit être considéré comme au moins matériellement hérétique[299]. Dans le cas de M. Fromaget, en particulier, cette volonté consciemment négatrice, bien au-delà d’une simple hypothèse ou d’un débat d’opinions, ne fait aucun doute[300]. En tout état de cause, la tentative de fonder la position défendue sur quelques représentants du « christianisme originel », au prix d’une relativisation ou d’une contestation des déterminations doctrinales du magistère postérieur, était condamnée à l’échec, ne serait-ce que pour des motifs de méthodologie théologique (voir la dernière section de notre article). Aussi, ne peut-on que demeurer perplexe devant le souhait obstiné des auteurs de voir le magistère changer pour faire sienne leur propre position, qu’ils savent pourtant contraire à la doctrine de l’Église sur l’enfer. On ne peut pas davantage accuser certains auteurs chrétiens, comme saint Augustin ou saint Thomas d’Aquin, et plus largement le magistère, d’avoir corrompu l’enseignement du christianisme primitif pour justifier son propre désaccord avec la doctrine catholique sur l’âme et les peines éternelles de l’enfer.
Les deux auteurs ont souhaité répondre à ce qui leur semble être une objection contre la liberté de l’homme, à savoir que celui-ci n’aurait, d’après la doctrine traditionnelle, que le choix entre servir Dieu ou être puni par lui en enfer. D’où l’hypothèse / thèse selon laquelle l’homme aurait la possibilité de refuser définitivement Dieu, sans devoir pour cela souffrir pour toujours, puisqu’il cesserait alors d’être purement et simplement après le jugement et une certaine durée de châtiment. Mais en voulant répondre à une difficulté, on en crée de la sorte une nouvelle, puisque, dans ce cas, l’homme est contraint d’aimer Dieu ou de disparaître, ce qui revient à proclamer que « le péché remporte parfois sur l’homme et sur Dieu une telle victoire, qu’il ne reste à celui-ci qu’à se débarrasser de lui par un coup de main[301] ». Et l’on ne voit pas en quoi ce modèle mériterait moins les reproches de violence formulés à l’égard de la doctrine reçue de l’enfer[302]. Celle-ci permet au moins à l’homme d’opposer un refus à Dieu et de le maintenir définitivement, sans que lui soit retiré pour cela le don initial du bien de l’être.
À défaut de pouvoir être pleinement “comprise”, la rude doctrine de la damnation telle que la professe l’Église ne peut être acceptée que si l’on saisit et admet pleinement son propre statut de créature : pas plus qu’il ne nous appartient de choisir d’être créé ou non, décider si notre existence doit durer toujours ou (par hypothèse) prendre fin pour toujours appartient non à la créature, mais au Créateur de la nature[303]. Or, les dons de Dieu étant sans repentance (cf. Rm 11, 29), la raison illuminée par la foi nous dit que le don de l’être ne sera pas repris aux créatures rationnelles, fussent-elles fixées dans l’aversion de Dieu.
En définitive, le conditionalisme peut être attribué à une sorte de réaction affolée devant une condition humaine vertigineuse plaçant chaque individu, nolens, volens, devant une éternité heureuse ou malheureuse : tertium non datur[304]. En ce sens, « il a été caractérisé comme la plus malheureuse (wretched) et la plus poltronne de toutes les théories[305] ». Son caractère insatisfaisant sur le plan intellectuel explique en partie pourquoi il a été peu défendu au cours de l’histoire, comme le reconnaît d’ailleurs M. Fromaget[306]. L’effroi suscité par l’enfer est compréhensible, mais ne justifie pas qu’on lui substitue du coup l’anéantissement, sans fondement sérieux dans la Révélation, et apportant de ce fait une mauvaise réponse à une vraie difficulté.
Mgr Christophe J. Kruijen.
Résumé. — Jugeant que l’enseignement de l’Église sur l’enfer est inacceptable et en rupture avec le « christianisme originel », Michel Fromaget et Yvon Kull ont reproposé en 2017 la thèse de l’annihilation des damnés ou conditionalisme, selon laquelle la damnation ne consisterait pas en un tourment sans fin, mais en un anéantissement de l’être même des réprouvés. Conçue comme troisième voie entre la doctrine traditionnelle de l’enfer et l’affirmation d’un salut universel, il s’agit en réalité d’une variante de la négation de l’enfer, mais moins répandue que l’apocatastase. Cette position, qui est restée globalement marginale au cours de l’histoire des doctrines chrétiennes, demeure irrecevable pour des motifs d’abord doctrinaux – elle est notamment contraire à l’enseignement dogmatique de l’Église sur l’immortalité de l’âme et la perpétuité des peines de l’enfer –, mais aussi théologiques, philosophiques et anthropologiques.
—————————————————————————————
Abstract. — Judging that the teaching of the Church on hell is inacceptable and in rupture with “original Christianity”, Michel Fromaget and Yvon Kull proposed in 2017 the thesis of the annihilation of the damned, or conditionalism, according to which damnation would not consist in unending torment, but in the annihilation of the very being of the damned. Conceived of as a third way between the traditional doctrine of hell and the affirmation of universal salvation, it is in reality a variation on the denial of hell, less spread that the theory of apokatastasis. This position, which remains marginal in the history of Christian doctrines, remains unacceptable first of all for reasons that are doctrinal — it contradicts in particular the dogmatic teaching of the Church on the immortality of the soul and the perpetuity of the pains of hell —, but also theological, philosophical and anthropological.
Mgr Christophe J. Kruijen est prêtre du diocèse de Metz. Il a travaillé auprès de la Congrégation pour la doctrine de la foi de 2008 à 2016. Docteur en théologie dogmatique (Angelicum, Rome), sa thèse a obtenu le prix “Henri de Lubac” 2010. Elle a été publiée sous le titre Peut-on espérer un salut universel ? Étude critique d’une opinion théologique contemporaine concernant la damnation (Éditions Parole et Silence, 2017), ouvrage primé par l’Académie française en 2018.
[1] Ces deux ouvrages ont apparemment été rédigés indépendamment l’un de l’autre.
[2] Michel Fromaget, De l’enfer introuvable à l’immortalité retrouvée, Les fins dernières selon le christianisme originel, « Cahiers Disputatio, Hors série 1 », Paris, L’Harmattan, 2017, 1 vol. de 362 p. Dans la suite, le renvoi à cet ouvrage, ainsi qu’à celui d’Yvon Kull (voir infra), se fera par simple indication de la page ou par le nom de l’auteur suivi de la page.
[3] M. Fromaget a amplement exposé les idées contenues dans son ouvrage dans une série de cinq entretiens avec Mme Béatrice Soltner, sur le thème : « L’enfer existe-t-il ? », diffusés du 16 au 20 avril 2018 sur le réseau RCF (Radios chrétiennes francophones). On ne peut que déplorer qu’une institution soutenue par les dons des fidèles emploie ces subsides pour diffuser des contenus contraires à la doctrine catholique, comme on le verra. Traitant des journaux catholiques, des périodiques, du cinéma, de la radio et de télévision, le concile Vatican II avait affirmé que « le but principal de toutes ces œuvres est de propager et de défendre la vérité et d’assurer une animation chrétienne de la société » (Décret Inter mirifica, no 17).
[4] De ce fait, l’A. exclut implicitement la possibilité d’accéder immédiatement à la vision béatifique après la mort (voir p. 187-188), ce que l’Église croit notamment au sujet des martyrs.
[5] Par comparaison avec la lex mortuorum de « l’anthropologie apostolique », celle de l’anthropologie catholique, qui exclut une conversion après la mort, semble « dérisoire », écrit l’A. (p. 196).
[6] Cf. Josef Finkenzeller, « Eschatologie », dans Wolfgang Beinert (Hrsg.), Glaubenszugänge, Lehrbuch der katholischen Dogmatik, vol. III, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1995, p. 525-671 (p. 563-564).
[7] On en trouvera la liste dans l’annexe 1, p. 305-325.
[8] Voir les annexes 2 et 3, p. 327-333.
[9] On pense par exemple au fameux Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament édité par Gerhard Kittel et Gerhard Friedrich ou au Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament édité par Horst Balz et Gerhard Schneider.
[10] Voir la seconde partie de cet article.
[11] César, Guerre des Gaules, Livre III, 18, 6 (trad. Léopold-Albert Constans, t. 1, « Collection des Universités de France, Série latine, 33 », Paris, Les Belles Lettres, 71961, p. 87).
[12] Tatien, Discours aux Grecs, 13, 1 (cité d’après Fromaget, p. 148). Dans la traduction plus récente de la Pléiade, cette dissolution définitive de l’âme des impies n’apparaît pas évidente : « Elle [l’âme] meurt et se dissout avec le corps si elle ne connaît pas la vérité, mais elle ressuscite plus tard, à la fin du monde, et reçoit alors la mort en châtiment, avec le corps, dans l’immortalité » (Aux Grecs, 13, 1, dans Premiers écrits chrétiens, Bernard Pouderon, Jean-Marie Salamito et Vincent Zarini, dir., « Bibliothèque de la Pléiade, 617 », Paris, Gallimard, 2016, p. 600 [abrégé : PÉC]). Le passage crucial est traduit pareillement par « receive death by punishment in immortality » dans Brian E. Daley, The Hope of the Early Church, A Handbook of Patristic Eschatology, Peabody (MA), Hendrickson Publishers, 2003, p. 22.
[13] Curieusement, l’A. mentionne le rôle de la Vierge Marie dans cette « naissance à l’esprit » (p. 178-179), mais ne dit rien du rôle du baptême et de l’Église dans la nouvelle naissance.
[14] La ‟source” indiquée en note est Bernard Gillard, Le feu sur l’abîme, Mal, souffrance, mort, pourquoi ?, Le Luhier, 1988, p. 391 et p. 527 (nous avons précisé les références).
[15] Yvon Kull, Revisiter l’enfer ou comment devenir immortel, Préface de Mgr André Léonard, Paris, Parole et Silence, 2017, 1 vol. de 214 p.
[16] On notera que le Code de droit canonique en vigueur dispose que « les membres des Instituts religieux, pour pouvoir publier des écrits traitant de questions religieuses ou morales, ont besoin aussi de la permission de leur Supérieur majeur selon les constitutions » (can. 832). Le livre du chanoine Kull ne fait mention d’aucune permission dans ce sens.
[17] Ainsi, lorsque l’A. tend à tirer argument contre l’immortalité naturelle de l’âme du fait d’avoir eu « les frissons » lorsqu’il fut confronté à cette idée (p. 172).
[18] Seule l’essence du ‟damné” subsisterait dans la pensée de Dieu, mais son « moi » n’aurait plus d’existence réelle (p. 194).
[19] L’A. se réfère ici à Thomas d’Aquin, Summa theologiae, Ia, q. 58, a. 5, resp. [abrégé : Sum. theol.], où l’Aquinate traite de la connaissance des bons anges qui, dans le domaine des vérités surnaturelles, laissent en quelque sorte leur jugement ouvert à une modification possible de la part de la Providence divine.
[20] Kull, p. 186 : « En publiant ce livre, j’aimerais donner à l’Église, à travers son Magistère, l’occasion de ‟prendre position” au sujet de cette question, en espérant vivement que la conception de l’enfer proposée dans cet ouvrage puisse devenir l’enseignement ‟officiel” de l’Église. »
[21] Dans sa préface, S. E. Mgr André Léonard écrit lui aussi que « rien n’interdit sans doute d’espérer cette apocatastase » (p. 11). Or, si l’apocatastase était possible, l’enfer pourrait ne pas être éternel, ce qui serait contraire à la foi de l’Église (voir par exemple Catéchisme de l’Église catholique, no 1035 [abrégé : CÉC]). Il s’ensuit que l’apocatastase ne saurait faire l’objet d’une espérance.
[22] Y. Kull cite Henri Lassiat, L’actualité de la catéchèse apostolique, Sisteron, Éditions Présence, 1978, p. 298sv.
[23] Irénée de Lyon, Contre les hérésies, Dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur, IV, 20, 7 (trad. Adelin Rousseau, « Sagesses chrétiennes », Paris, Cerf, 2001, p. 474). Il s’agit d’une traduction « revue et rendue définitive » par rapport à celle de la collection « Sources chrétiennes » [abrégé : SC].
[24] Irénée de Lyon, Contre les hérésies, IV, 13, 4 (trad. A. Rousseau, p. 445). Kull, p. 128, cite le texte d’après La liturgie des heures, vol. II, Paris, A.E.L.F., 1980, p. 45 : « L’amitié de Dieu confère à ceux qui y accèdent l’immortalité. » Dans le volume correspondant des notes justificatives de l’édition critique des « Sources chrétiennes », Adelin Rousseau précise sur ce passage : « “l’incorruptibilité”, ἀφθαρσίας : arménien. Le latin a lu ἀθανασίας au lieu de ἀφθαρσίας. La même confusion se rencontre en I, 4, 1, où au grec ἀφθαρσίας correspond le latin “immortalitatis” » (« SC, 100/1 », p. 233 correspondant à « SC, 100/2 », p. 539, n. 1).
[25] Xavier Léon-Dufour, art. « Âme », Vocabulaire de théologie biblique, Paris, Cerf, 71991, col. 42 [abrégé : VTB] (cité par Kull, p. 134).
[26] « Son âme n’est pas de nature divine, elle n’est pas immortelle par nature » (p. 133).
[27] De fait, il évoque la corruptibilité de l’âme dans un texte d’Henri Lassiat (p. 104).
[28] Irénée de Lyon, Contre les hérésies, II, 34, 3 (trad. A. Rousseau, p. 268). Selon Michael Schmaus, Katholische Dogmatik, vol. IV/2, Von den Letzten Dingen, München, Max Hueber, 51959, p. 360, ce texte doit être compris non dans le sens d’une annihilation des damnés, mais comme affirmant seulement leur privation de l’immortalité bienheureuse.
[29] Maurice Zundel, Dieu, le grand malentendu, « Vivre l’Évangile avec Maurice Zundel », Versailles, Saint-Paul, 1997, p. 34 (cité d’après Kull, p. 56) : « Dans l’Ancien Testament […] l’image de Dieu est cette image royale, le plus souvent l’image d’un dominateur, d’un despote absolu, dont la présence fait mourir. »
[30] Joseph Ratzinger, La mort et l’au-delà, Court traité d’espérance chrétienne, trad. Henri Rochais, Paris, Fayard, 21994, p. 266 (original : Eschatologie – Tod und ewiges Leben, « Kleine katholische Dogmatik, 9 », Regensburg, Pustet, 61990, p. 222-223) (cité par Kull, p. 128).
[31] Joseph Ratzinger, « Entre la mort et la résurrection. Réflexions complémentaires sur la question de l’‟état intermédiaire” », dans La mort et l’au-delà…, p. 255-267 [p. 258] (original : Eschatologie…, p. 211-226 [p. 214]).
[32] Benoît XVI, Homélie lors des premières vêpres de l’Avent, 1er décembre 2007.
[33] « Je ne serais donc pas étonné d’apprendre un jour que la revendication par une créature de l’immortalité naturelle et inconditionnelle est l’essence même du ‟satanisme” » (p. 172). On voit poindre, une fois de plus, la confusion entre l’immortalité de l’âme et celle de l’homme.
[34] Pour une présentation d’ensemble de cette thématique, on pourra lire Michael Schmaus, Katholische Dogmatik, vol. IV/2…, p. 335-381.
[35] Cf. Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique, VI, 37.
[36] Cf. Michael Schmaus, Katholische Dogmatik, vol. IV/2…, p. 341-342 ; 356.
[37] Pour Irénée, les passages allégués sont Contre les hérésies, III, 20, 1 ; IV, 38, 3 ; V, 3, 1.
[38] Cf. Michael Schmaus, Katholische Dogmatik, vol. IV/2…, p. 356.
[39] Concile de Latran V, 8e session, 19 décembre 1513, Bulle Apostolici regiminis (Symboles et définitions de la foi catholique, éd. Heinrich Denzinger, Peter Hünermann [et Joseph Hoffmann pour l’édition française], Paris, Cerf, 1997, no 1440 [abrégé : DzH]). Les décrets de ce concile ont été publiés sous la forme de bulles pontificales.
[40] Voir à ce sujet Étienne Gilson, « Autour de Pomponazzi. Problématique de l’immortalité de l’âme en Italie au début du XVIe siècle », Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 28 (1961), p. 163-279. Dans une des thèses signées par Louis Eugène Bautain à la demande de la Sacrée Congrégation des évêques et des religieux, le 26 avril 1844, celui-ci s’engagea à ne plus enseigner « qu’avec la raison seule on ne puisse démontrer la spiritualité et l’immortalité de l’âme » (DzH, no 2766).
[41] Cf. Fromaget, p. 266-267.
[42] Henri Lassiat, L’actualité de la catéchèse apostolique…, p. 8-9 (cité d’après Kull, p. 153).
[43] Pie XI, Lettre encyclique Divini Redemptoris, 19 mars 1937 (DzH, no 3771).
[44] Cf. DzH, no 4400.
[45] Concile Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et spes, no 14, § 2 (DzH, no 4314).
[46] Congrégation pour la doctrine de la foi, Lettre Recentiores episcoporum Synodi, 17 mai 1979, no 3 (DzH, no 4653).
[47] Congrégation pour la doctrine de la foi, Note doctrinale illustrant la formule conclusive de la Professio fidei, 29 juin 1998, no 5. La « doctrine sur l’immortalité de l’âme spirituelle » est mentionnée au no 11 (La documentation catholique 95 [1998], p. 653-657 [p. 654 et 655] [abrégé : DC] ; original : Acta Apostolica Sedis 90 [1998], p. 544-551 [p. 549] [abrégé : AAS]).
[48] Cf. Congrégation pour la doctrine de la foi, Note doctrinale illustrant la formule conclusive de la Professio fidei…, no 5 ; Code de droit canonique, can. 750-751.
[49] Fromaget, p. 142.
[50] Cf. Paul van Imschoot et Fernand Prod’homme, art. « Esprit », Dictionnaire encyclopédique de la Bible, Turnhout, Brepols, 1987, p. 433 [abrégé : DEB].
[51] Cf. Bible de Jérusalem, 181998, note a. sur Mt 16, 25 [abrégé : BJ]. Sauf mention contraire, nous citerons le texte biblique d’après cette traduction.
[52] Xavier Léon-Dufour, art. « Âme », VTB, col. 42.
[53] Michael Schmaus concluait en ce sens : « Die Texte der Heiligen Schrift zeigen also, daß der Schrift der Ganztod unbekannt ist. Ja sie bezeugt, wenn auch nicht ausdrücklich und formell, so doch mit hinreichender Klarheit und Deutlichkeit, das Weiterleben der Seele über den Tod hinaus » (Katholische Dogmatik, vol. IV/2…, p. 355). Selon Flavius Josèphe (Guerre des juifs, II, 165 ; Les Antiquités juives, XVIII, 16), les sadducéens niaient la persistance de l’âme après la mort et, par conséquent, leur rétribution (cf. Jan de Fraine et Christiane Saulnier, art. « Sadducéens », DEB, p. 1152. Voir aussi art. « Âme, immortalité de l’ », Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, Geoffrey Wigoder et Sylvie Anne Goldberg (pour l’adaptation française), dir., Paris, Cerf, 1993, p. 56 ; art. « Sadducéens », ibid., p. 995.
[54] Cf. Martin Ott, art. « Unsterblichkeit, U. der Seele – II. Religionsgeschichtlich », Lexikon für Theologie und Kirche, t. 10 (32006), col. 433 [abrégé : LThK].
[55] Voir notamment Dn 12, 2 ; 2 M 7, 9.11.14.23 ; 12, 43-45.
[56] Paul van Imschoot et Fernand Prod’homme, art. « Esprit », DEB, p. 434.
[57] À partir de cet épisode où le Christ est pris pour un « esprit », saint Augustin élabore tout un discours d’anthropologie christologique dans le Sermon 237 (« SC, 116 », p. 280-293).
[58] Alexander Sand, art. « ψυχή », Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, éd. Horst Balz et Gerhard Schneider, Stuttgart, Kohlhammer, t. 3 (32011), col. 1199-1200 [abrégé : EWNT] : « Im Tod löst sich die Lebenskraft und lebt an einem außerweltlichen Ort weiter (Apg 2, 27 [Zit. Ps 16, 8-11b LXX]; 2, 31 t. r.; Apk 6, 9; 20, 4). […] Es liegt auch keine Identität mit dem physischen Leben zugrunde […]; denn das in der ψυχή ausgedrückte Leben des Menschen findet sein Ende nicht im Tod (Apg 2, 27; vgl. 1Kor 15, 50f). »
[59] Placide Deseille, art. « Âme-cœur-corps – D. Théologie historique », Dictionnaire critique de théologie, Jean-Yves Lacoste, dir., Paris, Presses universitaires de France, 32007, p. 37 [abrégé : DCT].
[60] Sg 8, 19-20 suggère que le judaïsme hellénistique ait fini par admettre « une certaine préexistence de l’âme par rapport au corps » (Traduction œcuménique de la Bible, 112010, note sur Sg 8, 20 [abrégé : TOB]). Voir également Édouard Lipiński, art. « Âme », DEB, p. 42. Au contraire, la BJ commente : « Ce texte n’enseigne pas la préexistence de l’âme, comme on pourrait le croire si on l’isolait du contexte. Il renchérit sur l’expression du v. 19, qui paraissait donner la priorité au corps comme sujet personnel, et souligne la prééminence de l’âme » (note b. sur Sg 8, 20).
[61] Cf. Cándido Pozo, Teología del más allá, Édition actualisée et augmentée, « Biblioteca de Autores Cristianos, 282 », Madrid, 42001, p. 191.
[62] Cf. Sg 1, 15 ; 2, 23 ; 3, 1-8 ; 4, 1-2.7-17 ; 6, 18-21 ; 15, 3.
[63] BJ, note e. sur Sg 1, 15. On remarquera en ce sens le cas d’Hénok, enlevé au ciel sans connaître la mort, et dont Gn 5, 24 souligne la justice.
[64] Werner Bieder, art. « θάνατος – 6. ἀθανασία », EWNT, t. 2 (32011), col. 328 : « Wenn das Sterbliche Unsterblichkeit anzuziehen hat (1Kor 15, 53.54), ist es Paulus klar, daß Unsterblichkeit nichts dem Menschen oder seiner Seele Inhärentes ist. »
[65] Claude Tresmontant, art. « Immortalité – I. Étude philosophique », Encyclopédie de la foi, éd. Heinrich Fries, Paris, Cerf, t. 2 (1965), p. 298 ; cf. p. 297 ; 299 [abrégé : EncFoi] (original : art. « Unsterblichkeit – I. Philosophisch », Handbuch theologischer Grundbegriffe, éd. H. Fries, München, Kösel, t. 2 [1963], p. 731 ; cf. p. 730 ; 732 [abrégé : HThG]. Les textes allemand et français de cet article – probablement rédigé d’abord en français – diffèrent en partie.
[66] Cf. Fromaget, p. 201.
[67] Pour le moins, la continuation dans l’existence de ceux qui ont refusé la Bonne Nouvelle n’est « pas exclue » (P. Hoffmann, art. « Immortalité – II. Étude biblique », EncFoi, t. 2 [1965], p. 310 [original : art. « Unsterblichkeit – II. Biblisch », HThG, t. 2 (1963), p. 739]). Renvoyant à l’usage de saint Thomas qui parlait de l’incorruptibilité (incorruptibilitas), plutôt que de l’immortalité de l’âme, Josef Pieper préconise de réserver le terme d’immortalité à l’homme (sauvé) tout entier, corps et âme (cf. Tod und Unsterblichkeit, éd. Berthold Wald, « Topos Taschenbücher, 793 », Kevelaer, Butzon & Bercker, 2012, p. 41 ; 126-127).
[68] P. Hoffmann, art. « Immortalité – II. Étude biblique », EncFoi, t. 2 (1965), p. 304 (original : art. « Unsterblichkeit – II. Biblisch », HThG, t. 2 [1963], p. 733).
[69] Voir ainsi la fin de la seconde prière eucharistique : « Omnium nostrum, quæsumus, miserere, ut […] æternæ vitæ mereamur esse consortes » (Missale Romanum [32002]).
[70] L’immortalité de l’âme est affirmée dans À Diognète, 6, 8, tandis que À Diognète, 10, 7 évoque le châtiment éternel.
[71] Pacien de Barcelone, Sur le baptême, 7, 2 (« SC, 410 », p. 161 ; 163).
[72] Théophile d’Antioche, Livres à Autolykos, 2, 27 (PÉC, p. 742).
[73] Théophile d’Antioche, Livres à Autolykos, 1, 14 (PÉC, p. 716-717).
[74] Fromaget, p. 156.
[75] À Diognète, 10, 7 (PÉC, p. 819).
[76] Théophile d’Antioche, Livres à Autolykos, 1, 7 (PÉC, p. 711).
[77] Heino Sonnemans, art. « Unsterblichkeit, U. der Seele – III. Systematisch-theologisch », LThK, t. 10 (32006), col. 434 : « Unsterblichkeit im Sinn von Unsterblichkeit der Seele ist keine Heilskategorie, sondern fungiert als Kontinuum zwischen geschichtlicher Existenz und Auferstehungsleben. »
[78] P. Hoffmann, art. « Immortalité – II. Étude biblique », EncFoi, t. 2 (1965), p. 310 (original : art. « Unsterblichkeit – II. Biblisch », HThG, t. 2 [1963], p. 739).
[79] Pour le caractère authentiquement chrétien de la doctrine de l’immortalité de l’âme (dans l’état intermédiaire), voir Joseph Ratzinger, La mort et l’au-delà…, p. 111-167 (original : Eschatologie…, p. 91-135), ainsi que les « réflexions complémentaires », p. 255-267 (original : p. 211-226) et la postface, p. 269-283 (original : p. 194-210). Pour Ratzinger, la thèse de la contamination de la culture biblique par la philosophie grecque est une reconstruction fictive : du point de vue historique, on ne peut opposer de manière statique culture grecque et culture biblique.
[80] Pour un témoignage particulièrement explicite de ce scepticisme privé d’espérance, voir Sg 2, 1-5 (note de C. J. Kruijen).
[81] Gisbert Greshake, art. « Seele – V. Theologie- und dogmengeschichtlich », LThK, t. 9 (32006), col. 375 : « Gegen die vom 1. vorchristlichen bis zum 3. nachchristlichen Jahrhundert in der heidnischen Welt herrschende Jenseitsskepsis und Hoffnungslosigkeit verbündete sich die christliche Theologie mit der platonischen Philosophie und ihren Argumenten für eine Unsterblichkeit der Seele. Es ging dabei nicht um eine Hellenisierung des Glaubens, sondern darum, „überhaupt eine Position zu schaffen, von der aus die Auferstehungslehre vorgetragen werden konnte“ (A. Stuiber, Refrigerium interim, Bonn, 1957, p. 101). »
[82] Claude Tresmontant, art. « Immortalité – I. Étude philosophique », EncFoi, t. 2 (1965), p. 297 (original : art. « Unsterblichkeit – I. Philosophisch », HThG, t. 2 [1963], p. 730). Même raisonnement chez Kull, p. 133 : « Son âme [celle de l’homme] n’est pas de nature divine, elle n’est pas immortelle par nature. »
[83] Affirmant que l’âme n’est pas simple, puisque composée de son essence et de son existence, Y. Kull en déduit qu’elle peut « perdre l’existence » (p. 194 ; cf. p. 207). Certes, sur le plan métaphysique, il n’y a identité de l’essence et de l’existence (l’acte d’être ou esse) que dans le cas de l’être incréé de Dieu, qui est « ipsum esse per se subsistens » (Thomas d’Aquin, Sum. theol., Ia, q. 4, a. 2, resp. ; cf. Ia, q. 3, a. 4). Cette vérité ne contredit cependant pas le fait que l’âme soit simple selon sa nature spirituelle ; elle n’implique pas davantage que l’âme soit corruptible, mais seulement qu’elle n’est pas nécessaire sur le plan de l’être, ayant besoin, comme « être par participation », d’être « causé[e] par ce qui est par essence » (ibid., q. 61, a. 1, resp.). En règle générale, le texte français de la Somme de théologie sera cité d’après Somme théologique, 4 vol., Paris, Cerf, 1997-2000.
[84] Pour les âmes, voir Pie XII, Lettre encyclique Humani generis, 12 août 1950 (AAS 42 [1950], p. 561-578 [p. 575] ; DzH, no 3896) ; CÉC, nos 33 ; 366 ; Thomas d’Aquin, Compendium theologiae, I, chap. 93 [abrégé : Comp. theol.]. L’âme n’est pas une substance divine : voir Léon le Grand, Lettre Quam laudabiliter à l’évêque Turribius d’Astorga, 21 juillet 447, chap. 5 (DzH, no 285).
[85] Versus Fromaget, p. 172, où l’auteur parle d’âme « auto-existante », « auto-suffisante », qui « n’a plus besoin de Dieu pour vivre » dès lors qu’elle existe.
[86] Thomas d’Aquin, Sum. theol., Ia, q. 75, a. 2, resp. (voir aussi s. c.) : « L’âme humaine, c’est-à-dire l’intelligence, l’esprit, est une réalité incorporelle et subsistante. » Si l’âme est subsistante – elle est par elle-même un « sujet » qui existe ; elle n’est pas seulement « spirituelle », mais elle est un « esprit » (Marie-Joseph Nicolas, note ad locum dans Thomas d’Aquin, Somme théologique, vol. I, Paris, Cerf, 1999, p. 654, n. 2) –, elle n’est pas cependant une substance complète sans le corps (cf. ibid., p. 651, n. 1 ; p. 655, n. 4 ; p. 657, n. 7).
[87] Par contraste, l’âme sensitive des animaux n’étant pas subsistante (cf. Thomas d’Aquin, Sum. theol., Ia, q. 75, a. 3), elle est détruite en même temps que le composé à laquelle elle appartient (cf. ibid., Ia, q. 75, a. 6, resp. ; Id., Somme contre les gentils, II, 82).
[88] Concile de Vienne, 3e session, 6 mai 1312, Constitution Fidei catholicae (DzH, no 902).
[89] Thomas d’Aquin, Sum. theol., Ia, q. 75, a. 6, resp. Dans ce même texte, il est remarquable que saint Thomas avance, comme signe (signum) de l’incorruptibilité de l’âme humaine, le désir naturel d’être toujours, que possède tout être doté d’intelligence. Il est encore remarquable que l’incorruptibilité des anges et des âmes intellectuelles soit déduite du fait même qu’ils possèdent une nature qui les rend capables de la vérité (cf. ibid., Ia, q. 61, a. 2, ad 3). Pour saisir l’argumentation du Docteur commun en faveur de cette incorruptibilité, on se reportera aussi à ses Quaestiones disputatae de anima, q. 14. Au vu des démonstrations rigoureuses fournies par l’Aquinate, on ne saurait considérer que l’immortalité de l’âme ne peut être démontrée par la raison, comme le fait Claude Tresmontant, art. « Immortalité – I. Étude philosophique », EncFoi, t. 2 (1965), p. 301-302 (ces pages manquent dans le texte allemand de l’article).
[90] Thomas d’Aquin, Comp. theol., I, chap. 93 (trad. Jean-Pierre Torrell, Paris, Cerf, 2007, p. 213).
[91] Thomas d’Aquin, Comp. theol., I, chap. 74 (trad. J.-P. Torrell, p. 167 ; 169).
[92] Cf. Thomas d’Aquin, Comp. theol., I, chap. 96 ; Id., Sum. theol., Ia, q. 19, a. 3.
[93] Cf. Thomas d’Aquin, Sum. theol., Ia, q. 104, a. 3.
[94] Jean-Pierre Torrell, dans Thomas d’Aquin, Abrégé de théologie (Compendium theologiae) ou Bref résumé de théologie pour le frère Raynald, Paris, Cerf, 2007, p. 168, n. 118.
[95] Thomas d’Aquin, Sum. theol., Ia, q. 50, a. 5, ad 3.
[96] Nous remercions le Père Serge-Thomas Bonino, o.p., pour son éclairage métaphysique de la question, repris dans ce paragraphe.
[97] Cf. Kull, p. 89 ; Fromaget, p. 73.
[98] Cf. Thomas d’Aquin, Sum. theol., Ia, q. 1, a. 8, ad 2.
[99] Cf. Thomas d’Aquin, Sum. theol., Ia, q. 1, a. 9, resp.
[100] Cf. Claude Tresmontant, art. « Immortalité – I. Étude philosophique », EncFoi, t. 2 (1965), p. 302. Ce passage manque dans le texte allemand de l’article.
[101] Claude Tresmontant, art. « Unsterblichkeit – I. Philosophisch », HThG, t. 2 (1963), p. 732 : « Seine [die des Menschen] Unsterblichkeit ist zwar Geschenk, aber ein in der Schöpfung vorbereitetes Geschenk, für das infolgedessen philosophisch erkennbare Spuren am konkret existierenden Menschen vorhanden sein müssen. » Ce passage n’est pas explicitement présent dans le texte français de l’article.
[102] Cf. Fromaget, p. 14 ; 52 ; 77 ; 207 ; 261.
[103] Fromaget, p. 77.
[104] Fromaget, p. 71 ; cf. p. 73.
[105] Cf. Kull, p. 172-173.
[106] Cf. Josef Pieper, Tod und Unsterblichkeit…, p. 140.
[107] Sur le plan de la lex orandi, on peut renvoyer ici, par exemple, à l’oraison de postcommunion de la messe du jour de Noël : « Præsta, misericors Deus, ut natus hodie Salvator mundi, sicut divinæ nobis generatonis est auctor, ita et immortalitatis sit ipse largitor » (Missale Romanum [32002 ; de même dans l’édition de 1962]). Ailleurs, l’Église prie Dieu « ut, qui sacramento baptismatis sunt renati, beata facias immortalitate vestiri » (ibid., collecte du samedi de l’octave de Pâques). Dans la préface de l’épiphanie, l’Église prie « cum in substantia nostræ mortalitatis apparuit [Christus], nova nos immortalitatis eius gloria reparasti » (ibid.). Voir encore la prière de vêture, lorsque le prêtre revêt l’étole dans la liturgie latine : « Redde mihi, Domine, stolam immortalitatis, quam perdidi in prævaricatione primi parentis. » Il est clair que cette dernière prière, en réalité, ne vise pas tant l’immortalité préternaturelle adamique que l’immortalité bienheureuse des élus.
[108] Ainsi Jean-Paul II, Lettre encyclique Sollicitudo rei socialis, 30 décembre 1987, no 29 (DzH, no 4812).
[109] Ignace d’Antioche, Lettre à Polycarpe, 2, 3 (PÉC, p. 218).
[110] Cf. Kull, p. 208.
[111] Kull, p. 193.
[112] Dans le contexte actuel, on pense notamment aux idées avancées par les études de genre.
[113] Cf. Leo Scheffczyk, art. « Prädetermination », LThK, t. 8 (32006), col. 475-476. Voir aussi les développements infra, p. 38.
[114] Cf. André Lalande, art. « Anéantissement », Vocabulaire technique et critique de la philosophie, « Quadrige, 133-134 », Paris, Presses universitaires de France, 2002, p. 57. En ce sens, on comprend que Jean-Marc Bot parle de « l’enfer ontologique » pour désigner la thèse de l’annihilation (cf. Osons reparler de l’enfer, Paris, Éditions de l’Emmanuel, 2002, p. 95-98).
[115] Cf. Josef Finkenzeller, art. « Annihilation », LThK, t. 1 (32006), col. 697.
[116] Cf. Klaudius Jüssen, art. « Annihilierung », LThK, t. 1 (21957), col. 576.
[117] Klaudius Jüssen, art. « Annihilierung », LThK, t. 1 (21957), col. 576 : « […] anderseits läßt sich kein positives Wirken denken, dessen Terminus unmittelbar das Nichtsein wäre. »
[118] Au sujet du lien entre conditionalisme, « mort totale » ou thnétopsychisme et négation de la damnation, Michael Schmaus écrit : « Die verdammungswürdigen Verstorbenen verfallen nach dieser Lehre [des Thnetopsychitismus] im Jenseits in irgend einem Zeitpunkte nach der Auferweckung des Fleisches dem totalen, nicht mehr aufhebbaren Tode, und zwar im Hinblick auf ihre Verdammenswürdigkeit » (Katholische Dogmatik, vol. IV/2…, p. 341).
[119] Cf. Kull, p. 22.
[120] Cf. Fromaget, p. 99 ; 104.
[121] Cf. Thomas d’Aquin, Sum. theol., Ia, q. 50, a. 5, resp.
[122] Pour un aperçu à ce sujet, voir Joseph Chaine, art. « Géhenne », Dictionnaire de la Bible. Supplément, t. 3 (1938), col. 577-579. Selon cet auteur, la plupart des docteurs n’admettaient pas la résurrection des impies (cf. ibid., col. 579). Cette opinion ne semble cependant s’être répandue qu’à partir du début du IIe siècle sous l’effet de l’idée d’un anéantissement complet des impies (cf. Hermann L. Strack, Paul Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, vol. IV/2, Exkurse zu einzelnen Stellen des Neuen Testaments, München, Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 21956, p. 1173 [abrégé : Strack-Billerbeck]). Sur la question de l’étendue de la résurrection dans les pseudépigraphes et la littérature rabbinique, voir plus largement ibid., p. 1166-1198. Les groupes de ceux qui n’ont pas part à la résurrection sont mentionnés dans ibid., p. 1183-1192.
[123] Art. « Vie éternelle », Dictionnaire encyclopédique du judaïsme…, p. 1162.
[124] Cf. Strack-Billerbeck, vol. IV/2, p. 1033 ; 1103 ; 1173.
[125] Cf. Friedrich Lang, art. « σκώληξ, σκωληκόβρωτος », Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, éd. Gerhard Kittel et Gerhard Friedrich, Stuttgart, Kohlhammer, t. 7 (1964), p. 455 [abrégé : ThWNT]. Au sujet de cette indécision dans le judaïsme intertestamentaire, voir aussi art. « Enfer », Dictionnaire Jésus, Renaud Silly, dir., L’École biblique et archéologique française de Jérusalem, Paris, Robert Laffont (pour les Éditions Bouquins), 2021, p. 297-298.
[126] Voir à ce propos Simon Légasse, « Saint Paul croyait-il à l’enfer ? », Bulletin de littérature ecclésiastique 98 (1997), p. 181-184.
[127] Simon Légasse, « Le jugement dernier chez Paul », dans Le jugement dans l’un et l’autre Testament, vol. II, Mélanges J. Schlosser, Textes réunis par C. Coulot, « Lectio divina, 198 », Paris, Cerf, 2004, p. 255-263 [p. 261].
[128] Cf. Joseph Pohle et Josef Gummersbach, Lehrbuch der Dogmatik, vol. III, Paderborn, Ferdinand Schöningh, 91960, p. 669 ; Claudio Gianotto, art. « Valentin », Dictionnaire encyclopédique du christianisme ancien, vol. II, Sous la direction de A. Di Berardino, Paris, Cerf, 1990, p. 2508 [abrégé : DECA] ; Cándido Pozo, Teología del más allá…, p. 361 ; 444-445.
[129] Voir à ce sujet supra, p. 5 et n. 12.
[130] La punition éternelle des impies dans leurs âmes est fréquemment affirmée, en se fondant notamment sur l’immortalité de l’âme : « Même si vous évitez le châtiment par la dissolution de votre corps, comment pourrez-vous par la corruption échapper à votre propre âme, qui est incorruptible ? Car même l’âme des impies est immortelle, alors qu’il vaudrait mieux pour eux qu’elle ne fût pas incorruptible. Punie par le feu inextinguible dans un châtiment sans fin et ne mourant pas, elle ne peut trouver de fin pour son propre malheur » (Roman pseudo-clémentin, Homélies, 11, 11, 1-2 [Écrits apocryphes chrétiens, vol. II, Pierre Geoltrain et Jean-Daniel Kaestli, dir., « Bibliothèque de la Pléiade, 516 », Paris, Gallimard, 2005, p. 1426-1427] [abrégé : ÉAC] ; texte parallèle dans Roman pseudo-clémentin, Reconnaissances, V, 28, 1-2 [ÉAC, vol. II, p. 1834-1835]). Voir dans le même sens Homélies, 1, 7, 6.8 ; 3, 37, 4 ; 4, 14, 2 ; 11, 16, 6 ; 15, 1, 5 ; 15, 11, 1 ; 16, 2, 1 ; 19, 19, 2-3 ; 20, 9, 5 ; Reconnaissances, IX, 13, 5-6. L’immortalité de l’âme, le jugement et la rétribution (dans l’Hadès ou « le sein des justes ») après la mort sont affirmés notamment dans Homélies, 2, 13, 3-4 ; 3, 28, 2. On notera aussi les doctrines singulières suivantes : le Mauvais n’est pas éternel (cf. ibid., 19, 17) ; il peut devenir bon (cf. ibid., 20, 3, 9) et se transformer après un châtiment apparent, « pour être avec les bons » (cf. ibid., 20, 9, ici 20, 9, 6). La rédaction des Homélies est datée du début du IVe siècle (avant 325), mais l’« Écrit de base » dont elles dépendraient serait à situer en Syrie et pourrait remonter à la première moitié du IIIe siècle (après 222).
[131] Roman pseudo-clémentin, Homélies, 7, 7, 7 (ÉAC, vol. II, p. 1371).
[132] Roman pseudo-clémentin, Homélies, 3, 6, 4-5 (ÉAC, vol. II, p. 1281).
[133] Arnobe, Contre les gentils, II, 14, 4 (trad. Mireille Armisen-Marchetti, « CUF, Série latine, 419 », Paris, Les Belles Lettres, 2018, p. 15). Voir ibid., 31, 1 ; 35, 1.3 ; 36, 4 ; 53, 1. Dieu seul est immortel et éternel, et lui seul peut communiquer le salut et l’immortalité aux âmes (cf. ibid., 62, 3 ; 72, 3), immortalité qui doit être reçue comme un don des mains du Christ (cf. ibid., 36, 1 ; 53, 1 ; 66, 1). Arnobe avance pour cela deux arguments : d’une part, si les âmes étaient incorruptibles et simples, elles ne pourraient pas souffrir (cf. ibid., 14, 2-3 ; 30, 1-2) ; d’autre part (indirectement), tout ce qui a débuté possède aussi une fin (cf. ibid., 35, 3-5).
[134] Arnobe, Contre les gentils, II, 14, 4-5 (trad. M. Armisen-Marchetti, p. 15-16). La ‟damnation” de ceux qui n’ont pas voulu connaître Dieu est en ce sens une mort cruelle, une extinction progressive et prolongée dans un atroce châtiment (cf. ibid., 61, 3). Sur la possibilité d’un anéantissement irrémédiable et total de l’âme, voir aussi ibid., 36, 1.
[135] Cf. Brian E. Daley, The Hope of the Early Church…, p. 172 ; 256, n. 9, renvoyant à Narsai, Homélies, 18 ; 34 et surtout 44.
[136] Cf. Brian E. Daley, The Hope of the Early Church…, p. 176.
[137] On notera la place extrêmement marginale que tient la thèse de l’annihilation dans l’étude fouillée de Brian E. Daley sur l’eschatologie patristique. De manière significative, le conditionalisme ne fait pas partie des cinq points de désaccord qu’il mentionne pour cette eschatologie (cf. The Hope of the Early Church…, p. 221-223). Daley conclut : « Early Christian writers almost universally assumed that the final state of human existence, after God’s judgment, will be permanent and perfect happiness for the good, and permanent, all-consuming misery for the wicked » (ibid., p. 220-221).
[138] Cf. Bernhard Lang, art. « Hölle – IV. Kirchengeschichtlich », Religion in Geschichte und Gegenwart, éd. Hans Dieter Betz et al., Tübingen, Mohr Siebeck, t. 3 (42000), col. 1849.
[139] On trouvera quelques noms dans Marcel Richard, art. « Enfer », Dictionnaire de théologie catholique, t. 5/1 (1939), col. 28-120 [col. 85-86] [abrégé : DTC] ; Josef Loosen, art. « Apokatastasis – II. Dogmatisch-dogmengeschichtlich », LThK, t. 1 (21957), col. 710.
[140] « Les adventistes enseignent que l’âme n’est pas immortelle. L’état des morts est un ‟sommeil” dans le sens que ‟la première mort” est un état d’inconscience mais non définitif. Tous les êtres humains ressusciteront, soit pour obtenir la vie éternelle, soit pour faire face au jugement dernier. Au retour du Christ, les sauvés vivants et ressuscités iront au ciel mais les perdus périront. Pendant mille ans, les sauvés examineront les livres consignant la vie des perdus. […] Après les mille ans, les perdus ressusciteront pour le jugement dernier. Ils apprendront et recevront la sentence de ‟la seconde mort” : la mort définitive et éternelle – l’annihilationisme. La destruction de Satan et du mal seront aussi définitives. La terre sera recréée à son état original de perfection » (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_adventiste_du_septi%C3%A8me_jour#Doctrine_des_choses_derni%C3%A8res_(croyances_fondamentales_24-28) (page consultée le 7 mai 2020).
[141] Ainsi, selon Marcel Richard, art. « Enfer », DTC, t. 5/1 (1939), col. 86, les « Evangelical Adventists » admettaient l’enfer éternel.
[142] Cf. Cándido Pozo, Teología del más allá…, p. 446. Selon Marcel Richard, art. « Enfer », DTC, t. 5/1 (1939), col. 86, la « Life and Advent Union » défendait un sommeil sans fin pour les impies.
[143] Cf. Cándido Pozo, Teología del más allá…, p. 446.
[144] Pour John Stott, voir David L. Edwards et John Stott, Evangelical Essentials, A Liberal Evangelical Dialogue, Downers Grove, IL, InterVarsity Press, 1988, p. 312-320. Voir encore Harold E. Guillebaud (The Righteous Judge, 1941), Basil Atkinson (Life and Immortality, 1960), Leroy Edwin Froom (The conditionality faith of our Fathers, 1965), Edward W. Fudge (The fire that consumes, A Biblical and Historical Study of the Doctrine of Final Punishment, 1982), John Wenham (The case for conditional immortality, 1992) et Clark Pinnock (The destruction of the finally impenitent, 1990 ; Four views on hell, 1992) (références données d’après https://www.leboncombat.fr/annihi_1/ [page consultée le 7 mai 2020]).
Pour un traitement plus détaillé du conditionalisme, en particulier parmi les Evangelicals britanniques, voir Michael J. McClymond, The Devil’s Redemption, A New History and Interpretation of Christian Universalism, vol. I, Grand Rapids, MI, Baker Academic, 2018, p. 108-123. L’auteur cite (p. 109) un document officiel de l’Église d’Angleterre allant nettement dans le sens du conditionalisme : « Hell is not eternal torment, but it is the final and irrevocable choosing of that which is opposed to God so completely and so absolutely that the only end is total non-being » (The Mystery of Salvation: The Story of God’s Gift, A Report by the Doctrine Commission of the General Synod of the Church of England, London, Church House, 1995).
[145] Marcel Richard, art. « Enfer », DTC, t. 5/1 (1939), col. 86.
[146] Voir ainsi le bref passage dans Josef Finkenzeller, « Eschatologie »…, p. 652. Parmi les sept ouvrages recensés par Matthias Remenyi, « Unaufgeregt innovativ. Aktuelle Beiträge zur Eschatologie », Theologische Revue 107 (2011), p. 179-198, aucun ne défend apparemment le conditionalisme. En 1975, Augustin Schmied, lui-même favorable à la théorie conditionaliste, signalait que des théologiens catholiques avaient repris récemment cette position, mais il ne mentionne que deux noms (cf. « Ewige Strafe oder endgültiges Zunichtewerden? Neuere Überlegungen zum Thema “Hölle” », Theologie der Gegenwart 18 [1975], p. 178-183 [p. 178-179]).
Signalons ici au passage que le célèbre journaliste et homme politique italien Eugenio Scalfari a attribué de manière répétée la thèse annihilationiste au pape François, avec lequel il a eu plusieurs entretiens. Voir notamment Eugenio Scalfari, « Quel che Francesco può dire all’Europa dei non credenti », La Repubblica, 14 mars 2015 : « Che cosa accade a quell’anima spenta? Sarà punita? E come? La risposta di Francesco è netta e chiara: non c’è punizione ma l’annullamento di quell’anima. Tutte le altre partecipano alla beatitudine di vivere in presenza del Padre. Le anime annullate non fanno parte di quel convito, con la morte del corpo il loro percorso è finito. » Des affirmations similaires ont été publiées par E. Scalfari dans La Repubblica le 21 septembre 2014, le 9 octobre 2017 et le jeudi saint 29 mars 2018.
[147] Selon Arnobe, nul ne peut savoir, et les chrétiens ignorent pareillement, qui a créé l’âme et l’homme (cf. Contre les gentils, II, 7, 3 ; 47, 1-2 ; 48, 1 ; 58, 1). Ailleurs, il affirme que (le) Dieu (suprême) n’est pas à l’origine des âmes (cf. ibid., 36, 5–37, 1 ; 45, 1 ; 47, 2 ; 48, 1-3), de même qu’il n’a pas créé des êtres si inutiles que les mouches, les punaises ou les mulots (cf. ibid., 47, 2-3), ce qui n’empêche d’ailleurs pas Arnobe de professer que rien n’existerait sans le Dieu souverain, source et origine des choses (cf. ibid., 2, 3 ; 72, 3). Ailleurs encore, il est dit que le Christ a révélé (!) que les âmes tirent leur origine d’une divinité de second rang (cf. ibid., 36, 5), encore que cette affirmation déconcertante semble contredite dans ibid., I, 29, 4-5. Il s’ensuit qu’Arnobe admet parfois l’existence de divinités inférieures (dii minores) devant leur immortalité au Dieu suprême (cf. ibid., II, 62, 4 et peut-être 3, 2 ; 36, 1). Ajoutons que Dieu est compris par Arnobe comme absolument transcendant et sans contact avec les créatures (cf. Paolo Siniscalco, art. « Arnobe de Sicca », DECA, t. 1 [1990], p. 255). Sur cet auteur énigmatique qui s’efforça « de concilier des éléments païens – religieux et philosophiques – avec des éléments chrétiens – orthodoxes et hétérodoxes » (ibid., p. 256), on s’accordera sur le fait qu’il connaissait mal les Écritures et plus encore la doctrine chrétienne orthodoxe (cf. Arnobe, Contre les gentils [Contre les païens], trad. M. Armisen-Marchetti…, p. xx ; 176).
[148] Sur les positions parfois radicales de Tatien (tendances gnostiques, marcionisme, encratisme, etc.), voir Franco Bolgiani, art. « Tatien », DECA, t. 2 (1990), p. 2378-2380.
[149] Cf. Fromaget, p. 148 ; 167 ; 249.
[150] Emil Brunner, La doctrine chrétienne de Dieu, Dogmatique, vol. I, trad. Frédéric Jaccard, Genève, Labor et Fides, 1964, p. 371 ; 375 (original : Die christliche Lehre von Gott, Dogmatik, vol. I, Zürich, Zwingli Verlag, 21953, p. 376 ; 380) : « der wirklich nicht gerade illustren Ahnenreihe der Apokatastasislehrer ». « Diese Ahnentafel muss zu denken geben. »
[151] Fromaget, p. 123.
[152] Cf. Joachim Jeremias, art. « γέεννα », ThWNT, t. 1 (1933), p. 655 ; Otto Böcher, art. « γέεννα », EWNT, t. 1 (32011), col. 575-576. Pour l’identification de « Celui qui peut perdre dans la géhenne à la fois l’âme et le corps » (Mt 10, 28 ; cf. Lc 12, 5) avec Dieu, voir Christophe J. Kruijen, Peut-on espérer un salut universel ?, Étude critique d’une opinion théologique contemporaine concernant la damnation, Paris, Parole et Silence, 2017, p. 292, n. 139.
[153] Art. « Enfer », Dictionnaire Jésus…, p. 300.
[154] Versus Fromaget, p. 76.
[155] Strack-Billerbeck, vol. IV/2, p. 1101 : « Wo man die Strafe der ewig Verdammten mit einem kurzen Ausdruck bezeichnen wollte, hat man sie den ‟zweiten Tod” genannt. »
[156] Ugo Vanni, L’Apocalisse, Ermeneutica, esegesi, teologia, Bologna, Edizioni Dehoniane, 1991, p. 275 : « L’immagine dello “stagno del fuoco che brucia nello zolfo” indica una situazione definitiva e circoscritta (lo stagno) nella quale si attua continuamente una distruzione (fuoco) che rende la vita impossibile (zolfo). […] I protagonisti del male non vengono annientati: […] questa situazione costituisce un tormento che si situa nel tempo trascendente dei “secoli dei secoli”. […] C’è – ma senza nessuna precisazione descrittiva o coloristica – l’idea di una punizione permanente. »
[157] TOB, note sur Is 66, 24 : « Vermine et feu : signes d’un tourment sans répit ; voir Si 7, 17 ; Jdt 16, 17 ; Mc 9, 48. » BJ, note a. sur Is 66, 24 : « Au culte perpétuel que rendront les adorateurs de Yahvé, vv. 22-23, est opposé le châtiment sans fin qui frappera ses ennemis, v. 24. »
[158] Friedrich Lang, art. « σκώληξ, σκωληκόβρωτος », ThWNT, t. 7 (1964), p. 454 : « Der nicht sterbende Wurm beschreibt einen nie endenden Verwesungsprozeß des Leibes, den die Seele des Toten als Schmerz empfindet (vgl Js 50, 11 […]); er ist also Zeichen der ewigen, mit Pein verbundenen Verdammnis. […] Jedenfalls hat später die Apokalyptik die Wendung im Sinn der ewigen Pein verstanden. »
[159] Cf. Fromaget, p. 114-123. L’auteur (p. 119-120) se réfère, entre autres, à Jean Elluin, Quel enfer ?, Paris, Cerf, 1994.
[160] Cf. Ilaria Ramelli, The Christian Doctrine of Apokatastasis, A Critical Assessment from the New Testament to Eriugena, « Supplements to Vigiliae Christianae, 120 », Leiden, Brill, 2013, p. 26-33. Pour notre critique, voir Christophe J. Kruijen, Peut-on espérer un salut universel ?…, p. 318-320, n. 243.
[161] Cf. Horst Balz, art. « αἰώνιος », EWNT, t. 1 (32011), col. 112.
[162] Horst Balz, art. « αἰώνιος », EWNT, t. 1 (32011), col. 113 : « Bei dieser negativen Akzentuierung schlägt noch stärker als schon bei der positiven die Bedeutung unaufhörlich, immerwährend durch. » Tandis que l’adjectif aiônios comprend la pleine notion d’éternité divine dans les expressions « vie éternelle » (Mt 25, 46), « Royaume éternel » (2 P 1, 11), « héritage éternel » (He 9, 15), etc., « bedeutet es [αἰώνιος] in τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον Mt 18, 8; 25, 41; Jd 7 (vgl 4 Makk 12, 12), κόλασις αἰώνιος Mt 25, 46; ὄλεθρος αἰώνιος 2 Th 1, 9; αἰώνιον ἁμάρτημα Mk 3, 29 (ewig unvergebbare Sünde) zunächst nur niemals aufhörend, endlos » (Hermann Sasse, art. « αἰών, αἰώνιος », ThWNT, t. 1 [1933], p. 209).
[163] Sur ces expressions hyperboliques, voir Hermann Sasse, art. « αἰών, αἰώνιος », ThWNT, t. 1 (1933), p. 199 ; Traugott Holtz, art. « αἰών », EWNT, t. 1 (32011), col. 108.
[164] Cf. art. « αἰώνιος », A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature, éd. Frederick William Danker, Chicago-London, The University of Chicago Press, 32000, p. 33.
[165] Voir supra, p. 27.
[166] Cf. Fromaget, p. 95-96.
[167] Fromaget, p. 113 ; cf. p. 152.
[168] Cf. Fromaget, p. 113-114 ; 120 ; 122 ; 156.
[169] Fromaget, p. 123.
[170] Cf. Fromaget, p. 114 ; Kull, p. 146-147.
[171] On songe au lien entre la notion du feu et celle de la colère de Dieu, par exemple en Jr 17, 4 (cf. 15, 14) : « Le feu de ma colère que vous avez allumé brûlera pour toujours. »
[172] Voir, par exemple, Albert Michel, art. « Feu de l’enfer », DTC, t. 5/2 (1939), col. 2202 ; 2223-2224 ; Ludwig Ott, Précis de théologie dogmatique, trad. Marcel Grandclaudon, Mulhouse, Salvator, 31955, p. 660 (original : Grundriß der katholischen Dogmatik, Édition mise à jour, Bonn, Nova & Vetera, 112005, p. 650) ; Matthias Premm, Katholische Glaubenskunde, Ein Lehrbuch der Dogmatik, vol. IV, Gnade, Tugenden, Vollendung, Wien, Herder, 21958, p. 645 ; Cándido Pozo, Teología del más allá…, p. 458-459. À ce sujet, voir encore Thomas d’Aquin, Sum. theol., Suppl., q. 97, a. 5.
[173] Joseph Ratzinger, art. « Hölle – V. Systematik », LThK, t. 5 (21960), col. 449 : « Insofern würde eine bloß psychologische Auslegung des „Feuers“ dem Sachverhalt sicher nicht gerecht; dieses deutet die bewußtseinsäußere, kosmisch-objektive Komponente der endgültigen Selbstverfehlung des Menschen an. »
[174] Cf. 1 Co 3, 17 ; Ga 6, 8.
[175] Cf. Rm 6, 21 ; 8, 6.13 ; 2 Co 2, 16 ; 7, 10.
[176] Cf. Rm 2, 12 ; 9, 22 ; Ph 1, 28 ; 3, 19. Jean-Noël Aletti fait remarquer que, chez Paul, « l’usage du substantif apôleia […] a une connotation eschatologique – perdition, plutôt que destruction physique ou corporelle » (Saint Paul. Épître aux Philippiens, Introduction, traduction et commentaire de Jean-Noël Aletti, S.J., « Études bibliques. Nouvelle série, 55 », Paris, Gabalda, 2005, p. 110).
[177] Cf. 1 Co 1, 18 ; 2 Co 2, 15 ; 4, 3 ; 2 Th 2, 10.
[178] Cf. 1 Th 5, 3 ; 2 Th 1, 9 ; 1 Tm 6, 9.
[179] Sont concernés les « princes de ce monde », hommes et / ou démons (1 Co 2, 6), les puissances spirituelles mauvaises et la mort (1 Co 15, 24.26), ainsi que « l’homme impie », c’est-à-dire le fils de la perdition (2 Th 2, 3.8). Selon Paul Beauchamp, katargein « est plus proche d’un anéantissement des esprits du mal que de leur punition » (art. « Enfer – A. Théologie biblique », DCT, p. 468).
[180] Cf. Karl Rahner, art. « Hölle », dans Id., Sämtliche Werke, éd. Karl-Rahner-Stiftung, vol. XVII/2, Freiburg i. Br., Herder, 2002, p. 1088 (= Sacramentum mundi, Theologisches Lexikon für die Praxis, éd. Karl Rahner et Adolf Darlap, Freiburg i. Br., Herder, t. 2 [1968], col. 735).
[181] Josef Finkenzeller, « Eschatologie »…, p. 642 : « Wenn Paulus auch keine bildliche Beschreibung der Hölle bietet, so spricht er doch mit aller Deutlichkeit vom ewigen Unheil nach dem Endgericht. »
[182] Voir les références chez Simon Légasse, « Saint Paul croyait-il à l’enfer ? »…, p. 182.
[183] Cf. Fromaget, p. 77 ; 186-187 ; 203.
[184] Henri Lassiat, « L’anthropologie d’Irénée », Nouvelle revue théologique 100 (1978), p. 399-417 [p. 416] [abrégé : NRTh]. Voir aussi supra, p. 25.
[185] Marcel Richard, art. « Enfer », DTC, t. 5/1 (1939), col. 86 : « La vie, objecte-t-on, est un don gratuit, qu’on peut, par conséquent, refuser à volonté. Ici se trouve l’erreur radicale du conditionalisme ; nous sommes des créatures, faites uniquement pour le service et la gloire de Dieu : voilà la vérité ; la liberté n’a là rien à accepter ou à refuser : c’est l’obligation absolue fondamentale de tout notre être. Obéir, c’est notre bonheur dans la gloire de Dieu ; désobéir, c’est notre malheur, toujours dans la gloire de Dieu, fin inéluctable de la créature. »
[186] Catherine de Sienne, Le Dialogue, 18 (trad. Lucienne Portier, « Sagesses chrétiennes », Paris, Cerf, 21999, p. 39). Voir encore ibid., 37.
[187] Fromaget, p. 141.
[188] Pour un aperçu d’ensemble, qu’il nous soit permis de renvoyer à Christophe J. Kruijen, Peut-on espérer un salut universel ?…, p. 376-386.
[189] Clément de Rome, Épître aux Corinthiens, 11, 1 (« SC, 167 », p. 117 ; 119 ; cf. PÉC, p. 44).
[190] Épître de Barnabé, 20, 1a-b (« SC, 172 », p. 211 ; 213 ; cf. PÉC, p. 808).
[191] Ignace d’Antioche, Aux Éphésiens, 16, 2 (« SC, 10 bis », p. 73 ; PÉC, p. 196).
[192] Cf. PÉC, p. 1197.
[193] Pseudo-Clément de Rome, Seconde épître aux Corinthiens, 6, 7 (PÉC, p. 76).
[194] Pseudo-Clément de Rome, Seconde épître aux Corinthiens, 17, 7 (PÉC, p. 82).
[195] Hermas, Le Pasteur, 53, 4 (« SC, 53 bis », p. 223 ; cf. PÉC, p. 142).
[196] Cf. Ignace d’Antioche, Martyre de saint Polycarpe, 9, 3 ; 11, 2.
[197] Ignace d’Antioche, Martyre de saint Polycarpe, 11, 2 (« SC, 10 bis », p. 225 ; cf. PÉC, p. 253).
[198] À Diognète, 10, 7 (« SC, 33 bis », p. 79 ; cf. PÉC, p. 819).
[199] Justin Martyr, Dialogue avec le juif Tryphon, 5, 3 (PÉC, p. 407).
[200] Justin Martyr, Apologie pour les chrétiens, 75, 1 [II, 7, 1] (PÉC, p. 391). Les contradictions de saint Justin quant à l’immortalité de l’âme et à l’éternité de l’enfer ont été relevées par Michael Schmaus, Katholische Dogmatik, vol. IV/2…, p. 357 ; 359.
[201] Justin Martyr, Apologie pour les chrétiens, 69, 2 [II, 1, 2] (PÉC, p. 385).
[202] Justin Martyr, Apologie pour les chrétiens, 12, 1-2 (PÉC, p. 332).
[203] Justin Martyr, Apologie pour les chrétiens, 8, 4 (PÉC, p. 330 ; cf. « SC, 507 », p. 147). « Justin oppose ici clairement la doctrine chrétienne du châtiment éternel des corps et des âmes à celle de Platon (voir République, X, 615 a ; et Phèdre, 249 a) » (PÉC, p. 1269, n. 17). Les références au châtiment des impies et des démons sont si nombreuses chez saint Justin que Robert Joly a retenu que l’apologète « est obsédé par le besoin manifeste de mettre en enfer les méchants non repentis » (Christianisme et philosophie, Études sur Justin et les apologistes grecs du deuxième siècle, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1973, p. 165). Voici l’essentiel des références au châtiment éternel chez saint Justin : Apologie pour les chrétiens, 8, 4 ; 12, 1-2 ; 15, 2 ; 17, 4 ; 19, 7-8 ; 20, 4 ; 21, 6 ; 28, 1 ; 44, 5 ; 45, 6 ; 52, 3.7-9 ; 54, 2 ; 57, 1 ; 69, 2 [II, 1, 2] ; 70, 2 [II, 2, 2] ; 75, 5 [II, 7, 5] ; 76, 3-4 [II, 8, 3-4] ; 77, 1 [II, 9, 1] ; Dialogue avec le juif Tryphon, 35, 8 ; 45, 4 ; 47, 4 ; 117, 3 ; 120, 5 ; 130, 2.
[204] Justin Martyr, Apologie pour les chrétiens, 20, 4 (PÉC, p. 341).
[205] Justin Martyr, Dialogue avec le juif Tryphon, 130, 2 (PÉC, p. 560).
[206] Cf. Fromaget, p. 156-157.
[207] Justin Martyr, Dialogue avec le juif Tryphon, 5, 3 (PÉC, p. 407). Voir dans le même sens Id., Apologie pour les chrétiens, 18, 1.
[208] Athénagore d’Athènes, Supplique au sujet des chrétiens, 31, 4 (PÉC, p. 666). Voir aussi Id., Sur la résurrection des morts, 19, 3 : l’absence de jugement ou la mort comme dissolution (cf. PÉC, p. 1340, n. 21) rendraient vaine la vertu et donneraient raison aux jouisseurs.
[209] Minucius Félix, Octavius, 34, 12 ; 35, 3 (PÉC, p. 962).
[210] Cyprien de Carthage, À Démétrien, 24, 1 (« SC, 467 », p. 123).
[211] Irénée de Lyon, Contre les hérésies, III, 23, 3 (trad. A. Rousseau, p. 389).
[212] Irénée de Lyon, Contre les hérésies, IV, 28, 2 (trad. A. Rousseau, p. 502-503).
[213] Cf. Irénée de Lyon, Contre les hérésies, V, 7, 1.
[214] Irénée de Lyon, Contre les hérésies, V, 27, 2 (trad. A. Rousseau, p. 651). Voir ibid., IV, 39, 4.
[215] Adelin Rousseau, « L’éternité des peines de l’enfer et l’immortalité naturelle de l’âme selon saint Irénée », NRTh 99 (1977), p. 834-864 [p. 845]. Henri Lassiat a, peu après, réaffirmé sa position dans « L’anthropologie d’Irénée », NRTh 100 (1978), p. 399-417.
[216] Tarald Rasmussen, art. « Hölle – II. Kirchengeschichtlich », Theologische Realenzyklopädie, éd. Gerhard Krause et Gerhard Müller, Berlin-New York, De Gruyter, t. 15 (1986), p. 449 : « Die Rede von der Hölle ist hier weithin von einem einfachen biblischen Realismus geprägt. »
[217] Cf. Giovanni Filoramo, art « Enfer », DECA, t. 1 (1990), p. 816.
[218] Cf. Brian E. Daley, The Hope of the Early Church…, p. 9-15 ; 20-24.
[219] Jean-Paul II, Exhortation apostolique Reconciliatio et paenitentia, 2 décembre 1984, no 26 (AAS 77 [1985], p. 185-275 [p. 246-247] ; DC 82 [1985], p. 1-31 [p. 19]).
[220] Symbole Quicumque, dit d’Athanase (vers 430-500), no 41 (DzH, no 76). Les crochets sont dans l’édition citée.
[221] Édit de l’empereur Justinien au patriarche Menas de Constantinople, publié au concile de Constantinople de 543 : Anathématismes contre Origène, no 9 (DzH, no 411).
[222] Cf. Fromaget, p. 267-268.
[223] Voir le témoignage de Cassiodore, De institutione divinarum litterarum, 1 (PL 70, col. 1111C-D). Selon un ouvrage dirigé par Guiseppe Alberigo, « le pape Vigile, les patriarches orientaux, et même les origénistes de Constantinople […] signèrent la décision » (Les conciles œcuméniques, vol. I, L’histoire, trad. Jacques Mignon, Paris, Cerf, 1994, p. 122).
[224] Cf. Concile de Florence, 11e session, 4 février 1442, Bulle d’union des coptes Cantate Domino (Les conciles œcuméniques, vol. II/1, Les décrets, Nicée I à Latran V, Guiseppe Alberigo, dir., Paris, Cerf, 1994, p. 1187).
[225] Pélage Ier, Lettre Humani generis au roi Childebert Ier, 3 février 557 (DzH, no 443).
[226] Adrien Ier, Lettre Institutio universalis aux évêques d’Espagne (entre 785 et 791) (DzH, no 596).
[227] Concile de Latran IV, 11-30 novembre 1215, chap. 1, La foi catholique : Définition contre les albigeois et les cathares (DzH, no 801).
[228] Innocent IV, Lettre Sub catholicae professione à l’évêque de Tusculum, 6 mars 1254, § 24 (§ 19) (DzH, no 839).
[229] Pie XII, Discours aux participants de la 6e rencontre nationale de l’Union des juristes catholiques d’Italie, 3e partie, 5 février 1955 : « Il fatto della immutabilità e della eternità di quel giudizio di riprovazione e del suo adempimento è fuori di qualsiasi discussione » (AAS 47 [1955], p. 72-85 [p. 80] ; trad. fr., DC 52 [1955], col. 193-206 [col. 201]).
[230] Paul VI, Sollemnis professio fidei, 30 juin 1968, no 12 : « Qui Amori et Pietati Dei responderint, ibunt in vitam aeternam, qui vero ea usque ad exitum respuerint, igni addicentur interituro numquam » (AAS 60 [1968], p. 433-445 [p. 438]).
[231] Congrégation pour la doctrine de la foi, Lettre Recentiores episcoporum Synodi, 17 mai 1979, no 7 : « Ecclesia, Novo Testamento ac Traditioni fideliter adhaerens, credit […] poena aeterna plectendum fore peccatorem, qui Dei visione privabitur, nec non huius poenae repercussionem in totum ipsius peccatoris ‟esse” » (AAS 71 [1979], p. 939-943 [p. 941-942 ; DzH, no 4657]).
[232] CÉC, no 1035 renvoie en note aux textes suivants : Symbole Quicumque dit de saint Athanase (vers 430-500), § 41 (DzH, no 76) ; Anathématismes contre Origène publiés au concile de Constantinople de 543, no 9 (DzH, no 411) ; concile de Latran IV, 11-30 novembre 1215 (DzH, no 801) ; 2e concile de Lyon, 4e session, 6 juillet 1274 (DzH, no 858) ; Benoît XII, Constitution Benedictus Deus, 29 janvier 1336 (DzH, no 1002) ; concile de Florence, Bulle Cantate Domino : Décret pour les jacobites, 4 février 1442 (DzH, no 1351) ; concile de Trente, 6e session, 13 janvier 1547, Décret sur la justification, can. 25 (DzH, no 1575) ; Paul VI, Profession de foi solennelle, 30 juin 1968, no 12.
[233] Fromaget, p. 265-270.
[234] Kull, p. 92.
[235] Henri Lassiat, L’actualité de la catéchèse apostolique…, p. 8-9, cité d’après Kull, p. 153.
[236] Voir infra, p. 53, n. 276.
[237] Thomas d’Aquin, Sum. theol., Ia, q. 104, a. 3, resp. : « Communiquer l’être à la créature dépend donc de la volonté de Dieu. Et Dieu conserve les choses dans l’être uniquement parce qu’il continue à leur communiquer l’être. » Voir ibid., a. 1, ad 4.
[238] Augustin d’Hippone, De diversis quaestionibus 83, q. 21 (Bibliothèque augustinienne, t. 10, Paris, Desclée de Brouwer, 1952, p. 71 ; cf. PL 40, col. 16). Ce texte est cité dans Thomas d’Aquin, Sum. theol., Ia, q. 104, a. 3, arg. 1.
[239] Thomas d’Aquin, Sum. theol., Ia, q. 104, a. 3, ad 1. Voir à ce sujet la citation du même article (corpus), infra, p. 49.
[240] Augustin d’Hippone, De natura boni contra manichaeos, 3 : « Omnis […] natura bona est. » De même Thomas d’Aquin, Sum. theol., Ia, q. 5, a. 3, resp. : « Tout étant, pour autant qu’il est, est bon. »
[241] Léon le Grand, Lettre Quam laudabiliter à l’évêque Turribius d’Astorga, 21 juillet 447, chap. 6 : « La vraie foi… professe que la substance de toutes les créatures spirituelles ou corporelles est bonne, et que le mal n’a pas de nature parce que Dieu, qui est le créateur de l’univers, n’a rien fait que de bon » (DzH, no 286). « Ayant mal usé de son excellence naturelle », le diable « n’est pas passé à une substance contraire, mais il s’est séparé du souverain bien auquel il devait rester uni » (ibid.). Voir aussi concile de Florence, Bulle Cantate Domino, 4 février 1442 (DzH, no 1333), de même que Augustin d’Hippone, De civitate Dei, XIX, 13, 2 : « Proinde nec ipsius diaboli natura, in quantum natura est, malum est; sed perversitas eam malam facit. » Il ne saurait donc exister un souverain mal, i. e. le mal par essence : « Comme il reste toujours du bien dans les êtres, il ne peut y avoir quelque chose qui soit intégralement et parfaitement mauvais » (Thomas d’Aquin, Sum. theol., Ia, q. 49, a. 3, resp.).
[242] BJ, note c. sur Sg 1, 14 : « Dieu, “Celui qui est”, Ex 3, 14, a créé toutes choses pour qu’elles “soient”, pour qu’elles aient une vie réelle, solide, durable. »
[243] Cité à titre d’argument d’autorité dans Thomas d’Aquin, Sum. theol., Ia, q. 104, a. 4, s. c.
[244] Klaudius Jüssen, art. « Annihilierung », LThK, t. 1 (21957), col. 576 : « Gott wird […], wie dies die Offenbarungsurkunden andeuten und die Theologen einmütig lehren, kein Geschöpf annihilieren, obschon er es, absolut gesprochen, tun könnte. […] Die vernunftbegabten Wesen werden in individuo ewig fortbestehen. »
[245] Sur cette question difficile, on pourra lire le chapitre très dense intitulé « La joie d’être », dans Jean-Louis Chrétien, La voix nue, Phénoménologie de la promesse, Paris, Éditions de Minuit, 1990, p. 275-294.
[246] Thomas d’Aquin, Sum. theol., Ia, q. 5, a. 2, ad 3.
[247] Jean-Louis Chrétien, La voix nue…, p. 291. Sur la position de saint Thomas à ce sujet, voir plus largement ibid., p. 287-291.
[248] Thomas d’Aquin, Sum. theol., Ia, q. 104, a. 3, resp. Saint Clément de Rome écrit ainsi dans son Épître : « Par une parole de sa magnificence, il [Dieu] a établi l’univers, et par une parole, il peut le renverser » (Épître aux Corinthiens, 27, 4 [PÉC, p. 53]).
[249] Cf. Josef Finkenzeller, art. « Annihilation », LThK, t. 1 (32006), col. 697.
[250] Thomas d’Aquin, Sum. theol., Ia, q. 104, a. 4, resp.
[251] Thomas d’Aquin, Sum. theol., Ia, q. 104, a. 4, resp. À ce sujet, Josef Finkenzeller relève que la plupart des théologiens contemporains rejettent la doctrine des nominalistes et des premiers scotistes, selon laquelle, lors de la transsubstantiation eucharistique, Dieu annihilerait d’abord les substances du pain et du vin avant de rendre présent le corps et le sang du Christ. Lesdites substances ne sont pas annihilées, mais converties au corps et au sang (cf. art. « Annihilation », LThK, t. 1 [32006], col. 697).
[252] Voir à ce sujet concile de Sens (24-25 mai 1141), Erreurs de Pierre Abélard, no 6 (DzH, no 726) ; Thomas d’Aquin, Sum. theol., Ia, q. 25, a. 5-6.
[253] On pourra lire à ce sujet Gianni Paganini, « Le lieu du néant. Gassendi et l’hypothèse de l’annihilatio mundi », Dix-septième siècle, no 233 (2006), p. 587-600 (disponible en ligne à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-dix-septieme-siecle-2006-4-page-587.htm).
[254] Le blasphème contre l’Esprit Saint est ainsi dit irrémissible non parce que Dieu ne pourrait pas le remettre dans l’absolu, mais parce que l’Écriture nous révèle qu’il n’est jamais remis de fait (cf. Mc 3, 29).
[255] Congrégation pour la doctrine de la foi, Instruction Donum veritatis, 24 mai 1990, no 12 [abrégé : Donum veritatis].
[256] Cf. Donum veritatis, no 11.
[257] Cf. Donum veritatis, no 12.
[258] Donum veritatis, no 10.
[259] Fromaget, quatrième de couverture.
[260] Concile Vatican II, Constitution dogmatique Dei Verbum, no 7 [abrégé : Dei Verbum].
[261] Concile de Trente, 4e session, 8 avril 1546, Décret sur la réception des livres saints et des traditions (DzH, no 1501).
[262] Cf. Concile Vatican II, Dei Verbum, nos 8-9.
[263] Cf. Concile Vatican II, Dei Verbum, no 8.
[264] Cf. Concile Vatican I, 4e session, 18 juillet 1870, Constitution dogmatique Pastor aeternus, chap. 4 (DzH, no 3070) ; concile Vatican II, Dei Verbum, no 10.
[265] Cf. Concile Vatican II, Constitution dogmatique Lumen gentium, no 12 [abrégé : Lumen gentium]. « L’Église universelle ne peut pas se tromper, gouvernée qu’elle est par l’Esprit Saint qui est l’Esprit de vérité » (Thomas d’Aquin, Sum. theol., IIa-IIae, q. 1, a. 9, s. c.).
[266] Cf. Concile Vatican II, Lumen gentium, no 25.
[267] Thomas d’Aquin, Sum. theol., IIa-IIae, q. 10, a. 12, resp. : « L’enseignement même des docteurs catholiques tient son autorité de l’Église. Il faut donc s’en tenir plus à l’autorité de l’Église qu’à celle d’un Augustin ou d’un Jérôme ou de quelque docteur que ce soit. »
[268] Kull, p. 23 ; 151.
[269] Fromaget, p. 12.
[270] Fromaget, p. 12.
[271] Concile Vatican II, Dei Verbum, no 12 : « Il ne faut pas, pour découvrir exactement le sens des textes sacrés, porter une moindre attention au contenu et à l’unité de toute l’Écriture, eu égard à la Tradition vivante de toute l’Église et à l’analogie de la foi. »
[272] Concile Vatican II, Dei Verbum, no 12. Ce texte se réfère à concile Vatican I, 3e session, 24 avril 1870, Constitution dogmatique Dei Filius, chap. 2 [abrégé : Dei Filius] : « On doit tenir pour véritable sens de la sainte Écriture celui qu’a tenu et que tient notre Mère la sainte Église, à laquelle il appartient de juger du sens et de l’interprétation véritable des saintes Écritures » (DzH, no 3007).
[273] Concile Vatican II, Dei Verbum, no 10 : « La charge d’interpréter de façon authentique la Parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul Magistère vivant de l’Église dont l’autorité s’exerce au nom de Jésus Christ. » Voir dans le même sens Pie XII, Lettre encyclique Humani generis, 12 août 1950 (AAS 42 [1950], p. 569 ; DzH, no 3886) ; Jean-Paul II, Discours aux participants à l’assemblée plénière de la Congrégation pour la doctrine de la foi, 24 novembre 1995, no 2.
[274] Cf. Fromaget, p. 261. Pour le « positivisme théologique », voir Donum veritatis, no 33.
[275] Joseph Ratzinger, Le nouveau peuple de Dieu, trad. Robert Givord et Henri Bourboulon, Paris, Montaigne, 1971, p. 95 (original : Das neue Volk Gottes, Entwürfe zur Ekklesiologie, Düsseldorf, Patmos Verlag, 21970, p. 165).
[276] Congrégation pour la doctrine de la foi, Note doctrinale illustrant la formule conclusive de la Professio fidei…, no 3.
[277] Cf. Pie IX, Lettre Tuas libenter à l’archevêque de Munich-Freising, 21 décembre 1863 (DzH, no 2879).
[278] Tarcisio Bertone, « À propos de la réception des documents du Magistère et du désaccord public », DC 94 (1997), p. 108-112 [p. 108-109] (original : « A proposito della recezione dei documenti del Magistero e del dissenso pubblico », L’Osservatore Romano, 20 décembre 1996, p. 1 ; 5 [p. 1]).
[279] « Foi chrétienne et démonologie », DC 72 (1975), p. 708-718 [p. 717] : « Il est vrai qu’au cours des siècles l’existence de Satan et des démons n’a jamais fait l’objet d’une affirmation explicite de son magistère. La raison en est que la question ne se posa jamais en ces termes : les hérétiques et les fidèles, appuyés également sur l’Écriture, s’accordaient à reconnaître leur existence et leurs principaux méfaits. » Ce document, rédigé (en français) par un expert à la demande de la Congrégation pour la doctrine de la foi et vivement recommandé par elle, ne constitue pas cependant un document officiel de ce dicastère.
[280] Voir notamment concile de Latran IV, Définition contre les albigeois et les cathares (DzH, no 800).
[281] Cf. Paul VI, Audience générale, 15 novembre 1972.
[282] Concile Vatican I, Dei Filius, chap. 3 : « On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la Parole de Dieu, écrite ou transmise par la Tradition, et que l’Église propose à croire comme divinement révélé, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel » (DzH, no 3011). Voir aussi Pie XII, Lettre Encyclique Humani generis (AAS 42 [1950], p. 568 ; DzH, no 3885]) ; concile Vatican II, Lumen gentium, no 25.
[283] Joseph Ratzinger, Le nouveau peuple de Dieu…, p. 95 (original : Das neue Volk Gottes…, p. 165).
[284] Fromaget, p. 261.
[285] Fromaget, p. 301, n. 8 (l’auteur renvoie à François Dreyfus, Jésus savait-il qu’il était Dieu ?, Paris, Cerf, 1984).
[286] Cf. Concile Vatican I, Dei Filius, chap. 3 (DzH, no 3008) ; CÉC, no 156. L’autorité divine est cependant médiatisée par celle de l’Église en tant que corps du Verbe chef et vérité, ce qui fait dire à saint Augustin qu’il ne croirait pas à l’Évangile si l’autorité de l’Église catholique ne l’y poussait (cf. Contra epistolam Manichaei quam vocant fundamenti, 5).
[287] Donum veritatis, no 29 : « Jamais en tout cas ne pourra manquer une attitude fondamentale de disponibilité à accueillir loyalement l’enseignement du Magistère, comme il convient à tout croyant au nom de l’obéissance de la foi. » Sur cette obéissance, voir Rm 1, 5 ; 16, 26.
[288] Voir supra, n. 273.
[289] Concile Vatican I, Dei Filius, canons sur le chap. 3, can. 6 : « Si quelqu’un dit que […] les catholiques pourraient avoir un juste motif, en suspendant leur assentiment, de révoquer en doute la foi qu’ils ont reçue sous le magistère de l’Église jusqu’à ce qu’ils aient terminé la démonstration scientifique de la crédibilité et de la vérité de leur foi, qu’il soit anathème » (DzH, no 3036).
[290] Donum veritatis, no 31.
[291] Donum veritatis, no 27.
[292] Jean-Paul II, Discours aux théologiens à Altötting, 18 novembre 1980, no 3 (texte cité dans Donum veritatis, no 11).
[293] Fromaget, p. 117. L’auteur parle ailleurs de « “l’impensabilité” absolue » de l’enfer éternel (p. 24).
[294] Cf. André Lalande, art. « Rationalisme », Vocabulaire technique et critique de la philosophie…, p. 889.
[295] Cf. Donum veritatis, no 7.
[296] Concile Vatican I, Dei Filius, chap. 4 (DzH, no 3016).
[297] Pour le rôle décisif de la foi en Jésus Christ et de l’obéissance à sa Parole, voir par exemple Fromaget, p. 83.
[298] Cf. Fromaget, p. 24.
[299] Sur le plan canonique, « on appelle hérésie la négation obstinée, après la réception du baptême, d’une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique, ou le doute obstiné sur cette vérité » (Code de droit canonique, can. 751).
[300] M. Fromaget admet ainsi que son essai « s’inscrit dans une tradition séculaire de négation de l’enfer » (p. 242).
[301] Marcel Richard, art. « Enfer », DTC, t. 5/1 (1939), col. 86 (la phrase est ironique).
[302] Henri Lassiat écrit ainsi qu’« il n’y a pas de violence en Dieu » (L’actualité de la catéchèse apostolique…, p. 305sv., cité d’après Kull, p. 107).
[303] Versus Kull, p. 193 ; Fromaget, p. 72.
[304] Voir ainsi la citation de Jean-Paul II, Exhortation apostolique Reconciliatio et paenitentia, no 26, donnée supra, p. 43.
[305] Marcel Richard, art. « Enfer », DTC, t. 5/1 (1939), col. 86.
[306] Cf. Fromaget, p. 242.