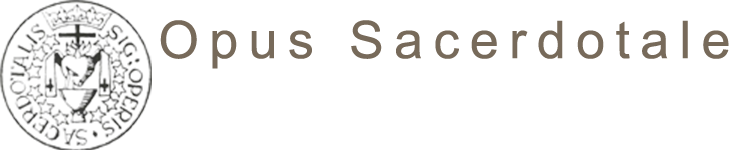Res Novæ – octobre 2022
Res Novæ (octobre 2022)
Pour une vraie réforme de l’Église
Vatican II, il faut encore plus de Vatican II ! Mais l’élixir réformateur est depuis longtemps éventé… Réformer quoi, au fait ? Le grand dessein de François, symbolisé par Prædicate Evangelium, la constitution qui réforme la Curie, est tout autant une réforme de l’Église selon l’esprit de Vatican II qu’une réforme de la Curie. Il y a certes une ambiguïté entretenue sur l’objet, Curie, Église, que prolongent et accroissent les médias, mais les liens entre l’une et l’autre réforme n’en sont pas moins intrinsèques : la réorganisation du gouvernement romain emporte nécessairement des conséquences pour celui de toute l’Église.
On l’a bien vu dans les discussions qui ont eu lieu à l’occasion du consistoire de la fin du mois d’août, où fut mise en scène une sorte de seconde et plus solennelle promulgation de la Constitution Prædicate Evangelium du 19 mars 2022. Elle a été présentée au collège cardinalice, auquel la parole – dûment encadrée – a été donnée, pour qu’il manifestât son approbation. Il y eu cependant des critiques[1], qui ont ainsi souligné les enjeux ecclésiaux de toute réforme de l’administration centrale. Des cardinaux ont soulevé la difficulté que représentait la possibilité de nommer de simples laïcs chefs de dicastères. Leur requête, qui invoquait Lumen gentium et la sacramentalité de l’épiscopat, était assez floue. Pour résumer le problème réel : un certain nombre des préfets de Curie ont de véritables pouvoirs de juridiction, spécialement pour juger des évêques et des clercs, et aussi pour émettre des textes, réponses, sentences à portée doctrinale. Ils reçoivent bien cette juridiction par délégation du pape, mais ils doivent avoir une capacité intrinsèque à se la voir conférée pour ce type d’actes (juger, enseigner), laquelle découle de leur qualité de clercs. A été aussi relevé l’abus du terme synodalité, sorte de slogan qui veut exprimer une extension de la collégialité épiscopale chère à Vatican II à l’ensemble du peuple de Dieu. Or, historiquement, a fait remarquer un cardinal oriental, le mot synodalité est presque l’équivalent de collégialité épiscopale, car il renvoie justement à un certain exercice collégial du pouvoir épiscopal dans les Églises d’Orient. Il n’est donc pas apte à signifier une sorte de démocratisation, qui devrait plutôt être nommée « communialité ».
Des réformes successives dans la ligne de Vatican II sur une Église épuisée et divisée
Il faut avoir présent à l’esprit que Vatican II, en quatre années, de 1962 à 1965, avait renversé un édifice non seulement tridentin, comme on se contente de le dire souvent, mais même grégorien (de la Réforme grégorienne, au XIe siècle). Malgré toutes les crises, Grand Schisme, Réforme protestante, Révolution, et de manière pathétique depuis la dernière, l’Église a continué à revendiquer pleinement, comme elle l’a fait avec une très grande force lors du « moment grégorien », le principe de sa liberté : Épouse du Christ, elle a toujours eu conscience d’être la totalité surnaturelle de son Corps mystique sur la terre. Mais voilà que Vatican II a fait craquer cette plénitude totale qu’affirmait être l’Église : en émettant un certain nombre d’« intuitions » (liberté religieuse, œcuménisme, principes du dialogue interreligieux), ce concile a reconnu hors de l’Église l’existence d’entités surnaturelles, certes incomplètes, de voies salutaires, quoique déficientes, d’une communion au Christ, bien qu’imparfaite. Du coup des textes magistériels dans la veine de l’encyclique Quas Primas, sur la royauté institutionnelle du Christ, sont devenus obsolètes. Cette « ouverture au monde moderne » de la société ecclésiastique, très concrètement à la démocratie libérale, s’est réalisée en concomitance avec un emballement de la sécularisation de ce monde. A moins que le renversement ecclésiologique opéré n’ait fortement contribué à accroître cette sécularisation. Devant laquelle les hommes d’Église ont été pris de court. Ils avaient avancé de cent pas, cependant que le monde en avait couvert dix mille. Et la rénovation est apparue avoir été un suicide : de toutes les conséquences politiques, spirituelles, disciplinaires qui en résultèrent, la plus frappante fut l’épuisement de la mission, raison d’être de l’Église du Christ, qui se lisait dans la raréfaction des principaux ouvriers de la moisson, clercs et religieux, et dans celle du nombre des convertis et des pratiquants.
Mais pire encore, non seulement le corps s’anémiait, mais il se brisait. Il est devenu très vite patent que le Concile n’avait pas réussi à faire l’unité autour de son projet : l’opposition de la minorité conciliaire, devenue l’opposition traditionaliste dynamisée par sa dimension liturgique, s’est avérée impossible à réduire, opposition dont les rangs ont été grossis, surtout depuis l’actuel pontificat, de tout un monde réformiste ou « restaurationniste » qui, dans le fond et quoi qu’il dise, ne s’est jamais pleinement accordé à Vatican II. L’unité de ce qui restait de catholicisme a volé en éclat.
C’est donc dans ce cadre d’une Église en voie d’épuisement et plus encore divisée qu’a été tentée la réforme de son gouvernement central en lien avec une conception globale de ce que devrait être la réforme de l’Église tout entière, autrement dit en lien avec la compréhension de Vatican II.
Une première fois, pour répondre au vœu du Concile, Paul VI, par la constitution Regimini Ecclesiæ Universæ, avait profondément remanié le visage de la Curie romaine, créant notamment des organismes nouveaux (Conseils des Laïcs, pour l’Unité des Chrétiens, etc.). La modification la plus emblématique qu’il avait apportée était la transformation de la Suprême Congrégation du Saint-Office, chargé de la régulation par le pape de la doctrine catholique et qui n’avait pas de Préfet, le pape se réservant de la diriger directement, par une Congrégation pour la Doctrine de la Foi. La constitution Pastor Bonus, du 28 juin 1988, de Jean-Paul II, qui a principalement accordé le fonctionnement de la Curie au nouveau Code de Droit canonique, n’avait pas apporté de remaniements fondamentaux. La véritable nouveauté de cette réforme était dans le renouvellement du personnel de gouvernement issu – c’était le cas pour le personnel liturgique – de la majorité conciliaire. Au gré des nominations, les Congrégations et Conseils devenaient plus ou moins progressistes ou redevenaient plus ou moins conservateurs.
Aujourd’hui, Prædicate Evangelium se veut une mise en pratique supplémentaire de l’« esprit du Concile » sur le gouvernement romain, en même temps qu’un modèle à suivre à tous niveaux pour promouvoir une réforme de toute l’Église qui sera vraiment conciliaire. Une des modifications-phares est la rétrogradation du Dicastère de la Doctrine de la Foi au deuxième rang, derrière celui de l’Évangélisation. Mais ici encore, la Curie est surtout nouvelle parce que son personnel a été « mis aux normes » bergogliennes. Quant au projet de faire accomplir un saut qualitatif conciliaire décisif tant à la Curie qu’à l’Église tout entière, l’anémie du corps ecclésiastique et les tensions de plus en plus fortes qui le traversent le font ressembler à un vœu pieux.
Tentatives de restauration de l’unité perdue : un double échec
Quand l’Église a abordé aux rives du vingt-et-unième siècle, on a pu mesurer l’échec fondamental de Vatican II du point de vue qui est le premier pour elle, celui de la mission : non seulement elle ne convertissait plus, mais le nombre de ses fidèles, de ses religieux et de ses prêtres se réduisait à tel point qu’elle semblait en voie de disparition, au moins en Occident. Vatican II, dont toute l’ambition avait été d’adapter le message à la sensibilité des hommes de ce temps et de les attirer à une Église rajeunie, transformée, modernisée, n’est même pas arrivé à les intéresser.
Et surtout, le recul du temps a fait apparaître qu’une déchirure, on peut dire un schisme latent, s’était produit après Vatican II, partageant l’Église entre deux courants, l’un et l’autre composites mais bien identifiables, le premier, pour lequel il fallait revenir sur le Concile ou au minimum l’endiguer, l’autre pour lequel il n’était qu’un programme de départ. Le projet de rétablir l’unité autour ce Concile qui ne se donnait pas pour être le magistère infaillible, autrement dit qui n’était pas un principe de foi à proprement parler, a été la croix des papes de l’après-Vatican II. Ils y ont échoué. Tant les papes de restauration, Jean-Paul II et surtout Benoît XVI, que François, pape de progrès, n’ont pu même en maintenir la fiction.
2005, la tentative Ratzinger : encadrer le Concile
Peu après son élection, dans son bien connu discours à la Curie du 22 décembre 2005, Benoît XVI distinguait deux interprétations de la réforme conciliaire, « l’herméneutique de la discontinuité et de la rupture », qu’il estimait néfaste, et « l’herméneutique de la réforme ou du renouveau dans la continuité », qu’il faisait sienne, destinée, disait-il, à empêcher « une rupture entre Église préconciliaire et Église postconciliaire. » Étaient en somme définis par le pape ce qu’on appellerait dans une démocratie libérale – aux modes de pensée de laquelle l’Église est de plus en plus perméable – un centre-droit, que légitimait le pape, et un centre-gauche, qu’il disqualifiait.
Il ne s’agissait nullement pour lui d’adhérer au front traditionaliste qui, à des degrés divers, refusait le Concile et/ou sa liturgie. Pourtant, du fait de son intérêt pour la liturgie d’avant le Concile, Benoît XVI aurait pu aller plus loin que l’herméneutique du renouveau dans la continuité. Son « restaurationnisme » pouvait devenir l’amorce d’un processus de transition, comme celui qui se déroula avec Jean XXIII, mais en sens inverse.
Pourtant, comme on sait, le processus est resté au milieu du gué, y compris en ce qui concerne « le renouveau dans la continuité » : non seulement on n’en n’est pas venu à un refus du Concile, mais le restaurationnisme, l’endiguement du Concile, a été perçu comme un échec, une tentative sans résultat. L’Église en Occident continuait de disparaître de l’espace social, le personnel ecclésiastique, prêtres, religieux, séminaristes ne cessait de s’amenuiser et le centre romain donnait l’impression de n’avoir plus de timonier. Devenu la cible d’attaques continues des tenants de « l’herméneutique de la discontinuité », Benoît XVI s’est isolé dans son cabinet de théologien privé, anticipant moralement la démission à laquelle il s’est finalement décidé en 2013.
2013, la tentative Bergoglio : maximaliser le Concile
Comme naturellement (en réalité, au terme d’une intense préparation électorale), le conclave de 2013 essaya l’autre option, celle de centre-gauche, l’« herméneutique » de Vatican II opposée, à laquelle s’était rallié Jorge Bergoglio. Le nouveau pape, qui dans un discours aux revues jésuites de 2022 s’est dit en lutte d’une part contre le « restaurationnisme », lequel veut « bâillonner » le Concile, et d’autre part contre le « traditionalisme », qui veut l’évacuer, s’est donc employé à « abattre les murs », selon l’expression qu’il affectionnait :
- celui d’Humanæ vitæ et de l’ensemble de textes qui à sa suite avaient préservé la morale conjugale de la libéralisation que Vatican II avait fait subir à l’ecclésiologie. Amoris lætitia déclara en 2016 que des personnes vivant dans l’adultère public peuvent y demeurer sans commettre de péché grave (AL 301).
- Celui de Summorum Pontificum, quiavait reconnu un droit à ce conservatoire de l’Église d’avant qu’est la liturgie ancienne avec sa catéchèse et son personnel clérical. Traditionis custodes, en 2021,et Desiderio desideravi, en 2022,invalidèrent cette tentative de « retour » et déclarèrent que les nouveaux livres liturgiques sont la seule expression de la lex orandi du rite romain (TC, art. 1).
Mais l’option Bergoglio est en train d’échouer comme avait précédemment échoué l’option Ratzinger : l’institution ecclésiale a continué de s’effondrer et la mission de s’éteindre. Et si sous Benoît XVI, la désillusion s’était cristallisée sur l’absence de gouvernance, c’est au sujet du trop-plein d’un gouvernement brouillon et dictatorial, malgré le mot d’ordre de synodalité et malgré Prædicate Evangelium, que les critiques se manifestent de plus en plus sous François. Par ailleurs, pas plus que Benoît XVI n’avait jamais pris le risque d’une rétrogradation en deçà du Concile, François s’est soigneusement gardé de le dépasser au risque de faire exploser une structure institutionnelle : par exemple, malgré toutes ses déclarations contre le cléricalisme, il n’a jamais vraiment remis en cause le célibat sacerdotal ni ouvert la prêtrise aux femmes.
Ainsi, ni la tentative d’assagir le Concile, ni celle de le maximaliser n’ont stoppé l’hémorragie, qui s’est poursuivie. Elle s’est même accentuée, dans la mesure où le pôle de conservation (ratzinguériens et traditionalistes, pour résumer grossièrement) s’est fortifié. Relativement, d’abord, parce qu’il croit régulièrement, au moins par l’arrivée de nouvelles générations, alors que le pôle progressiste ne connaît pas de transmission. Et aussi, parce qu’il est devenu un peu plus homogène, l’alliance s’est resserrée entre les ratzinguériens, tenants de « l’herméneutique de la réforme dans la continuité » et le « front du refus », le traditionalisme. Ce dernier est plus présent que jamais, comme le prouvent les coups répétés qui lui sont portés comme s’il était l’ennemi par excellence.
Pour une vraie réforme
L’adage Ecclesia semper reformanda, l’Église doit toujours se réformer, date du début du XVe siècle, à l’époque du Grand Schisme, où la nécessité d’une « réforme dans la tête et dans les membres », dans la papauté et dans tout le corps ecclésial, devenait évidente pour tous. Mais il fallut attendre plus d’un siècle pour voir ce grand désir du monde catholique aboutir véritablement, par-delà la réforme sous forme de révolte du protestantisme, avec le Concile de Trente.
En fait, le thème de la réforme d’une Église, sainte en elle-même mais composée de pécheurs, date du XIe siècle, de ce que les historiens ont nommé la réforme grégorienne – ils préfèrent aujourd’hui parler de « moment grégorien » –, son ferment a été la vie religieuse, celle du monachisme de Cluny spécialement. C’est dans l’ordre des choses, la visée de perfection évangélique de la vie religieuse est le modèle des nécessaires rénovations de l’Église. Elles sont accompagnées et stimulées par les réformes des ordres religieux (parmi bien d’autres, celle du Carmel, au XVIe), avec un retour à l’exigence des Béatitudes, une rénovation spirituelle et disciplinaire, un retrait de la corruption du monde pécheur pour se convertir et pour le convertir (Jn 17, 16, 18).
Mais à partir du christianisme des Lumières, dans les pays germaniques, en France, en Italie, le terme de réforme a commencé à s’appliquer aussi à un autre projet, celui d’adaptation des institutions ecclésiastiques au monde environnant, lequel commençait alors à échapper au christianisme.
Deux types de réforme, désormais, vont souvent se trouver contraposés, celui traditionnel d’une réforme de revitalisation de l’identité de l’Église, et celui d’une réforme d’ajustement de l’Église à la société nouvelle dans laquelle elle vit. C’est essentiellement l’idée traditionnelle de réforme qui s’est retrouvée dans des mouvements tels que la renaissance des ordres religieux, notamment bénédictin, au XIXe siècle après la tourmente révolutionnaire, la restauration du thomiste à partir de Léon XIII, les réformes liturgiques et disciplinaires de saint Pie X au début du XXe siècle, et les tentatives d’endiguement doctrinal et liturgique de la grande ébullition des années 50 par Pie XII. Au contraire, l’idée nouvelle de réforme, avec son livre programme, Vraie et fausse réforme dans l’Église, d’Yves Congar (Cerf, 1950), se lit dans la « nouvelle théologie », des années d’après-Guerre, dans le mouvement œcuménique et, pour une part, dans le Mouvement liturgique, et elle a triomphé avec Vatican II.
Un renversement ecclésiologique
Une réforme de type grégorien, avec une liturgie retrouvée, une discipline rigoureuse, une formation exigeante des candidats au sacerdoce, une stature sainte et forte des pasteurs, une ré-évangélisation par un re-catéchisation, va de pair avec un renversement ecclésiologique.
Mais n’est-il pas purement incantatoire de souhaiter un retour à une Église de type « moment grégorien », alors que l’état de notre Mère, un demi-siècle après Vatican II, et pour une part importante à cause de ce concile, est dans un état de déréliction maximale, sans aucune capacité de faire valoir les prétentions « triomphalistes » que l’on prête à la papauté du XIe siècle ?
Certainement pas, si on considère que la force de Dieu se déploie d’abord dans la faiblesse. Celle du catholicisme est extrême, qui semble toujours plus une anomalie pour la culture ambiante. Et bien faible est aussi ce qui, malgré tout, continue pourtant à prospérer en elle et qu’on a du mal à imaginer comme le creuset d’un renouveau spirituel, catéchétique, missionnaire, vocationnel, mais qui peut y participer. En l’état actuel, ce que l’on nomme le « nouveau catholicisme », fait de prêtres « identitaires », de fidèles jeunes, de familles très pratiquantes, de communautés nouvelles, de traditionalismes de toutes sensibilités, représente en Occident tout ce qui restera de vivant dans quelques années. Son importance numérique est fort mince et il a, par ailleurs le plus grand mal à résister au poids de la modernité, à l’imprégnation d’un individualisme ravageur et à la tentation « bourgeoise » qui s’exerce sur lui.
Quelle réforme demain ? « Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 Cor 12, 10). Et pour en revenir à Rome et à sa Curie, est-il nécessaire, est-il même possible que le Successeur de Pierre apparaisse longtemps comme une sorte de leader universel ? Dans une grande « infirmité », pour parler comme saint Paul, ce qui fait l’essence de l’épiscopat romain et universel, à savoir le fait de dire la foi au nom du Christ sans possibilité d’errer, pourra apparaître comme l’or pur qui reste au fond du tamis de la crise.
Abbé Claude Barthe
[1] Il Sismografo: Vaticano. Laici e sinodalità. Quel che si sono detti i cardinali nel concistoro segreto.
Vers l’implosion ?
Par Don Pio Pace
Vers l’implosion ? : c’est le titre (dans lequel le point d’interrogation est de pure forme) du livre d’« entretiens sur le présent et l’avenir du catholicisme » entre Danièle Hervieu-Léger, sociologue des religions, directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), et Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions, ancien directeur de la revue Esprit.
Les deux interlocuteurs brodent sur le diagnostic que pose depuis longtemps Danièle Hervieu-Léger, selon lequel se serait produite une « exculturation » du catholicisme : le lien entre culture catholique et culture commune se serait défait. La faute au ringardisme catholique : l’Église de Vatican II, après avoir ouvert des brèches pour rapprocher le catholicisme du monde contemporain, effrayée de ses propres audaces, s’est arrêtée en chemin. D. Hervieu-Léger et J.-L. Schlegel, pessimistes, estiment que les réformes selon eux nécessaires (clergé marié, sacerdoce féminin, entre autres), n’auront pas lieu et qu’il est de toute façon trop tard. Le catholicisme ne survivra pas, disent-il, à une crise interne qui a vu s’effondrer les trois piliers du catholicisme : le monopole de la vérité, la couverture territoriale grâce aux paroisses et la centralité du prêtre comme personnage sacré.
Pour eux, la fracture entre deux catholicismes – que D. Hervieu-Léger appelle « une ligne de schisme » – est entre deux populations catholiques distinctes, mais mouvantes. La réalité serait plutôt celle de « la diversité, la pluralité, l’éclatement ». Le catholicisme connaîtrait un phénomène croissant de « diasporisation », mais qui ne relèverait pas de la même logique que les diasporas juive, arménienne, libanaise, etc., d’installation de petites communautés en terres étrangères. Ici les petites communautés catholiques sont devenues des communautés de diaspora sur place, sur une terre qui est pour ainsi dire devenue étrangère sous leurs pieds. Elles vont avoir à gérer elles-mêmes les nombreuses tensions intérieures qui les traversent et ce pourrait être une « chance » – mais ici les projections des auteurs deviennent fort vagues – dans la mesure où ces communautés « diasporiques » auraient à réinventer une tradition « extrêmement créatrice ». Les instances épiscopales se contentant d’être garantes d’un « lien de communion », assez lâche on suppose. En un mot, si l’on comprend bien, puisque la dynamique Vatican II, même dynamisée par François (lequel est entravé par « la Curie », comme on sait…) n’a pu aboutir institutionnellement, elle aboutira grâce à l’implosion du catholicisme.
Sauf que… Sauf qu’ils accordent cependant l’un et l’autre beaucoup d’attention à la nébuleuse « conservatoire » pour parler comme Yann Raison du Cleuziou (Qui sont les cathos aujourd’hui, Desclée de Brouwer, 2014) laquelle, jusqu’à un certain point, résiste à la sécularisation interne du catholicisme. Ils conviennent que l’existence de ce « foyer observant » oblige les sociologues de leur génération à réajuster leurs analyses. Mais selon eux l’aspect le plus voyant de la résistance de ce conservatoire [et le plus exaspérant pour les tenants de l’offensive Traditionis custodes], à savoir la « traditionalisation » continue du recrutement sacerdotal – le clergé de type traditionaliste ou Communauté Saint-Martin représentera 20 à 40% du clergé français en 2050 – ne change pratiquement rien, car cela représente une infusion cléricale infime. Infime, on veut bien, mais relativement, car le catholicisme est lui-même devenu lui-même infirme dans la société, comme le martèlent nos auteurs.
Don Pio Pace