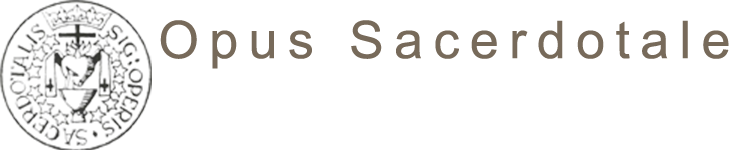Res Novæ janvier 2022
Une théologie et une pratique
de la mort du sacerdoce
« L’Église est à bout de souffle » : c’est le message, pour une part correspondant à la réalité, pour une part fabriqué, que veut donner, en France, en Allemagne, ailleurs, le battage médiatique intense autour des scandales des abus sexuels. Et le message se poursuit : elle doit donc se réformer structurellement en se purifiant de tout cléricalisme dans un mode de fonctionnement plus démocratique, plus synodal.
Il ne s’agit pas de nier que le cléricalisme soit néfaste, si on l’entend de l’arrogance de certains clercs oubliant que leur « part d’héritage », kleros en grec, est d’abord le ministère et le service. Mais le terme, utilisé comme un slogan et de manière dépréciative, fait en réalité écho aux principes idéologiques de la société moderne, toujours plus sécularisée. Et comme à l’époque de Gambetta et de son cri : « Le cléricalisme, voilà l’ennemi », c’est le sacerdoce catholique qui est visé.
Une théologie de l’effacement du sacerdoce
Comme on a connu des théologies de la mort de Dieu, qui avalisent « religieusement » l’athéisme ou l’agnosticisme contemporain[1], on pourrait parler d’une théologie de la mort du sacerdoce donnant une caution « catholique » à l’effacement du sacerdoce dans la société. Les théologiens qui s’y emploient explorent deux types de réflexion, qui ne s’excluent pas mais se complètent.
La perspective synodale consiste à faire que presbytérat et épiscopat soient pour le peuple de l’Église locale concrète et émanant de lui. Le P. Hervé Legrand, op, est un bon représentant de cette visée[2]. Il convient de sortir de la figure administrative qu’a revêtue, selon lui, un clergé fonctionnarisé et de retrouver sa conception traditionnelle, ce qu’on lui accordera volontiers, sauf à discuter sur la manière de revenir à la tradition. Il voudrait pour sa part retrouver le modèle de l’organisation ecclésiastique du début du IIIe siècle, qu’on peut deviner à travers la Tradition apostolique d’Hippolyte de Rome. L’Église locale, explique-t-il, était une communauté présidée par un évêque, seul véritable prêtre, entouré de quelques presbytres, qui n’étaient pas encore des sacerdotes. Cette communauté choisissait son pasteur, duquel il n’était pas exigé d’état de vie spécial (célibat). Selon Hervé Legrand, on pourrait revenir à cette organisation en s’inspirant de la manière dont on choisit les diacres permanents : l’Église locale se demanderait de quel type de pasteurs elle a besoin, les appellerait et leur ferait donner une formation locale en phase avec la culture et les nécessités concrètes, sans les obliger nécessairement au célibat. Les pasteurs, dans cette perspective synodale, naîtraient en quelque sorte du Peuple de Dieu pour l’accompagner dans sa mission, et le sacerdoce ministériel apparaîtrait comme une émanation et un service du sacerdoce des fidèles.
La perspective de « pluriministérialité » (Henri-Jérôme Gagey, Céline Baraud) cherche à intégrer, pour ne pas dire à noyer, le sacerdoce dans un foisonnement de ministères laïcs issus des charismes du Peuple de Dieu[3]. A l’origine a été un article du P. Joseph Moingt, sj : « L’avenir des ministères dans l’Église catholique »[4], qui parlait de la possibilité de « distribuer à d’autres ministres, et notamment à des laïcs, tout ou partie des fonctions jusqu’ici exercées par des prêtres ».
Le P. Christoph Theobald, sj, qui joue actuellement un rôle très actif dans les commissions préparant l’assemblée du Synode sur la synodalité, avec des théologiens comme Arnaud Join-Lambert (Suisse), Alphonse Borras (Belgique), Gilles Routhier (Québec), imagine l’avenir comme ceci[5] : en Europe de l’Ouest, les prêtres fort rares de demain devront être des « prêtres-passeurs », la plupart du temps itinérants, qui éduqueront les chrétiens à la foi, feront mûrir leur sens des responsabilités, puis s’effaceront ; des ministres laïcs stables prendront le relais sur le terrain, et assureront une « présence d’Église », dans la gouvernance des communautés, dans le service de la Parole (prédication, catéchèse, animation de la liturgie, écoute qui pourrait entre autres doubler ou suppléer le sacrement de pénitence), dans l’hospitalité (accueil, rencontres). Les « prêtres-passeurs » pourront d’ailleurs être repérés et choisis par les communautés parmi ceux qui assureront ces ministères pluriels. Et plutôt qu’une formation spécialisée dans des séminaires, l’ensemble de ces acteurs et même l’ensemble de la communauté pourra bénéficiera d’une formation permanente.
Une laïcisation du personnel ecclésiastique
Vatican II, concile par essence très innovant puisqu’il voulait dépasser la doctrine tridentine, a cependant été un concile de transaction entre progrès et tradition dans ses textes, « bricolés », comme le dit l’historien Yvon Tranvouez, pour remporter une adhésion quasi unanime. L’enseignement et la gouvernance politique qui ont suivi le Concile, quelle que soit l’orientation du pouvoir romain, montinienne, wojtylo-ratzinguérienne, bergoglienne, ont été transactionnels : il s’est toujours agi de donner des gages à l’« ouverture » ou au contraire de pratiquer un « recentrement », mais sans excès d’un côté ou de l’autre pour éviter, dans les deux cas, de faire en quelque sorte exploser la machine conciliaire. Il n’empêche que la sécularisation du personnel ecclésiastique, et donc l’effacement du sacerdoce, pour être moins radicales que ne le souhaitent les courants théologiques évoqués plus haut, n’en sont pas moins très réels.
En premier lieu, il y a ce fait massif que l’« ouverture » opérée par le Concile a été comprise par le clergé comme impliquant, sans qu’il y ait même lieu de le discuter, de s’adapter à la sécularisation de la société. Cette sécularisation cléricale ayant d’ailleurs, surtout au début, considérablement accéléré la sécularisation sociale. D’où l’abandon de l’habit ecclésiastique, plus gravement les nombreux abandons de l’état ecclésiastique, la transformation de la vie religieuse, avec pour conséquence l’assèchement des vocations du fait de la perte de sens de cet état aux yeux des jeunes catholiques.
Quant aux décisions romaines de gouvernement (relevant de l’auctoritas gubernandi), qui ont par la force des choses un aspect doctrinal (facultas docendi), elles ont été liturgiques et institutionnelles.
Ainsi, Paul VI guidant puis appliquant Vatican II, tout en maintenant fermement le principe du célibat sacerdotal (encyclique Sacerdotalis Caelibatus du 24 juin 1967), a pris trois lourdes options :
- Instituant, avec Lumen gentium n. 29, contrairement à l’antique discipline du célibat, un diaconat comme degré hiérarchique propre et permanent, pour des hommes éventuellement mariés et ne se destinant pas au sacerdoce. Tout proche du sacerdoce s’est formé ainsi un personnel sociologiquement plus laïque que clérical qui ne cesse de croître (en France, de 2000 à 2019, le nombre des diacres permanents a presque doublé, passant de 1499 à 2794, cependant que le nombre des prêtres en activité baissait de 5000 à 3000).
- Abrogeant par le motu proprio Ministeria quædam, du 15 août 1972, le sous-diaconat et les ordres mineurs et les remplaçant par de simples ministères institués de lecteurs et acolytes, dont les récipiendaires demeurent de simples laïcs[6]. A quoi s’est ajoutée la distribution de la communion par des laïcs, hommes et femmes (instruction Immensæ caritatis du 29 janvier 1973).
- Rendant quasi automatique, dans l’intention en soi bonne qu’ils ne restent pas dans le péché mais produisant un effet éminemment laxiste d’hémorragie vers le siècle, la dispense du célibat des prêtres renvoyés de l’état clérical parce qu’ils ont fait défection. (normes de 1971). La tentative de Jean-Paul II pour rendre cette dispense plus rare (normes de 1980) a d’ailleurs échoué.
Jean-Paul II et Benoît XVI ont publié de fort beaux texte pour exalter le sacerdoce et le célibat (Exhortation Pastores dabo vobis du 25 mars 1992), mais le pape Wojtyla et son successeur n’ont même pas envisagé de revenir sur le fait que l’autel était désormais entouré d’acteurs liturgiques laïcs, hommes et femmes, lecteurs et lectrices, servants et servantes, ou distribuant la communion.
François enfin, quant à lui, a élargi les mesures précédentes :
- Approuvant le document final de l’assemblée spéciale du Synode des Évêques pour l’Amazonie, qui proposait qu’en l’absence de prêtres dans les communautés, l’évêque puisse confier, pour une période déterminée, l’exercice de la charge pastorale à une personne laïque à tour de rôle (n. 96). Sur quoi, l’exhortation Querida Amazonia, du 2 février 2020, a décidé que des responsables laïcs dotés d’autorité puissent présider à la vie des communautés, spécialement pour concrétiser les divers charismes laïcs, afin de permettre le développement d’une culture ecclésiale propre, nettement laïque » (n. 94 – souligné dans le texte).
- Publiant le motu proprio Spiritus Domini du 11 janvier 2021, qui a modifié le canon 230 § 1, et permis que les ministères du lectorat et de l’acolytat puissent être conférés à des femmes, plus évidemment laïcs si l’on peut dire (décision qui était d’ailleurs de pur principe, puisqu’elles en exerçaient déjà les fonctions).
Les contradictions d’une synodalité idéologique
N’est-il pas cependant contradictoire que l’on tienne tant à faire reconnaître la synodalité par des textes officiels du pouvoir romain central ? Pourquoi les Églises locales ou les communautés de terrain ne décident-elles pas d’elles-mêmes de mettre en œuvre (de mettre davantage en œuvre) cette « culture ecclésiale propre, nettement laïque »? Pourquoi du milieu des chrétiens laïcs, en fonction des besoins des communautés et des charismes de leurs membres, n’émane pas cette « pluriministérialité »?
En fait, personne n’imagine que la synodalité, vie de l’Église à la base et par la base, ne soit instituée (ou accrue) autrement que par décrets venant d’en-haut ! De fait, la centralisation tridentine, mise au service, depuis Vatican II, d’un contenu doctrinal anti-tridentin, n’a jamais été aussi absolue, avec un système ecclésiastique verrouillé à l’extrême, avec des évêques-préfets, un pape absolu, une Curie militante, des assemblées synodales et épiscopales dont les membres s’autocensurent avec une remarquable efficacité, le tout au service d’un vase clos idéologique.
À moins que le salut ne vienne justement de la synodalité, d’une vraie synodalité, entendue comme celle d’une Église, où pape, évêques, prêtres, fidèles, exercent de manière responsable, au sein d’un ordre véritable, le service de la transmission du Bon Dépôt et de sa diffusion par la mission. Bref, pour le dire nettement, on souhaite l’avènement d’une synodalité traditionnelle qui ferait craquer le carcan de la synodalité idéologique. Nous avions parlé dans notre éditorial du n. 20 de Res Novæ n. 20, de juin 2020 (https://www.resnovae.fr/un-schisme-par-demission-de-lautorite/), de la nécessité du déclenchement de crises salutaires, de crises catholiques, d’actes libérateurs, où des évêques, des prêtres, des fidèles se rendraient capables de faire le bien de l’Église.
Abbé Claude Barthe
[1] Voir une version catholique de théologie de la mort de Dieu avec Christian Duquoc, Dieu différent, Cerf, 1977 : le Dieu qui se révèle en Jésus-Christ est un Dieu fragile et mourant un « Dieu différent » de celui de la, raison et même du Dieu de l’Ancien Testament.
[2] « La théologie de la vocation aux ministères ordonnés. Vocation ou appel de l’Église », La Vie spirituelle, décembre 1998, pp. 621-640 ; « Ordonner des pasteurs. Plaidoyer pour le retour à l’équilibre traditionnel des énoncés doctrinaux relatifs à l’ordination »Recherches de Science religieuse, avril 2021, pp. 219-238.
[3] Joseph Doré et Maurice Vidal (sous la direction de), Des ministres pour l’Église, Cerf, 2001 ; Céline Béraud, Prêtres, diacres, laïcs. Révolution silencieuse dans le catholicisme français, PUF, 2007.
[4] Études, juillet 1973, pp. 129-141.
[5] Urgences pastorales. Comprendre, partager, réformer, Bayard, 2017.
[6] Peter Kwasniewski, Ministers of Christ: Recovering the Roles of Clergy and Laity in an Age of Confusion, Sophia Institute Press, 2021
NB: reprise de l’ancien article Res Novæ 20 (juin 2020) mentionné ci-dessus:
Un schisme par démission de l’autorité
Si on suppose que le schisme latent dans lequel se trouve l’Église risque de devenir un schisme ouvert par le fait d’une séparation de telle partie de l’Église, on se trompe : l’Allemagne ne fera pas plus sécession d’elle-même que ne l’avait fait la Hollande de la fin des années soixante. Pour qu’un schisme advienne, il faut, comme cela s’est produit presque toujours, que ceux qui ont fait naufrage dans la foi soient déclarés exclus de la communion par l’autorité ecclésiastique, celle des évêques, du pape. Or, et c’est tout le drame, ils ne sont plus jamais condamnés. En cela réside le schisme d’aujourd’hui.
Un schisme créé par l’abstention de condamnation
Cette abstention dans la condamnation conduit à un schisme d’une autre forme que les schismes du passé. Dans l’affaire du Synode d’Allemagne, dont l’abbé Perrot nous parle dans cette livraison, on peut malheureusement présumer que l’on cherchera des solutions assez semblables à celle qu’on a trouvées en 2018 concernant les époux de mariages confessionnels mixtes. Des représentants d’évêques favorables et hostiles à la permission pour eux de participer ensemble à l’eucharistie ont été réunis par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, pour s’entendre dire que Rome ne décidait rien et leur demandait de trouver entre eux « un accord aussi unanime que possible ». Cette abstention relève d’une sorte de démission de l’autorité ecclésiastique qui se refuse de trancher : positivement par des énoncés se référant directement ou indirectement au charisme de l’infaillibilité dans les cas où la conduite du peuple chrétien le réclame ; négativement – ce qui est en fait la même chose – en se dispensant de condamner ceux qui s’écartent de la confession de foi.
Or, la matière sur laquelle agit l’autorité apostolique est en quelque sorte la confession de foi de tous et chacun des baptisés, en paroles et en actes. Aujourd’hui, de facto, l’autorité s’abstient de jouer le rôle d’instrument d’unité (du moins d’unité au sens classique), et se présente au contraire comme gestionnaire d’une certaine diversité. Elle semble entendre son rôle comme étant de fédérer et non plus d’unir.
Il faudrait des volumes et des bibliothèques pour passer en revue les errances doctrinales publiques, avérées, confirmées, de pasteurs, de théologiens, de professeurs, de groupes chrétiens de tous ordres. Le plus grave est que l’expression libre de son sentiment en matière de foi et de morale est devenue comme une liberté fondamentale de chaque catholique. En fait, ce ne sont pas tant des hérésies que des relativisations du dogme, à la manière moderniste. Et la relativisation redouble du fait que ces contestations du Credo sont exprimées paisiblement et librement. Depuis un demi-siècle, sauf cas rares ou marginaux, plus aucune sentence d’exclusion de l’Église pour hérésie n’a été prononcée de la part des instances hiérarchiques épiscopales ou romaines. Au mieux, en certains cas, et c’est déjà heureux, il y a eu une « notification » des erreurs, comme dans le cas célèbre du P. Dupuis, jésuite, à propos d’hérésies concernant le Christ et l’Église, unique voie de salut (notification du 24 janvier 2001), auquel par ailleurs l’instruction Dominus Jesus, sur l’unicité et l’universalité salvifique de Jésus-Christ et de l’Église, du 6 septembre 2000, était une réponse.
Il y a bien eu, par le passé, des périodes de bouillonnement d’erreurs, sinon aussi graves, du moins dramatiques. Mais aujourd’hui, la diversité n’explose pas : des fidèles, des prêtres, des cardinaux, peuvent tenir des professions divergentes sur des points de foi ou de morale jadis considérés comme fondamentaux (l’indissolubilité du mariage, par exemple), tout en étant les uns et les autres toujours tenus pour catholiques. Et du coup, le dogme devient optionnel.
De l’unité de foi au fédéralisme des croyances
L’œcuménisme externe sert ainsi de moule à une nouvelle manière de confesser la foi, non plus dans l’unité, mais dans la diversité. Le cardinal Kasper, alors qu’il était Président du Conseil pour l’Unité des chrétiens, avait fait cette déclaration fondamentale qui reprenait celle de son prédécesseur Willebrands : « Nous entendons l’œcuménisme aujourd’hui non plus dans le sens de l’œcuménisme du retour, selon lequel les autres doivent se “convertir” et devenir “catholiques”. Ceci a été expressément abandonné par Vatican II. […] Chaque Église a ses richesses et ses dons de l’Esprit, et c’est de leur échange qu’il s’agit, et non pas du fait que nous ayons à devenir “protestants” ni que les autres aient à devenir “catholiques” dans le sens de la forme confessionnelle du catholicisme » (Entretien dans la revue autrichienne Die Furche, 22 janvier 2001).
Les conséquences externes d’un tel principe d’« unité » sont évidemment désastreuses pour la mission de l’Église, mais plus désastreux encore est le fait que ce principe soit appliqué à l’intérieur : ad extra, une telle démarche a pour effet premier de modifier l’être ecclésial des catholiques (la foi, le sens de la communion) et non pas celui des séparés ; ad intra, de même, il modifie l’essence catholique de ceux qui restent fidèles au Credo (leur foi devient une option) et non pas de ceux qui le transgressent. Ce qui veut dire qu’une autorité fédératrice de la diversité de croyances à l’intérieur de l’Église tend à remplacer une autorité régulatrice de l’unité dans la foi. Cette diversité tient ensemble par le fait qu’à la matrice ancienne de la regula fidei se substitue une matrice œcuménique, la revendication de la pluralité dans l’unité.
Ce phénomène d’organisation de la coexistence des opinions est un des aspects de l’osmose de la vie ecclésiale d’aujourd’hui et du fonctionnement de la société démocratique moderne, réclamée notamment par le Chemin synodal allemand. C’est d’ailleurs précisément en matière de synodalité et de conseils que la mécanique du gouvernement d’opinion s’applique le plus aisément à la vie de l’Église, comme nous l’avons déjà dit (Res Novæ n.3, novembre 2018, « À quoi sert le Synode des Évêques ? »). Les assemblées régulières du Synode entrent dans le jeu d’élaboration d’un consensus, lequel se superpose à la traditionnelle obéissance de la foi, ciment de la communion au Christ. Quand la ligne romaine était conservatrice, le consensus était, par exemple, en faveur du célibat sacerdotal (assemblée de 1971) ; lorsqu’aujourd’hui elle est devenue libérale, le consensus ouvre les sacrements aux époux adultères (assemblées de 2014 et 2015).
En outre, du point de vue institutionnel, il n’est pas besoin d’insister sur le rôle puissant joué par les conférences épiscopales dans la transmutation de l’autorité dans l’Église. Le moule des conférences épiscopales, sous prétexte de réhabiliter l’autorité des évêques face à la « centralisation » romaine, a au contraire noyé leur responsabilité personnelle de Successeurs des Apôtres dans un régime d’assemblée, de secrétariats et de bureaux. Pour autant, le centralisme ne disparaît pas, il s’accroît même. En vérité, le mode de gouvernement de l’Église, plus autoritaire aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été, rappelle celui des régimes démocratiques actuels, où le chef de l’État ou du gouvernement a un pouvoir quasi monarchique (voir : Res Novæ n. 12, octobre 2019), sauf qu’il n’est pas au service, dans l’État, du traditionnel bien commun, ni dans l’Église au service de la foi une.
La nécessité d’actes de refus concrets, de déclenchement de crises catholiques
Du coup, quand le schisme latent deviendra un jour schisme déclaré, l’exclusion ne portera pas tant sur un premier niveau, celui de l’émiettement du Credo, comme dans les fractures anciennes ; il sera une exclusion de ceux qui revendiquent une Église plurielle et affirment la relativité du dogme. Il n’y aura pas schisme entre ceux qui croient, par exemple, que le mariage sacramentel est indissoluble, et ceux qui admettent des exceptions, ou bien entre ceux qui tiennent que seuls les hommes peuvent avoir accès aux ordres sacrés et ceux qui estiment que les femmes le peuvent aussi, mais il y aura schisme entre, d’une part, ceux qui croient qu’on ne peut pas être catholique en niant tel élément relevant de la confession de foi, et d’autre part, ceux qui croient qu’on peut être catholique aussi bien en le recevant qu’en l’infirmant. Autrement dit, la rupture qui devra advenir tôt ou tard sera une séparation entre une Église catholique œcuménique et une Église catholique sans autre qualificatif.
C’est bien ce fédéralisme qu’il faudra briser pour que cette latence schismatique cesse. C’est cette coexistence contre-nature, ravageuse au maximum pour le salut des âmes, entre une ecclésialité fédérale et l’unité en Jésus-Christ qui devra être renversée. Ce qui ne peut intervenir que par l’intervention de l’Église enseignante, Pape et évêques unis à lui. Nous en sommes apparemment très loin dans la mesure où la chape d’un conformisme étouffant empêche toute velléité d’agir contre l’idéologie dominante. Or, la liberté chrétienne est comme un extraordinaire détonateur. N’y a-t-il pas plus de 5000 évêques dans le monde ? Toute manifestation expresse, par des actes concrets, du « qui vous écoute, m’écoute », émanant d’un certain nombre d’entre eux, ou d’une poignée, ou seulement de quelques unités, ne pourrait que produire un ébranlement d’une grande force.
Lorsque certains évêques – extrêmement rares il est vrai – ont déclaré clairement après la promulgation d’Amoris lætitia que rien n’était changé dans leurs diocèses respectifs en matière de discipline sacramentelle, et spécialement que l’absolution et la communion ne pouvaient pas être accordées aux divorcés « remariés » restant dans leur état peccamineux, un partage s’est fait nécessairement entre ceux qui suivaient leurs instructions et ceux qui passaient outre. La suite normale aurait dû être celle d’explications par ces évêques de leur refus de suivre une fausse doctrine, d’une prédication salutaire sur la doctrine évangélique du mariage, et de sanctions disciplinaires contre les prêtres et les fidèles contrevenants.
Dans quelque domaine ecclésiastique que ce soit, chaque « recadrage », au besoin suivi, s’il n’est pas suffisant par lui-même, d’exclusions – lesquelles sont salutaires pour les contrevenants et pour le Corps tout entier –, de prêtres ou de fidèles qui professent des erreurs manifestes, ne peut que déclencher crises, résistances, manifestations hostiles, non seulement dans l’Église particulière considérée, mais très vite au niveau de l’Église universelle. C’est au reste naturel, car chaque évêque participe à la charge commune de l’Église en vertu de l’institution divine et des devoirs de sa charge apostolique, chacun d’eux étant responsable de l’Église, ensemble avec les autres évêques (Christus Dominus, n. 6) : ce qui intéresse une Église particulière intéresse par le fait l’Église universelle. On a vu bien des fois dans l’Église un évêque condamner, au nom de son autorité de Successeur des Apôtres, et avant même que le Pape ou un concile n’intervienne, une hérésie qui se diffusait.
Le désordre qui résulterait inévitablement de l’intervention ciblée si l’on ose dire, d’un ou de plusieurs évêques au service de l’unité de la foi ne serait qu’un désordre apparent : ce serait un scandale médicinal qui, en réalité, dévoilerait le véritable scandale, celui de l’hétérodoxie installée qui gangrène le Corps tout entier. Plus que des déclarations générales, plus que des prises de position théoriques destinées à entraîner une opinion ecclésiastique, mais sans conséquence effective, ce sont des actes de refus concrets du mal et de l’erreur dont l’Église a besoin. Par exemple, dans le domaine de la défense de la liberté de l’Église, lors de l’interdiction du culte pour cause d’épidémie en de nombreux pays, on a enregistré de belles déclarations épiscopales, mais la décision des évêques du Minnesota de reprendre le culte public sans tenir compte des directives du gouverneur a eu un poids infiniment supérieur. On peut penser que si, par souci de défendre la foi et le respect eucharistique, un évêque exigeait de ses prêtres le retour à la règle de la communion sur les lèvres, l’effet serait notable, voire considérable en cas d’opposition de certains prêtres et de crise ouverte. De même s’il imposait l’orientation des célébrations vers le Seigneur. On pourrait même imaginer – il est bien permis de faire des rêves catholiques – un évêque sanctionnant les propos hétérodoxes d’un de ses confrères évêques.
Certes, faire ce type de réflexions/suppositions peut paraître vain et désespérant, tant on voit mal, dans un catholicisme sans nerfs et sans muscles que des prélats ayant charge d’âmes aient aujourd’hui la force d’âme suffisante pour assumer le déclenchement de ces sortes de crises catholiques qui les mettraient en marge de la masse de leurs confrères (et de leurs prêtres et de la masse des fidèles de leur diocèse : voir Mgr Haas, lorsqu’il était évêque de Coire). Et cependant, il n’est pas permis de douter qu’une grâce efficace du Christ ne puisse mouvoir le cœur de ceux qui ont été appelés par lui à succéder à ses Apôtres pour le salut de son Église.
Abbé Claude Barthe
« Le salut des âmes est la suprême loi »
Salus animarum, suprema lex. Après Traditionis custodes le 16 juillet 2021, ont été publiées le 18 décembre les réponses de la Congrégation pour le Culte divinà des dubia, des questions qui sont censées lui avoir été posées. Ce texte, largement commenté[1] explicite l’intention du motu proprio: abroger à terme la liturgie traditionnelle, en maintenant une tolérance provisoire et très encadrée du missel traditionnel pour ceux qui y sont encore attachés, mais en interdisant les autres livres liturgiques, spécialement le rituel et le pontifical.
Ces dispositions tyranniques et tatillonnes, qui réactivent la guerre liturgique avec un monde traditionnel vivant et important, et cela au plus mauvais moment, c’est-à-dire dans un contexte d’effondrement du catholicisme, provoquent des critiques jusque chez des prélats « progressistes ». Il n’est donc pas évident qu’elles soient parfaitement appliquées. Cependant, si l’on obéit à ces interdictions, il n’y aura plus de baptêmes ni de mariages traditionnels (sauf dans les paroisses personnelles, sous réserve de l’accord de l’évêque) et, sans aucune exception possible, il n’y aura plus de confirmations ni d’ordinations traditionnelles.
Cette loi est clairement injuste du point de vue pastoral, et aussi à cause de sa motivation doctrinale (la liturgie traditionnelle aurait cessé d’être une expression de la lex orandi : point fondamental dont nous parlerons dans la prochaine livraison de Res Novæ).
Ne pas la recevoir est donc un droit, et même, compte tenu de l’objet, est un devoir. Sur qui repose-t-il ? Sur tout le peuple de Dieu, au nom du sensus fidelium. Il est évident, en effet, que la détermination des fidèles est de la plus grande importance. Il reste que, s’agissant de baptiser, d’absoudre, de recevoir les consentements à mariage, d’extrémiser, de confirmer ou d’ordonner, ce sont les ministres des sacrements qui sont, par la force des choses, à nouveau, en première ligne.
À nouveau, parce que dans les années qui ont suivi la réforme de Paul VI, si la liturgie tridentine a survécu, c’est grâce à un ensemble de prêtres, de curés de paroisse, qui ont continué à la célébrer. Ensuite sont venus, appui décisif, Mgr Lefebvre (Mgr de Castro Mayer au Brésil) et les prêtres qu’il a (qu’ils ont) consacrés. Ce grand refus sacerdotal puis épiscopal très concret a, comme on le sait, « fait bouger les lignes ». Il a enclenché un processus de tolérance progressive puis de reconnaissance, soutenu par le cardinal Ratzinger/Benoît XVI, à l’ombre duquel se sont développées les communautés Ecclesia Dei pour le plus grand bien des âmes et le service de l’Église.
Aujourd’hui, voilà que les prêtres engendrés de la sorte et les évêques qui les soutiennent ont à assumer, sans provocation inutile, avec prudence et fermeté, soutenus par la prière et la force de la grâce, un identique grand refus. Il y va de la continuation de la lex orandi et du salut de bien des âmes.
Abbé Claude Barthe
[1]. Notamment par nous-même : Résister à une loi liturgique injuste – Le Salon Beige.
La périphérie (argentine)
devenue centre et vice-versa
Avec une fierté certaine ou toute mitigée, les Français – peut-être plus que d’autres – reconnaissent certains de leurs compatriotes dans les références citées par le pape François à l’appui de ses enseignements (le terme est-il toujours approprié ?), bien que cela doive être fortement relativisé en raison de la facture de ces textes en très grande part autoréférencés, pour ne pas dire autocentrés… On peut citer, pour le concept de périphérie comme centre d’une réforme de l’Église, Congar ; pour la critique de la mondanité et des rigidités, Lubac ; et peut-être, pour une conception particulière du sensus fidei comme lieu théologique dynamique, Chenu. On n’oubliera pas les grands frères jésuites, Lubac toujours, Teilhard de Chardin, Michel de Certeau, les considérations de ce dernier sur la sortie d’Abraham de sa terre comme exemplaire de la position de l’Église dans un monde sécularisé, annonçant l’injonction adressée à celle-ci d’être « en sortie ».
Suffit-il pour autant d’additionner ces références et d’autres, qui ont en commun d’être « conciliaires », à quelques exceptions près comme Guardini (même si la dépendance est plus revendiquée que manifeste), pour rendre compte de la pensée du pape François, de ses textes, qui sont devenus autant de balises obligatoires de la vie de l’Église, comme le déclarent les documents inauguraux du processus synodal sur la synodalité, commencé l’automne dernier ? Ce serait faire de lui un Européen, ce qu’il n’est pas. Son évident désintérêt pour le vieux continent, à l’exception de ses frontières, de ses périphéries migratoires comme Lampedusa ou Chypre récemment, en est le signe. Sauf si, dans sa logique, l’attention à ces périphéries est justement un vrai, mais curieux, intérêt pour l’Europe…
De même, scruter la figure, la posture de François, qui relève pour beaucoup – nul ne le conteste plus – d’une construction dont l’intéressé est le premier responsable, n’apporte au premier abord rien de substantiel à la résolution de cette question. Toutefois, elle n’est pas sans cohérence, loin de là, avec la réponse qu’on croit pouvoir y donner.
Une théologie du peuple à fondement péroniste
C’est évidemment vers la théologie argentine du peuple qu’il faut se tourner. On y retrouve les apports européens signalés plus haut, mais intégrés dans une argumentation et une praxis qui, quelles que soient les nuances, entrent de plain-pied dans la famille des théologies de la libération.
Nous appuyant sur un article un peu ancien mais auquel l’actualité conserve sa pertinence, nous voudrions éclairer un trait important, peut-être le plus fondamental, la pierre d’angle même de la pensée bergoglienne. Intitulé « Aux sources culturelles de la pensée du pape François », cet article[1] est un long commentaire, à la fois laudatif et critique, tant de la pensée de François que de la théologie du peuple, à travers la présentation d’un ouvrage de Juan Carlos Scannone, dont le sous-titre est « les racines théologiques du pape François ». Rappelons, pour en indiquer l’intérêt, que le défunt jésuite argentin Scannone fut le professeur de Jorge Mario Bergoglio puis, celui-ci devenu François, son commentateur fervent.
On peut résumer la genèse de la théologie du peuple (et, selon Scannone, de la pensée de Bergoglio) ainsi : l’Église latino-américaine a reçu du concile Vatican II principalement la constitution pastorale Gaudium et spes, en l’enrichissant de la thématique de la pauvreté que les Pères conciliaires, pourtant encouragés par Jean XXIII au commencement, avaient oubliée et qui ne figure qu’à la marge dans les documents finaux. Plus encore, cette thématique fut placée à la source et au centre de la réflexion et ce, non d’une manière statique (ce qui n’aurait pu avoir que des conséquences conservatrices, caritatives), mais selon une dynamique radicale et globale de libération. C’était, selon ses promoteurs, interpréter, inculturer Gaudium et spes, mais aussi les enseignements de Lumen Gentium sur l’Église comme peuple de Dieu, l’inculturation dont on parle ici ayant pour un de ses axes majeurs l’association – jusqu’à la tentation de les superposer – de la notion biblique et théologique de peuple de Dieu et de la réalité sociale, économique, politique du peuple dans les sociétés latino-américaines. On retrouve d’ailleurs cette polysémie ambiguë dans les documents de François.
Cela, qui est commun à toutes les théologies de la libération et qui assez bien connu, a trouvé une traduction spécifique en Argentine ; et c’est ce point-ci qui nous intéresse proprement : En effet, alors que certains théologiens latino-américains insistaient sur les dimensions économiques et politiques, avec une influence du marxisme patente, ceux d’Argentine préférèrent une perspective plus sociologique, historique et culturelle. Dans ce cadre, fut entreprise une « relecture volontairement positive de l’expérience historique de l’Argentine » (Guibal, p.694), selon un prisme qu’on qualifiera de populiste, au sens technique que la théorie politique lui donne : Une histoire où, depuis le 17ème siècle, les aspirations du peuple ont été reconnues et portées par des « héros (…) revendiquant pour tous, et notamment pour les plus modestes, une égale dignité » (id.). Au fil de cette histoire, « l’esprit évangélique de service et de réconciliation l’aurait en fin de compte emporté sur les conflits et les divisions, une réalité originale aurait émergé, celle d’un peuple nouveau advenant à la conscience de soi et apprenant à prendre en charge son histoire à sa manière spécifique. De l’artiguisme au péronisme en passant par l’irigoyénisme, le « caudillisme » argentin lui-même témoignerait de la recherche d’une unité organique entre les dirigeants et le peuple dont ils émanent ainsi que d’une conscience politique mue par une volonté générale de justice et de paix. » (Guibal, p.693) Peut-être, pour ne pas en rester au terme générique et souvent péjoratif de populisme, mais avouant une ignorance assez complète de l’histoire politique argentine, et en tenant compte qu’en Europe le terme de caudillo renvoie trop directement à la figure et au régime du général Franco, doit-on parler d’un fondement péroniste de la théologie du peuple. Telle semble être, en tout cas, la caractéristique propre de celle-ci.
L’histoire ne s’arrêtant pas, et les sociétés évoluant, le regard vers le passé ne saurait suffire. Toutefois, la grille de lecture, poursuit Scannone, demeure. Le peuple d’hier s’est diversifié en périphéries multiples : Dans le passé, l’enjeu fut la rencontre et le « métissage politico-culturel » de deux populations et de deux races ; aujourd’hui la rencontre est plus vaste, plus ouverte : « la culture latino-américaine d’aujourd’hui est en quête d’une « synthèse vitale » entre trois imaginaires en tension : celui d’une tradition catholique inculturée, celui de la liberté moderne et celui des altérités postmodernes. » (Guibal, p.695, note 32).
Dans un article de 2013 paru dans la revue jésuite romaine La Civiltà Cattolica, Scannone avait montré une incapacité à poser une limite au-delà de laquelle l’altérité postmoderne considérée n’est plus une périphérie au sens de la théologie du peuple, laissant ainsi présager un débordement par toutes les revendications : « Il y a une ouverture à de nouvelles propositions, comme la philosophie interculturelle (Fornet-Betancourt, Dina Picotti), la philosophie du genre et d’autres encore. »[2] La mention de la philosophie du genre attire évidemment l’attention et renvoie à des propos ou actes de François vis-à-vis ou en faveur des homosexuels et des transsexuels. Moins connue, la référence à l’afrocentrisme de Dina Picotti, qui est une critique radicale de l’histoire officielle argentine, sans que cela paraisse devoir pour Scannone relativiser le récit péroniste, en déboulonner la statue (puisque le livre de Scannone est postérieur à son article), a pour nous le mérite de rappeler une faiblesse majeure des théologies de la libération : Étant essentiellement des praxis, leur cohérence interne ne présente pas grand intérêt. Ce qui, paradoxalement, fait aussi leur force, celle de ne pas prendre en compte les critiques intellectuelles qui leur sont adressées.
Un pape-caudillo
Il serait fructueux, pensons-nous, de relire à l’aune de cette ligne fondatrice de la théologie du peuple, une à une et surtout dans leur logique globale, bien des initiatives de François.
À commencer par la posture qu’il a prise : Jorge Mario Bergoglio, élu au Siège de Pierre, a endossé le rôle de ce héros argentin rencontrant le peuple et s’en faisant le porte-voix. À une nuance près, et elle est de taille : l’amplitude universelle qu’il lui donne. L’image d’un François convivial, proche, pauvre, boudant les centres historiques de l’Europe (la France notamment) mais se rendant à ses périphéries (Lampedusa) ou au lieu de son élaboration nouvelle (instances européennes de Strasbourg), participe de cette logique. Même la dimension plus miséricordieuse que morale, plus spirituelle et pastorale que dogmatique – nous reprenons ici, telles quelles, certaines oppositions présentes dans le discours bergoglien – ne fait à certains égards que renvoyer à l’anti-élitisme démagogique et à l’anti-intellectualisme qu’on trouve dans le populisme historique argentin et dans l’écriture à tout le moins idéalisée de l’histoire nationale qu’en fait la théologie du peuple.
Une telle relecture éclairerait également les idées avancées par François. Au premier plan, on mentionnera le rôle dévolu aux périphéries, jugé irremplaçables, mais avec une imprécision sur ce qu’elles sont. Le concept de périphérie paraît s’ouvrir à des catégories de plus en plus éloignées de la pauvreté au sens classique (minorités sexuelles ou, selon Laudato si, la création elle-même). Ou bien il semble remplacer ce qu’on pensait auparavant comme étant au-delà des frontières de l’Église (protestants lors de l’anniversaire de Luther, musulmans lors de la déclaration d’Abu Dhabi). Le tout avec pour horizon une fraternité ouverte et inclusive, un métissage de tous ordres. Sur le plan temporel, ne peut-on voir dans l’injonction faite aux populations des pays riches d’accueillir les migrants et de former avec eux une communauté renouvelée se partageant les fruits de la terre qui appartiennent à tous[3], un miroir du « métissage politico-culturel » réussi que serait l’Argentine ?
Est-ce vraiment une histoire réussie ? Ce n’est pas sans importance, mais nous sommes incompétents à le décider. Quoi qu’il en soit, quelques questions doivent être posées :
– Est-il pertinent de transposer l’expérience argentine à toutes les situations ? Cela paraît à l’évidence buter sur des réalités historiques et culturelles : le héros populiste argentin ne correspond pas à des traditions culturelles et politiques comme celles de la France, des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni, de Venise et autres cités, etc. La rencontre entre deux populations, cultures et religions, a pris aussi la forme de la résistance des pays chrétiens du centre de l’Europe à la poussée militaire ottomane. Le prisme argentin paraît ainsi réducteur, s’il prétend se faire le critère du présent et de l’avenir de tous, en faisant table rase des passés particuliers. Alors, paradoxalement, loin de s’y opposer comme elle le prétend et le pense peut-être sincèrement, l’universalisation de la théologie du peuple par François devient une des faces du mouvement uniformisateur de la globalisation régnante.
– La polysémie du terme peuple doit être clarifiée : la théologie du peuple s’en est dispensée en arguant de l’évangélisation de longue date et en profondeur de l’Argentine. Ce ne peut être le cas après la vague de sécularisation, d’agnosticisme et de matérialisme, et celle de l’islam, qui ont déferlé ces dernières décennies. On ne peut pas ou plus superposer, dans la plupart des sociétés, peuple de Dieu et peuple ; et moins encore selon la perspective argentine où la périphérie est vue comme le cœur irriguant de sa vie le reste du corps social.
– De même, pour le gouvernement, on ne saurait associer, peut-être même pas de loin, la fonction du pasteur de l’Église et celle du caudillo du peuple, pour diverses raisons, dont la première et principale est que le second est l’émanation du peuple – ou se prétend tel -, peuple d’où il tire sa légitimité, alors que le souverain pontife est le vicaire du Christ, selon un ordre descendant. Mais il est vrai que, depuis l’annuaire pontifical de 2020, « Vicaire du Christ » a été rétrogradé en bas de page au rang de « titre historique » ; et que le processus synodal sur la synodalité veut nous persuader que le sensus populi[4] est premier et guide jusqu’aux pasteurs eux-mêmes.
Abbé Jean-Marie Perrot
[1] Francis Guibal, « Aux sources culturelles de la pensée du Pape François », in Ephemerides Theologicæ Lovanienses 93/4 (2017), pp. 685-708. Pour l’ouvrage recensé : Juan Carlos Scannone, La théologie du peuple. Les racines théologiques du Pape François, traduction française mai 2017, éditions Lessius, 270 p. Francis Guibal en a été le traducteur et le préfacier.
[2] J.C. Scannone sj, « La filosofia della liberazione », in : La Civiltà cattolica, tome 3920, 6 avril 2013, pp.105-120
[3] « Chaque pays est également celui de l’étranger, étant donné que les ressources d’un territoire ne doivent pas être niées à une personne dans le besoin provenant d’ailleurs. » (Fratelli tutti, n°124).
[4] On reprend à dessein une variante de la formule classique sensus fidelium, promue par un membre éminent de la galaxie bergoglienne : Victor Manuel Fernández, « El ‘‘sensus populi’’ : la legitimidad de una teologia desde el pueblo », in : Revista Teologia, tomo XXXIV, n°72, 1998, pp.133-164.