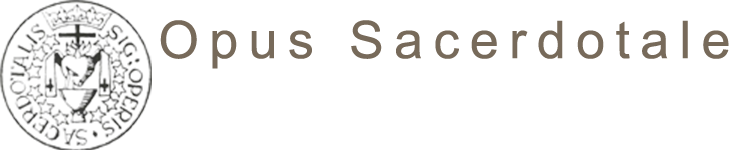Res Novæ déc. 2021
Évêques de France : la capitulation
Les évêques de France ont donné un étrange spectacle, à Lourdes le mois dernier : secoués par des scandales nés de crimes infâmes, sous la pression maximale de l’« opinion », ils ont eu une attitude et pris des décisions dont les conséquences seront immenses quant à leur propre perte de dignité et de crédibilité, et quant à l’opprobre qui pénalisera, plus encore qu’elle ne l’est déjà, la mission de l’Église[1].
À l’origine a été l’incurie d’un certain nombre d’entre eux : informés de crimes sexuels sur des mineurs commis par certains de leurs prêtres, ces évêques ont négligé d’enquêter et de sévir administrativement ou de les faire juger et condamner par leurs tribunaux ecclésiastiques (soulignons que là est leur faute, et non dans le fait ne pas les avoir dénoncés à la justice pénale de la République, laquelle avait, si elle le désirait, toute possibilité de s’en saisir ensuite[2]). Ils ont traité de ces affaires comme ils avaient l’habitude – laxiste – de le faire pour les autres conduites scandaleuses de clercs contre la chasteté, c’est-à-dire en les éloignant du lieu de leur péché. Pour pallier ces déficiences, une disposition de la constitution Pastor Bonus du 28 juin 1988, réaménageant la Curie romaine, décida que les delicta graviora, (les délits les plus graves concernant les sacrements de l’Eucharistie et de la pénitence ainsi que les délits contre les mœurs commis par un clerc avec une personne mineure[3]) étaient de la compétence de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi : celle-ci peut évoquer la cause ou la laisser traiter sous sa tutelle par le tribunal du diocèse (ou d’un institut), la CDF ordonnant le plus souvent un procès par voie administrative (possibilité de prononcer le renvoi de l’état clérical par décret extra-judiciaire ouverte en 2010)[4].
Mais, deuxième faute, une série d’affaires de ce type étant portées à grand fracas devant le tribunal pénal et celui de l’opinion, les évêques de France, après ceux d’Allemagne et d’autres pays, se sont jetés dans un tourbillon meaculpiste. Ils ont laissé le soin à une « Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église » (CIASE), présidée par Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d’État, le soin d’investiguer en ce domaine sur une période de soixante-dix ans, de 1950 à nos jours. En fait, l’appel à témoignages a permis de nouer 6 471 contacts concernant des plaintes : 3 652 entretiens téléphoniques, 2 459 courriels et 360 courriers, mais seulement 153 auditions de personnes plaignantes, , puis avec des méthodes d’évaluation fondées sur des sondages, elle a extrapolé à 330.000 personnes, qualifiées non de plaignantes mais de victimes de clercs, religieux et laïcs au service de l’Église depuis 1950, et le nombre des prêtres et religieux criminels entre 2900 et 3200. Cette extrapolation donne des mœurs ecclésiastiques en notre période d’affaissement moral une image assurément exagérée en ce qui concerne les crimes considérés. Cependant les seules plaintes entendues par la commission Sauvé et les affaires jugées en matière de pédophilie laissent penser qu’il existe bien d’autres atteintes à la chasteté cléricale, dont on ne parle pas parce qu’elles ne sont pas considérées par la justice comme des délits ou des crimes, qui accompagnent classiquement les périodes de décadence ecclésiastique.
Le rapport de la CIASE, au ton moralisateur et prétentieux, est devenu, comme prévisible, un machine infernale entre les mains des médias. Persuadés que « le monde » exigeait une de ces repentances théâtrales dans l’air du temps, dévorés par un repentir d’autant plus exigeant qu’il était indéterminé, les évêques ont adopté l’attitude suicidaire qu’on leur intimait de prendre. Ils l’ont fait spécialement sur deux points, liés l’un à l’autre.
Une abdication du droit
Le mot d’ordre était d’indemniser les victimes, ce qui va conduire à la ruine de bien des diocèses, pour la plupart déjà exsangues, puisque le montant total des réparations qu’il faudrait verser aux victimes a déjà été estimé, on ne sait trop comment, en millions d’euros.
Cette notion d’indemnisation des victimes d’actes pédo-criminels manque pour le moins de clarté quant à son origine et sa signification. C’est aux États-Unis, à partir de la fin des années 1980, que la justice civile a rendu les diocèses responsables en les condamnant au versement d’indemnités parfois faramineuses. Ensuite, dans bien des pays, les épiscopats ont d’eux-mêmes organisé des indemnisations. Elles sont conçues comme des sortes de punitions collectives que le monde inflige à l’Église coupable.
Mais elles n’ont qu’un lien ténu avec les usages civils et canoniques. La jurisprudence française a tardé à connaître la réparation des dommages moraux, le pretium doloris, d’une douleur non physique mais morale. Si la Cour de Cassation a admis que la douleur impliquait une réparation dès 1946, le Conseil d’État ne l’a fait qu’en 1961. Cette répugnance tenait à un principe voulant que la douleur ne soit pas monnayable, principe que notre civilisation mercantiliste méconnaît. Cependant dans tous les cas de réparation de dommage, c’est le coupable du crime qui est astreint à réparation. Quant au droit canonique, il connaît le principe de la réparation du dommage (canon 128) et l’organise dans son droit pénal (canon 1729), mais l’Église n’a plus guère de moyens de coercition pour faire appliquer de telles décisions, et dans le cas des crimes sexuels qui nous occupe, la réparation qu’elle ordonnerait viendrait s’ajouter aux indemnités civiles déjà obtenues ou qui vont l’être.
La CIASE, pour sa part, s’en tient à l’esprit de l’époque. Son rapport pose trois principes, avalisés par la Conférence des Évêques, l’Église doit
1/ Mettre en place « une procédure de reconnaissance des violences commises, même prescrites. »
2/ Reconnaître sa responsabilité « systémique » dans ces violences.
3/ Et donc « indemniser les préjudices subis »
Sous l’effet de panique, on en vient à abdiquer le droit, notait il y a quelques années l’abbé Bernard du Puy-Montbrun, doyen émérite de la faculté de droit canonique de Toulouse, extrêmement sévère vis-à-vis de l’incompétence épiscopale[5]. Il reste tout de même qu’offrir une réparation implique de qualifier le criminel et de désigner ses victimes, ce qui nécessite normalement un tribunal compétent. La CIASE n’en a cure et a indiqué à la CEF la marche à suivre : créer « un organe indépendant, extérieur à l’Église », qui aura la mission de recevoir les plaintes des victimes et de les faire indemniser par l’institution.
C’est ce véritable monstre juridique, l’INIRR, Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation qu’a créé la CEF « avec les moyens financiers nécessaires » : d’une part ce sont des plaignants pour affaires non jugées qui seront déclarés aptes à recevoir des réparations pécuniaires, et d’autre part, c’est une personne morale indéterminée (l’Église, l’Église qui est en France), qui sera condamnée à les verser en lieu et place des coupables (prédateurs et s’il y a lieu supérieurs coupablement négligents). Du coup, cette commission sera de facto pourvue d’une juridiction née par génération spontanée, tiendra lieu de tribunal jugeant sans débats contradictoires et émettant des décisions qui ne seront susceptibles d’aucunes voies de recours.
L’Église de France dans son ensemble (qui n’est aucunement une personne juridique au regard du droit de l’Église ou du droit français), s’acquittera de cette indemnisation par des fonds qui lui viendront des diocèses, spécialement par la vente de biens immobiliers, et ce, irrégulièrement au regard du droit français, car ils sont la propriété des associations diocésaines, dont les statuts types stipulent qu’elles ont pour but « de subvenir aux frais et à l’entretien du culte catholique. » Les recours devraient fleurir. Et avant cela, il loin d’être acquis que les conseils diocésains pour les affaires économiques et les collèges des consulteurs, dont le consentement est nécessaire (canon 1292), accepteront d’aliéner les bijoux de famille.
Une Église non pas sainte, mais pécheresse
L’autre point, bien plus grave, est d’ordre ecclésiologique : si l’Église en effet doit payer, c’est qu’elle est coupable.
La CIASE demandait de « reconnaître la responsabilité systémique de l’Église » et d’examiner à ce titre « les facteurs qui ont contribué à sa défaillance institutionnelle ». Elle a étudié « les dévoiements, les dénaturations et les perversions auxquels ont donné prise la doctrine et les enseignements de l’Église catholique, susceptibles d’avoir favorisé la survenue des violences sexuelles ». Ces dénaturations se résument, selon elle, au « cléricalisme » fustigé par le pape François. Ce cléricalisme est essentiellement : « l’excessive sacralisation de la personne du prêtre » et « la survalorisation du célibat et des charismes chez le prêtre ». Autrement dit, des prêtres, perturbés par l’obligation du célibat, ont abusé de leur position dominante sur des mineurs pour perpétrer leurs crimes. Quoi qu’il en soit de la valeur de ces affirmations, pour en déduire la culpabilité de l’Église, il faut que coupable elle soit en quelque manière dans l’imposition du célibat et l’organisation d’une cléricature au-dessus du laïcat. La CIASE a d’ailleurs noté que certains textes de la Tradition, comme le Catéchisme de l’Église Catholique, pouvaient avoir « malheureusement » entretenu un terreau favorable, celui de « la vision excessivement taboue de la sexualité. »
La CEF a adopté la conclusion de la CIASE – « responsabilité systémique de l’Église » –, avec des attendus apparemment plus flous : « Des fonctionnements, des mentalités, des pratiques au sein de l’Église catholique ont permis que ces actes se perpétuent et ont empêché qu’ils soient dénoncés et sanctionnés » (CEF, 5 novembre 2021). On passe donc de fonctionnements dans l’Église permettant le crime, à la responsabilité de l’Église quant à ces fonctionnements, de l’Église fondée par Jésus-Christ, son Épouse sainte !
Le P. Yves Congar parlait d’or avec le titre de son ouvrage paru en 1950 : Vraie et fausse réforme dans l’Église. Les vraies réformes de l’Église, d’une Église sainte en elle-même mais composée de pécheurs, ont été des entreprises de redressement de la papauté, de l’épiscopat, de lutte contre la corruption des clercs, de retour à l’exigence des Béatitudes, de rénovation disciplinaire, bref de retrait de la corruption du monde pécheur pour se convertir et pour le convertir (Jn 17, 16, 18). Le retour exigeant à la pureté doctrinale et de mœurs du clergé a toujours été la colonne vertébrale des vraies réformes dans l’Église. Mais voilà que celle qui a été lancée depuis un demi-siècle, et qui semble aujourd’hui connaître une sorte d’apothéose, non seulement n’a pas corrigé les mœurs du clergé, mais aboutit pour finir à la mise en cause de son identité surnaturelle et à faire de l’Église une pécheresse. N’est-ce pas plutôt cette prétendue réforme qui est peccamineuse ?
Abbé Claude Barthe
[1] Un certain nombre des développements qui suivent s’inspirent de la « Lettre ouverte de l’abbé Michel Viot aux prêtres de France à propos de la réception par la Conférence des Évêques du rapport de la Ciase », Salon beige, 3 décembre 2021.
[2] Certes, le nouveau Code de Droit canonique n’a pas retenu le privilège du for ecclésiastique (qui voulait que les clercs devaient être jugés par les tribunaux ecclésiastiques, canon 120 de l’ancien CDC), mais les évêques, et les tribunaux qui émanent d’eux, restent en priorité les juges de leurs clercs.
[3] Soit de moins de 16 ans avant le motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, du 30 avril 2001, de moins 18 ans après.
[4] À noter que le délai de prescription pour les crimes sexuels contre les mineurs est, depuis 2010, de 20 ans, sous réserve du droit la Congrégation pour la Doctrine de la Foi de l’allonger au cas par cas.
[5] « Agressions sexuelles dans l’Eglise : séisme et effacement du droit », Smart Reading Presse, 14 Sep 2018.
Communautés nouvelles et communautés nouvellement traditionnelles
La crise morale que connait l’Église de France suite à la « découverte » du comportement criminel de certains de ses ministres n’est pas en soi une surprise si l’on examine le relâchement éthique général, la crise de la théologie morale, la naïveté coupable de beaucoup à l’égard de la réalité du péché. Certes il y a toujours eu des dévoiements possibles de cette réalité de grâce que constitue la paternité spirituelle du prêtre, liés à une inintelligence de la pédagogie divine, une inculture doctrinale, un manque de profondeur spirituelle ou à une volonté perverse et peccamineuse. Mais nous sommes aussi dans une période où les scandales liés aux abus sexuels, aux abus de pouvoirs ou aux abus spirituels sont dénoncés et décrits. Il y a une littérature surabondante. Je retiens la synthèse descriptive et éclairante de la journaliste Céline Hoyeau, La trahison des pères. Emprise et abus des fondateurs de communautés nouvelles (Paris, Bayard, 2021). C’est aussi l’occasion de relire l’histoire religieuse contemporaine, la crise de l’Église, la génération Jean-Paul II avec l’apparition non seulement des communautés dites nouvelles mais aussi d’un courant minoritaire, certes, mais qui se renforce et qui constitue une réalité fervente et créative dans ses modes d’agir et de témoigner, à savoir les fidèles attachés à la liturgie traditionnelle.
Sur la crise en elle-même, il existe aussi beaucoup d’excellentes descriptions, confessionnelles ou non, je pense particulièrement aux travaux de Guillaume Cuchet (Comment notre monde a cessé d’être chrétien. Anatomie d’un effondrement, Paris, 2018) ou de Jérôme Fourquet (L’archipel français, Paris, 2019), qui consacre un premier chapitre à l’effondrement du catholicisme). Je note que cet effondrement avait été annoncé par Charles Péguy, mort en 1914, et par Georges Bernanos, mort en 1948. La condition nouvelle de la foi catholique dans le monde moderne a aussi été décrite et analysée par saint John-Henry Newman (1801-1870) et par Gilbert-Keith Chesterton (1874-1936). Ou plutôt ces écrivains en donnent la raison proprement théologique, à savoir une ignorance grandissante de l’événement chrétien. Quant aux conséquences, je n’ai pas besoin d’y revenir, puisque notre ministère de prêtres se déploie dans ce contexte bien particulier et assez nouveau (« nos misères ne sont plus chrétiennes ! », pour reprendre l’expression de Charles Péguy).
Communautés nouvelles comme réponse à la crise…
Dans ce contexte, il nous a été cependant annoncé le printemps de l’Église, comme une nouvelle Pentecôte. Reconnaissons que les communautés nouvelles (beaucoup d’origine charismatique, mais pas toutes) ont permis à de nombreux catholiques, prêtres et fidèles, de trouver une réponse existentielle à la radicalité antichrétienne de la modernité puis de la postmodernité : le refus d’hériter, le meurtre du père, l’illusion que chacun doit construire son identité et non plus la recevoir (favorisant l’émergence de nouvelles générations sinistres de dépressifs festifs), la nécessité d’élaborer seul un projet de vie sans matériaux ni modèles (le héros et le saint d’après Bergson), mais en totale dépendance des phénomènes de mode, avec, chez certains progressistes catholiques, la mise en demeure d’adapter le christianisme en vue de son amélioration (autant vouloir améliorer le nord magnétique, disait encore Péguy)… Dans ce contexte, les communautés nouvelles ont constitué une planche de salut par un double aspect : la contestation prophétique et spirituelle (face à un prophétisme contestataire et politique de la gauche chrétienne), donc identitaire et un exemple de paternité offerte à une génération sans père (et sans repère !). Il y avait aussi la reproduction d’un modèle bien connu dans l’Église : l’apparition de nouvelles familles religieuses autour d’un fondateur porteur pour l’Église d’un charisme, d’une grâce gratis data, une nouvelle manière de vivre l’Évangile qui attire, rassemble et constitue une nouvelle famille religieuse qui regroupe de nombreux baptisés avec différents degrés d’engagements Ces nouvelles communautés, ont adopté pour certaines une forme d’organisation originale avec une vie fraternelle menée par différents états de vie (hommes et femmes, familles et célibataires…). Fondées pour la plupart par des laïcs, elles se réclamaient du Concile (ce qui est douteux, puisque le Concile a plutôt canonisé le modèle de l’Action catholique, non celui de laïcs vivant comme des moines…). Ajoutons un attachement affirmé à la personne du Saint-Père, une dimension mariale explicite, une vie communautaire et apostolique centrée sur la liturgie (de préférence orientale…) et une contestation forte de la sécularisation.
… mais crise des communautés nouvelles
Comment expliquer la crise que toutes connaissent aujourd’hui ? Ces déviances qu’elles ont engendrées et favorisées sont aujourd’hui bien connues : référence unique au « Père » (le fondateur restant souvent trop longtemps le supérieur), sentiment entretenu que face à la crise on représente l’Église dans son expression la plus pure, alors que l’on n’est qu’une communauté ecclésiale, certitude de constituer la petite phalange des saints des derniers temps et d’offrir une synthèse du meilleur de la tradition spirituelle de la chrétienté, confusion entre le for interne et le for externe…
Du coté des fondateurs, et dans la doctrine enseignée et communiquée, on trouve généralement ce que j’appelle un « néo-quiétisme » : les expériences fortes spirituelles, la certitude d’être l’instrument de Dieu pour établir dans l’Église une nouvelle voie surnaturelle, la fascination pour la toute-puissance que l’on exerce sur les membres, via l’observation des conseils évangéliques (pourtant l’objet de simples promesses ou de vœux privés…) dont on régule soi-même l’application, l’adulation dont on fait l’objet… vous poussent petit à petit à excuser voire à légitimer un comportement contraire au 6e et au 9e commandement. Le phénomène de l’emprise semble alors autoriser des agissements délictueux voire criminels.
Il faut aussi évoquer la responsabilité propre des membres de ces communautés : une confiance dévoyée, un subjectivisme dominant et une affectivité envahissante, l’oubli de la dimension objective et normée des règles de développement d’une vie spirituelle authentique, l’ignorance enfin de la tradition de l’Église, de sa doctrine comme de sa spiritualité, au profit d’une gnose à la fois élitiste et immorale… Difficulté à prendre ses distances par rapport à quelqu’un qui semble avoir été auprès de vous l’instrument de Dieu pour la conversion, pour une expérience spirituelle forte, un réveil ou une rencontre déterminante… Refus de voir chez son maître des défauts ou des limites. Or c’est là par rapport à une personne ou par rapport à une communauté un point de passage obligé : la déception, moment essentiel pour ne choisir que Dieu seul, pour ne vivre que pour Dieu seul. Cela entre dans le cadre plus général des purifications actives et passives de toute vocation à une authentique vie spirituelle et théologale. Citons le témoignage d’un religieux membre d’une fondation récente à propos de son fondateur : « C’était vraiment très beau mais je regardais un film dans lequel je n’étais pas présent, en tant que personne qui s’interrogeait. En quoi cela m’invitait-il à la conversion ? Comme jeunes religieux, nous n’avions pas le mode d’emploi pour savoir comment faire ensuite, avec la complexité de nos vies personnelles […] Ces fondateurs ont éveillé quelque chose de profond du point de vue de la foi mais ils n’ont pas été capables d’accompagner leurs disciples et de leur donner les moyens de la vivre par eux-mêmes, de vivre l’expérience spirituelle de la nuit, que traverse tout religieux à un moment de sa vie, car eux-mêmes n’étaient pas construits » (Hoyeau, p. 174-175).
Il y a enfin la responsabilité des pasteurs de l’Église, garants de la rectitude doctrinale et de la fidélité de leurs diocésains à la Tradition. On doit constater un manque de clairvoyance d’abord dans le refus puis dans l’instrumentalisation de ces communautés, toujours à cause de ce manque d’enracinement dans la Tradition et d’une claire intelligence de l’identité catholique, même si on peut comprendre la nécessité pour eux d’accueillir ces nouvelles vocations fournissant quelques forces vives pour les tâches du ministère compensant en petite partie l’érosion du clergé diocésain et des communautés religieuses plus anciennes et qui constituaient aussi comme le dernier rempart, la chance ultime de ne pas avoir à reconnaître l’existence, la fécondité, la pérennité d’un autre courant doctrinal et spirituel dans l’Église, à savoir la mouvance Ecclesia Dei ou Summorum Pontificum.
Le renouveau par la tradition
C’est ici que la liturgie traditionnelle peut représenter, avec tout ce qui la constitue, une chance de renouveau pour ces communautés, comme pour toute l’Église. La vie de l’Église repose sur un triptyque : la liturgie, le catéchisme, la mission. Même si la réalisation de ce programme pastoral et spirituel semble pour l’instant légèrement entravée, nous gardons notre liberté de contestation prophétique puisque la légitimité de ce que nous sommes et de ce que nous représentons est incontestable et qu’il existe dans l’Église un droit à la critique constructive, à partir du moment où aucune vérité révélée et enseignée infailliblement par le Magistère n’est contestée… Dans ce contexte, il n’y a pas de spiritualité « tradie » mais seulement un droit et une nécessité vitale de défendre un patrimoine spirituel qui appartient à toute l’Église. De plus, s’il y a une pluralité de spiritualités dans l’Église, la liturgie est la spiritualité de l’Église, D’où l’importance d’une liturgie de référence, une missa normativa que constitue ce que nous appelions naguère la forme extraordinaire du rite romain, qui est la garantie de l’orthodoxie. Le caractère « objectif » de la liturgie tridentine (cf. Claude Barthe, Histoire du missel tridentin et de ses origines, Versailles, 2016) et le fait qu’elle soit le fruit d’un développement homogène à travers l’histoire, tout en préservant le continuum vital avec les Pères de l’Église et les temps apostoliques, préservent les pasteurs et les fidèles de toutes les dérives dont nous venons de parler. Cet attachement doctrinal et missionnaire a toute sa place dans la nouvelle évangélisation, à moins que l’on veuille éliminer un groupe de fidèles, non en raison de ce qu’il croit ou de ce qu’il fait, mais en raison de ce qu’il est. Le cléricalisme n’est rien d’autre que le dévoiement de l’authentique paternité spirituelle que doivent exercer les prêtres dans l’Église au profit des fidèles : Le rôle du père est d’introduire son fils dans la réalité, dans l’ordre objectif des choses, lui permettant de faire sien de manière subjective, de s’approprier pour se construire, l’ordo sapientiae et amoris de la Révélation chrétienne. Pour le fils, le père n’est pas une toute-puissance mais bien le serviteur de ce qui est plus grand que lui, réalité que le fils est appelé à son tour à aimer et à servir pour être libre. Or la liturgie traditionnelle prédispose et conduit à cette attitude spirituelle de pauvreté et de service par son hiératisme, son objectivité, sa pérennité. Le prêtre qui célèbre disparaît littéralement par l’orientation de l’action liturgique et le silence.
Voilà pourquoi la liturgie traditionnelle peut être pour ces communautés un gage de renouveau, de redressement, de réforme. En empruntant ce chemin, avec toute l’affection filiale dont elles sont capables, elles manifesteront aux yeux de nos pasteurs leur liberté dans l’Esprit en adoptant le plus sûr moyen de conversion er de générosité missionnaire. Le pape François a affirmé à ses confrères jésuites slovaques le 12 septembre dernier qu’il ne fallait pas avoir peur de la liberté dans l’Église. A nous, et à ces communautés, de lui montrer la nécessité de rompre avec toutes ces mesures restrictives et paralysantes !
Fr. Laurent-Marie Pocquet du Haut-Jussé sjm