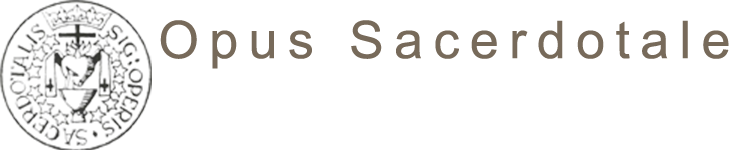La liturgie – Prof. Shaw (entretien avec Paix Liturgique août 2021, lettres 813-817)
La Lettre de Paix liturgique
Lettre 813 du 12 août 2021
| LA NOTION DE LITURGIE
PREMIER ENTRETIEN AVEC LE PROFESSEUR JOSEPH SHAW |
Alexander Joseph Ranald Shaw, 48 ans, professeur de philosophie médiévale à Oxford, père de 6 enfants, membre de la Société royale des Arts, est un des personnages principaux de la défense de la messe traditionnelle en Grande-Bretagne. Il est le président actuel de la célèbre Latin Mass Society of England and Wales, l’Association pour la Messe en latin d’Angleterre et du Pays de Galles, un organe historique du grand refus de la messe de Paul VI, fondée en 1965 par le romancier Evelyn Waugh, Sir Arnold Lunn et Hugh Ross Williamson, et toujours particulièrement active. Joseph Shaw fait aussi partie des signataires de la Correctio filialis adressée en 2017 au Pape François après l’exhortation apostolique Amoris lætitia du Pape François.
Joseph Shaw a donné, lors de la Rencontre Summorum Pontificum du 23 octobre 2020, à Rome, une conférence sur le concept de tradition en liturgie, et il a bien voulu délivrer également ses propos au cours d’entretiens avec Paix liturgique.
I – Vraie et fausse tradition dans la liturgie
Dans cet entretien Joseph Shaw distingue entre une conception prémoderne de la tradition et sa conception moderne, qui est celle de la réforme qui a suivi Vatican II. Comme l’avait montré Jean de Viguerie dans Les deux patries (DMM, 1998), il est des notions qui, au sein de la modernité, prennent des sens différents. Notre titre évoque le célèbre livre du P. Congar, Vraie et fausse réforme dans l’Église, dans lequel Yves Congar donne précisément au mot réforme une tonalité autre que celle de la réforme au sens ecclésiastique traditionnel.
Q : Pourriez-vous nous présenter le but de votre étude sur la tradition en liturgie ?
R : Le concept de la tradition et son autorité sont immense, et l’on assiste aujourd’hui à des débats en liturgie, en théologie, en droit canon qui tous s’y réfèrent de près ou de loin. Il s’agit effectivement de l’un des problèmes fondamentaux de notre époque. C’est au regard de cette considération que je voudrais ici souligner la modestie de mon projet : il ne cherche qu’à indiquer quelques ressources propres à la liturgie sous son aspect historique ; celles-ci m’ont aidé à tirer au clair un problème précis du débat autour de la liturgie. Que ceci soit ou non utile au débat plus large, ça ne le résoudra sûrement pas.
Q : Vous partez de l’affirmation que la liturgie est un donné, quelque chose de reçu…
R : C’est Joseph Ratzinger qui, avant son élection comme pape Benoît XVI, aborda la notion du respect de la tradition dans son traitement de la liturgie comme « donnée » ou plutôt, de la façon dont la liturgie devrait avoir le caractère de quelque chose de donné qui nous est transmis et préservé avec soin, et non pas le caractère de quelque chose de fabriqué par, et pour nous.
Dans le tout premier chapitre de L’Esprit de la liturgie (dans la version anglaise, The Spirit of the Liturgy, Ignatius Press, 2000, pp 13-23), Ratzinger porte notre attention sur la requête de Moïse auprès de Pharaon dans le livre de l’Exode. Il ne s’agit pas d’obtenir pour les Hébreux un meilleur contrat pour leur ouvrage de briqueterie, ni la permission d’émigrer – il n’y a pas de mention de ces dernières hypothèses dans le livre saint. Ce que Moïse demande à Pharaon, c’est que les Hébreux puissent aller au désert pour y rendre son culte à leur Dieu selon les préceptes qu’il y révèlera (Ibid. p. 15). Et voilà bien ce qui finit par se produire : Dieu leur révèle, avec force détail, le culte qu’ils ont à lui rendre, et eux suivent ces instructions à la lettre.
Q : Mais le culte se transforme en apostasie.
R : Justement parce qu’il y a fabrication. Car il se produit aussi une expérience en liturgie spontanée surgissant de la communauté. Ça tourne mal, comme le souligne Ratzinger : le culte du veau d’or est un culte auto-généré… Le culte devient une fête que la communauté se fait à elle-même, un festival d’auto-affirmation. Au lieu d’être le culte de Dieu, cela devient un cercle renfermé sur lui-même : on mange, on boit, on festoie. La danse autour du veau d’or est l’image de ce culte en quête de soi-même. Il s’agit d’une banale autosatisfaction. Le récit du veau d’or est l’image de ce culte égoïste et issu de soi-même. En fin de compte, il n’est plus centré sur Dieu ; il se donne à lui-même un sympathique petit monde alternatif, créé de toutes pièces à partir de ses propres ressources. Ensuite, la liturgie devient en fait dénuée de sens ; un simple badinage. Ou pire encore, elle tourne à l’apostasie… (Ibid. p. 23).
Q : Mais pourtant, bien qu’elle soit un don de Dieu, l’homme a comme mis sa patte au cours des temps dans le développement de la liturgie ?
R : En effet, tout au long de l’histoire elle a été modifié… Le problème est celui-ci : si nous pouvons parler d’une « donnée », de « tradition objective » dans la liturgie, nous savons bien que la liturgie s’est développée sur des siècles. Elle ne nous a pas été donnée dans son entièreté, enveloppée de fumée sur une montagne, telle que le livre de l’Exode nous décrit la liturgie donnée à l’Israël ancien. Elle a plutôt été élaborée par les hommes, peu à peu, à l’exception du noyau, modeste, de l’institution dominicale. Ce n’est pas de ce noyau qu’il s’agit lorsque l’on discute de la réforme liturgique. En fait, presque tous les éléments de la liturgie dont il s’agit lors de ces discussions, ces éléments affectés par la réforme des années 1960 auxquels le mouvement traditionnel reste agrippé, ont chacun une date d’origine précise. Le cycle ancien des Évangiles du dimanche est bien présent dès le VIIe siècle, mais les autres aspects du lectionnaire ancien continueront de se développer jusqu’au IXe siècle. La manière traditionnelle de recevoir la Sainte Communion est universellement mise en vigueur dans l’Église latine au IXe siècle seulement. Le Canon romain semble dater du IVe siècle. D’autres développements importants sont survenus au XIIe siècle. Il serait aisé de multiplier les exemples en consultant tout livre d’histoire de la liturgie.
Q : Précisément, ce qu’un homme, un pape, un évêque a fait, un pourrait le défaire ?
R : C’est en effet une des objections à l’attitude les partisans de la liturgie traditionnelle ainsi qu’à l’argumentation ratzinguérienne notée ci-dessus. Nous autres les traditionnalistes, nous désirerions traiter le missel de 1960 – si ce n’est une édition plus ancienne encore – comme étant représentatif de cet objet qui nous est donné : la tradition objective telle qu’elle nous a été transmise. Cependant, nous expliquera notre objecteur, ces missels ne sont qu’autant d’avatars d’un corps rituel en évolution permanente. Assurément, nous demandera ensuite notre objecteur, la génération des années 1960 avait tout autant le droit d’adapter ces rites aux besoins de son époque que l’avaient les innovateurs liturgiques plus anciens tels que saint François d’Assise, le pape saint Grégoire le Grand, ou encore avant eux les papes du IVe siècle ? Après tout, il est de la nature de la tradition liturgique que de se développer au fil du temps.
Q : Que répondez-vous ?
R : Pour répondre à cette objection il existe quelques arguments qui, d’après moi, seront insuffisants à la tâche qui nous incombe. L’on pourrait, par exemple, rappeler que les réformes des années 1960 furent sans précédent sous plusieurs rapports. C’est certainement vrai, mais il reste à expliquer pourquoi ce type précis de réforme présente problème – si c’est bien le cas – et pourquoi.
Une approche possible en effet pour bien cerner le problème serait de dire qu’il s’agit d’une question de degré : le degré auquel les changements se sont enchaînés sur la courte durée. Certes, il est exact de dire que le rythme du changement est significatif en raison de la portée psychologique des habitudes de la dévotion, ce que les progressistes liturgiques tendent à méconnaître. Je ne veux pas dire par là que si la réforme des années 1960 constitue une rupture avec la tradition, la même réforme n’aurait pas été une rupture si elle s’était déroulée au ralenti. Même si la réforme avait été lente, le fossé qui sépare les principes liturgiques et théologiques qui sous-tendent les liturgies ancienne et moderne demeurerait tout aussi problématique.
La deuxième approche, pour mieux cerner le problème, serait de se concentrer sur ces principes. Imaginons donc une réforme possible du missel de 1960 plus à notre goût : si les réformateurs, sous la direction d’un P. Louis Bouyer, disons, avaient été plus intelligents, plus sensibles et plus doctes, et si les résultats de la recherche historique, psychologique et sociologique de l’époque n’avaient pas été sur le point de se faire si complètement remettre en question par de nouvelles découvertes et modes intellectuelles. Une telle réforme eût certainement été moins sujette à la critique, même si les changements avaient été d’une ampleur égale.
Q : Autrement dit, une réforme plus lente et plus intelligente ne serait pas critiquable ?
R : Si, car même si elle avait été faite prudemment et savamment, elle aurait tout de même détruit le sens de la liturgie en tant que donnée. Supposons que les principes qui la sous-tendent avaient bel et bien été retenus : ces mêmes principes pourraient assurément se manifester au-delà d’un seul rit liturgique. Dans le cas d’un changement d’une telle ampleur, une réforme à la Bouyer aurait transformé la liturgie, sinon dans ses principes, au moins en tant que liturgie. Prendre la liturgie de ses aïeux pour la réécrire de fond en comble, ce n’est pas la traiter comme une liturgie « donnée ». C’est en ne la traitant comme « donnée », même dans le cas d’une réforme qui eût été possible et qui eût été de loin supérieure à celle qui s’est produite, que l’on tomberait dans nombre des problèmes qu’on a pu constater dans la réforme Bugnini. Et, si le pape ne traite pas la liturgie comme donnée, il ne faut pas s’attendre à ce que les prêtres chargés de la célébrer, ou encore les fidèles dans les bancs, la respectent comme une donnée non plus.
Q : Expliquez-nous…
R : Prenons le problème autrement : imaginons qu’il nous soit proposé de léguer à nos enfants une Bible qui ne contiendrait que les meilleurs passages du canon scripturaire, triés par un jury – tout à fait épatant, au demeurant – composé de théologiens. Voilà qui serait mal – tous tomberont d’accord là-dessus – parce que la Bible est une source de la Révélation. Soumettre la Bible à des théologiens reviendrait à mettre la charrue avant les bœufs : ce sont les théologiens qui devraient être soumis à la Bible. Par analogie (moindre, il est vrai), la liturgie, si elle n’est pas inspirée, est bien une source théologique. Il ne revient pas aux théologiens liturgiques, même aux meilleurs au monde, de porter un jugement sur la liturgie. Ce qu’eux ne comprennent pas ni n’apprécient pourrait être utile à nos enfants et petits-enfants, peut-être même bien plus utile que ce qu’une coterie d’experts, morts et enterrés depuis longtemps, trouvait passionnant en son temps.
Q : Ce n’est pas la théologie qui enseigne ce que doit être la liturgie, mais la liturgie qui est une source pour la théologie…
R : Parfaitement. Cette idée de liturgie comme source théologique est intimement liée à l’argument ratzinguérien de la liturgie comme donnée ; quelque chose qui, s’étant développé entre les mains de la Providence, nous transmet la volonté divine sur la manière dont le bon Dieu souhaite être adoré. Aucune de ces idées ne s’accorde vraiment avec une réforme planifiée de grande envergure, comme celle des années soixante.
J’ajouterais qu’il me semble tout aussi dangereux de tenter de défendre la notion de liturgie en tant que donnée comme s’il s’agissait d’une affaire de degré. Par exemple si l’on se disait permis de changer jusqu’à 5% de la liturgie tous les 20 ans tout en persistant à dire qu’on la traitait encore comme donnée. Si nos prédécesseurs dans la foi avaient partagé ces vues, chaque ligne de texte et chacune des rubriques eussent changé tous les quatre siècles, et lors les longues périodes de temps sur lesquelles s’étend l’histoire de l’Église, il n’y aurait plus de tradition liturgique du tout : il ne resterait qu’une espèce de téléphone arabe.
Q : Et pourtant, on pourrait vous objecter que la liturgie a bel et bien changé.
R : C’est vrai : la preuve en est dans les manuscrits. Et nos objecteurs nous dirons que nos prédécesseurs dans la foi ne pouvaient pas avoir une idée aussi stricte que cela du sens de la fidélité à la tradition ; partant, nous n’y sommes pas obligés non plus. Voilà justement le nœud du problème. La solution requerra non pas la considération de ce qui s’est fait lors du siècle dernier, mais de ce qui se faisait pendant les siècles avant lui. Il faut en venir à apprécier, et même à assimiler, une notion prémoderne de ce que c’est que d’adhérer à une tradition.
Afin d’y parvenir, permettez-moi un petit détour. Car il y a bien un moyen de comprendre ce phénomène, c’est de s’intéresser à la préservation des traditions orales. Je suis père de famille ; j’ai donc un intérêt marqué pour les contes folkloriques. J’en suis arrivé à faire une distinction nette entre les contes qui ressortent de la tradition populaire authentique et les histoires qui ne font que la singer ; cette dernière catégorie comprenant les contes de Hans Christian Anderson, Oscar Wilde, et ainsi de suite, qui ne sont que des pastiches imitant la véritable tradition folklorique.
On peut alors se poser la question de savoir si les conteurs populaires étaient plus créateurs, ou encore avaient une sensibilité psychologique plus fine, qu’un Hans Anderson ? Aucunement. Ils n’étaient pas les auteurs de ces contes ; ils ne faisaient que les transmettre. C’est cette réalité qui a impressionné les collectionneurs de ces histoires tels, notamment les frères Grimm en Allemagne. Les conteurs traditionnels avaient un grand souci de rapporter chaque détail exactement et de corriger leurs erreurs éventuelles au fur et à mesure de leur déclamation. La pierre de touche de la tradition du conte populaire, loin d’être la créativité, c’est la fidélité.
Mais bien évidemment ces contes, avant d’en arriver à être transcrits, avaient évolué dans le temps. Ceci nous est connu parce que les folkloristes ont répertorié différentes versions de ce qui est clairement la même histoire en des lieux différents ; certaines histoires aussi présentent des ressemblances frappantes avec des contes qui se retrouvent déjà sous forme écrite au XIIe siècle en Scandinavie, ou encore avec des fables présentes dans la Grèce de l’antiquité. Ceci nous apprend deux choses :
– en premier lieu, que leur fidélité à la tradition était telle que ces conteurs purent retenir ces similarités sur – bien plus que quelques générations – des millénaires ;
– en second lieu, que cette fidélité n’a pas toujours su écarter absolument des changements.
Seul le premier de ces deux constats devrait nous surprendre. Il va sans dire que, bien sûr, différents aspects d’un conte seront mis en relief, et que de subtiles mises à jour s’immisceront dans une histoire qui passe de conteur en conteur sur le long terme. Comment pourrait-il en être autrement ? Mais on ne peut parler de la transmission d’une histoire, une histoire unique et bien reconnaissable, que si chacun des chaînons fait tout ce qu’il peut pour la conserver.
Q : Vous voulez dire qu’il y a des changements qui véhiculent la tradition et d’autres qui sont des bouleversements…
R : Bien sûr, et si les conteurs folkloriques avaient, à un moment donné, décidé que l’évolution de leurs histoires était inévitable, et même après tout pas si mauvaise, pourquoi alors ne pas y faire de menus changements pour les rendre plus pertinentes à la génération actuelle ? Ou encore, s’ils avaient adopté la pratique des tragédiens grecs anciens (et bien d’autres au cours des siècles), de donner libre cours à leurs improvisations sur des thèmes repris à la tradition populaire, eh ! bien, il n’y aurait tout simplement pas de tradition populaire. Ces vénérables histoires qui nous interpellent depuis les racines profondes de la culture européenne ne se seraient tout simplement pas perpétuées.
Q : Est-ce pourquoi vous disiez qu’il faut en revenir à une notion prémoderne de ce que c’est que d’adhérer à une tradition.
R : Oui, et le but de mon petit détour était de souligner trois choses :
– Premièrement, le concept prémoderne de fidélité à la tradition, dans le sens où l’on n’est pas vraiment libre de changer même à petite échelle ce qui a été transmis à soi, est une idée parfaitement familière, et en fait un aspect fondamental de la pré-culture moderne.
– Deuxièmement, cette attitude n’empêche pas en fait tout changement, car ce serait impossible.
– Troisièmement, cette attitude réussit néanmoins à maintenir la continuité d’une tradition, même sur d’immenses périodes de temps.
Q : C’est un point crucial : voudriez-vous expliciter la différence entre la conception prémoderne de tradition et sa conception moderne ?
R : La conception moderne de la tradition est la suivante. Souvent les liturgistes qui se considèrent conservateurs, tout comme les progressistes, disent effectivement : « de ce que j’ai reçu, je transmettrai à la postérité ce que j’en choisis ». Après quelques générations de ce type de choix, toujours sujets à des modes intellectuelles en flux permanent, la continuité se sera usée jusqu’à la trame.
La conception prémoderne, la voici : « Je transmets à la postérité tout ce qui m’a été légué, dans la mesure de mes capacités : tant ce que je comprends et que j’apprécie que ce que je ne comprends pas pleinement, ce qui va à l’encontre des modes esthétiques de mon propre temps, et ce qui blesse les péchés préférés de ma génération ».
Seule une fidélité à toute épreuve permet, sur le très long terme, à des générations de catholiques de pouvoir dire : « Nous rendons à Dieu le culte que lui rendaient nos prédécesseurs dans la foi, dans une tradition ininterrompue qui remonte jusqu’aux Apôtres ». Voilà ce qui rend plausibles les idées connexes suivantes :
– que la tradition liturgique est un des moyens par lesquels Dieu nous fait connaître sa volonté quant à la manière dont il souhaite recevoir notre culte ;
– qu’elle est une source théologique ;
– qu’elle est objective, un don.
Q : La tradition orale de contes et la tradition liturgique sont deux choses assez différentes. Votre analogie s’applique-t-elle parfaitement ?
R : En fait, ce que je viens de dire demande une qualification importante. La tradition liturgique est largement plus complexe qu’une tradition orale de conteurs d’histoires, et le changement en liturgie n’a pas la même portée selon les divers niveaux. Le cas le plus manifeste est celui du cycle sanctoral où le changement n’est aucunement une anomalie mais un procédé normal, au fur et à mesure des canonisations ; il en est de même pour les fêtes de dévotion. De surcroît, dans une tradition écrite, la fidélité peut être plus pointilleuse et il est possible de revenir d’une erreur par la collation des livres liturgiques préservés dans différentes aires géographiques
Cependant, ce que j’espère avoir pu commencer d’indiquer, c’est que l’idée d’une stricte fidélité à la tradition n’est pas simplement la réaction frileuse d’un groupuscule de catholiques qui n’arrivent pas à s’accommoder de la modernité ; elle n’est pas non plus un aspect spécial de l’Église-forteresse de l’époque tridentine après un Moyen-Âge sympathique et débraillé. Ce sont là deux idées reçues que l’on retrouve souvent sous la plume des progressistes en liturgie ; elles sont fausses car elles proviennent justement du problème dont ils accusent leurs adversaires : un anachronisme naïf. En effet, ils projettent sur le passé prémoderne une conception moderne de ce qu’implique le respect de la tradition. Car une conception prémoderne est la condition nécessaire de ce genre de tradition.
La Lettre de Paix liturgique
Lettre 815 du 18 Août 2021
| UNE TRADITION VIVANTE
LES CHANGEMENTS TRADITIONNELS EN LITURGIE SECONDE PARTIE DE L’ENTRETIEN AVEC LE PROFESSEUR JOSEPH SHAW |
Dans ce deuxième entretien, Joseph Shaw montre comment la tradition liturgique véritable est vivante et peut connaître des changements, mais des changements traditionnels et non de rupture, dont il cherche à déterminer les caractéristiques.
Q – Vous nous avez donc expliqué que la vraie tradition liturgique relevait d’une conception prémoderne, alors que la fausse tradition est engendrée par une conception moderne. Mais la conception prémoderne a-t-elle toujours fonctionné ?
Je me bornerai à faire quelques observations sur la nature des changements liturgiques historiques afin d’arriver à une idée générale de la voie à suivre pour répondre à cette objection.
La clef est de savoir comment ces changements ont pu s’introduire dans la liturgie à l’époque prémoderne, et ce qui les motivait. L’on peut dénombrer divers types de changement et de motifs les expliquant. Pour faire simple, je m’attacherai à quatre catégories de changement :
– le changement par élaboration ;
– le changement par conséquence de besoins nouveaux ;
– le changement par emprunt ;
– le changement par abréviation.
Q – Qu’entendez-vous par changements par élaboration ?
Les exemples de développement liturgique tendant à élargir, élaborer, et allonger les rites abondent. Entre autres, les chantres en chape des rites gallicans. Ou encore, cette anecdote que nous racontent les historiens du chant, selon laquelle les improvisations des chanteurs avaient allongé le jubilus de l’alléluia jusqu’à ce que l’on eût l’heureuse idée qu’un psaume pourrait tout à fait se chanter sur la mélodie ainsi créée. On ajouta aussi des séquences pour certains jours, après l’alléluia. Ces développements étaient manifestement motivés par un désir d’amplifier la solennité de l’office, pour lui donner la plus grande gloire possible, surtout à une époque d’abondance relative des ressources liturgiques que constituent le temps et les chanteurs bien entraînés.
L’importance de ces changements pour l’expérience que font les fidèles de la liturgie est plutôt concrète, dans la mesure où, même si dans de tels cas que les chantres en chape ils viennent à disparaître avec la disponibilité des ressources liturgiques, dans d’autres cas, comme celui du verset de l’alléluia, ils demeurent.
La question que je me pose est de savoir si de tels changements constituent une innovation, une rupture de la tradition liturgique. La réponse, est « non ». Ceux qui étaient à l’origine de ces développements ne faisaient que profiter de la liberté de l’époque, que l’on entendait comme une liberté d’ajouter de tels éléments. Tout comme, aujourd’hui, on peut parfaitement organiser deux, ou quatre, céroféraires à la messe solennelle, et l’on peut faire chanter un motet approprié après l’antienne de l’offertoire, on pouvait dans cette conjoncture-là du passé ajouter, retrancher, ou encore développer le nombre des chantres en chape ou les versets du psaume après l’alléluia ; ce n’est qu’après un usage prolongé et constant de telle ou telle pratique que celle-ci en vint à être considérée normative et se retrouva dans le texte du missel.
Ce que je viens de décrire, c’est le développement de la coutume, un procédé archiconnu des médiévistes. Les coutumes à force normative, comme le droit de tenir un marché dans tel village tel jour de la semaine, le droit de recevoir le revenu de tel champ, ou encore le droit de faire appel à tel juge pour certains cas, se développent toutes à partir de pratiques répétées et reçues sur la durée. Ces phénomènes n’indiquent pas qu’on ne considérait pas ces pratiques coutumières comme étant contraignantes, bien au contraire.
Q – En quoi cette coutume n’est pas nécessairement contraignante ?
C’est là quelque chose que les critiques de la position traditionaliste dans les débats actuels paraissent parfois ne pas comprendre. Une pratique régulière n’est pas d’emblée considérée comme une coutume contraignante ; elle le devient ultérieurement. À aucun moment n’y a-t-il eu erreur ou tromperie sur l’origine de la pratique en question ; rien dans la nature de l’obligation coutumière n’est tiré par les cheveux. D’ailleurs cette notion d’obligation coutumière joue encore un rôle sérieux aujourd’hui, en droit international : le concept n’est pas la chasse gardée de paysans analphabètes du Moyen Âge. Si chacun est libre de rejeter l’idée que la coutume fait le droit, nul ne peut s’arroger le droit de nier que l’idée soit bien comprise et universellement acceptée.
Dans le contexte de l’histoire de la liturgie, il importe de comprendre que les catholiques en sont venus à se sentir obligés de continuer à faire ce qui était devenu la pratique régulière, même si leurs prédécesseurs, eux, n’avait pas ressenti la même obligation. Surtout, il nous faut admettre que ces deux attitudes, celle de la première génération comme celle des générations suivantes, sont tout à fait logiques, sans avoir à invoquer une quelconque erreur historique chez qui que ce soit. C’est que c’est tout simplement ainsi qu’émergent les obligations coutumières.
Q – Pouvez-vous nous donner des exemples ?
On décrit encore parfois les exorcismes avant le Baptême et les prières au bas de l’autel comme ne faisant pas partie du « Baptême proprement dit » ou de la « Messe proprement dite ». En effet, il s’agit de préliminaires. Les historiens de la liturgie nous disent qu’à l’origine ils étaient distincts, en temps et en lieu, du rite principal : les exorcismes se faisaient lors des scrutins des candidats au baptême et les prières préparatoires se faisaient à la sacristie avant la messe, ou encore pendant la procession à l’autel. Il fut un temps où ils ne jouissaient pas de force coutumière ; ensuite, oui, mais leur incorporation au rite principal n’était qu’une question de commodité, tout comme un prêtre aujourd’hui pourra dire l’angélus juste avant la messe de midi. Au bout du compte, le rite et ces préliminaires furent perçus comme formant un bloc, parce que dans la pratique c’était ainsi qu’ils avaient été traités pendant longtemps, et, partant, on en vint à comprendre que de retrancher les rites préliminaires serait contraire à une vraie fidélité envers la tradition liturgique.
Q- C’est ce que vous qualifiez de changements par élaboration, qui ne sont pas vraiment des changements.
Oui et je résume mon argument jusqu’ici selon le processus que je viens de décrire : d’abord, il n’y a rien du tout de mystérieux dans ce processus historique ; ensuite, à aucun moment personne n’a contrevenu à l’obligation de fidélité à la tradition ; enfin, jamais personne ne s’est laissé guider par une quelconque erreur. Je ne dis pas que jamais il ne se soit produit d’infidélité ni de méprise historique lors de l’histoire de la liturgie : ce serait bien surprenant. Ce que je dis, c’est que le développement de la liturgie n’en est pas tributaire.
Ce que cela signifie, c’est qu’un rit liturgique pourrait se développer considérablement sur une durée, disons, de dix générations, sans qu’aucune de ces générations ne soit infidèle à la tradition. Cela peut paraître paradoxal : la liturgie change sans que personne ne la change. Mais en fait, il s’agit là d’un processus historique tout à fait simple et familier.
Q – Pouvez-vous nous parler maintenant du changement en conséquence de besoins nouveaux ?
Un exemple majeur de nouveau besoin liturgique serait l’essor des monarchies européennes, à qui il fallait une cérémonie d’installation appropriée. Bien que ces cérémonies aient à peu près toutes disparu aujourd’hui, les liturgies de sacre et de couronnement qui se développèrent au Moyen Âge sont extrêmement intéressantes, et, au premier abord, leur apparition dans l’univers liturgique ressemble fort à un précédent pour la création délibérée de la liturgie, plutôt que pour sa transmission.
Pourtant, même ici on n’échappe pas vraiment à la tradition comme donnée, car ces cérémonies ne furent pas créées de toutes pièces. Elles tiraient leur origine de cérémonies laïques qui avaient eu cours parmi les peuples en question depuis la nuit des temps avant d’être introduites dans l’Église et présidées, dans une plus ou moins large mesure, par le clergé. À ces cérémonies tribales vinrent s’ajouter des éléments dérivés de l’Ancien Testament, surtout l’onction des rois, tout comme Saul et David reçurent l’onction du prophète Samuel, une tradition qui avait été retenue dans les onctions des rites sacramentaux.
Il faut là encore considérer tout ceci du point de vue des concernés à l’époque. D’après son biographe, (Adamnan The Life of St Columba) saint Colomban d’Iona conféra l’onction au roi des Écossais. Cela signifie qu’il fut convoqué à prendre part à telle cérémonie traditionnelle pour y contribuer son approbation et sa bénédiction. Il le fit dans les formes appropriées dont les indications se trouvaient dans l’Ancien Testament, et dont les équivalents se retrouvaient dans nombre de rites liturgiques déjà bien établis à son époque. Il ne se bornait pas au respect de la tradition : c’est bel et bien d’obéissance qu’il faisait preuve.
Une autre raison pour laquelle on ne peut pas accuser saint Columban d’innovation liturgique, c’est que ce à quoi il participait n’était liturgique que dans un sens très atténué. Il ne faisait que conférer sa bénédiction d’une façon qui semblait convenir à l’occasion. Ce n’est qu’au fil des siècles que les pratiques attachées au couronnement des monarques finirent par être considérées normatives et furent énoncées dans des livres liturgiques, comme je l’ai expliqué précédemment.
Q – Le traditionnel liturgique rejoint en somme le traditionnel social, politique, etc.
C’est certain. En effet, si l’on veut entrer dans la mentalité de nos prédécesseurs dans la foi prémodernes, il faut se défaire de nos distinctions bien tranchées entre ce qui est strictement liturgique et ce qui ne l’est pas. Une catégorisation des rites moins distincte rend plus aisé de comprendre comment ce qui paraît clairement être un événement non-liturgique, telle la proclamation d’un nouveau roi, ou encore une cérémonie de mariage médiévale, peut à terme passer à un rite liturgique tenu à l’Église sous les auspices du clergé. On a assisté à quelque chose d’analogue au siècle dernier – c’est Jungmann qui le fait remarquer – avec les prières léonines, qui en sont venues à sembler prolonger la messe basse, quoique les liturgistes modernes ne manqueront pas d’insister sur le fait que celles-ci ne constituent qu’un appendice paraliturgique à la messe proprement dite.
Q – Et le changement par emprunt ?
Il y a en effet les cas où une tradition liturgique fait des emprunts à une autre tradition. Ceci se produit pour plus d’une raison.
Au IXe siècle naissant, l’Église franque sous Charlemagne adopta, en grande partie, le rit de Rome car l’on considérait que des erreurs avaient corrompu les livres francs. Au siècle suivant, la liturgie de Rome reçut une dose de matériaux non romains d’une source extérieure car, cette fois-ci, c’étaient eux qui, pensait-on, avait besoin d’être corrigés.
On pouvait justifier l’emprunt de cérémonies et de textes précis non seulement par les carences de ses propres livres mais aussi par l’excellence et le prestige de ce que l’on empruntait. Jungmann nous dit que la liturgie romaine adopta le kyrie des rites orientaux au Ve siècle. Les quatre séquences qui s’acheminèrent, à partir de sources gallicanes, dans le rite romain le firent pour ainsi dire sur leurs mérites. Ou encore, une tradition peut s’emprunter à elle-même : ainsi le gloria, qui à l’origine était propre à la noël, s’est étendu à d’autres parties du calendrier de l’Église.
Naturellement, les cas d’emprunt les plus radicaux arrivent quand celui qui emprunte part d’une ardoise vierge – ce qui est rarissime. Un bon exemple serait celui de saint Augustin de Cantorbéry, qui eut à décider des formes à employer dans la terre de mission qu’était l’Angleterre de la fin du VIe siècle. Le conseil, très connu, que lui donna saint Grégoire le Grand consistait à recueillir le meilleur de ce qu’il avait pu voir (cité in Alcuin Reid, The Organic Development of the Liturgy, Ignatius Press, 2005, pp. 20s.). En l’espèce, il ne lui conseillait pas de composer une toute nouvelle liturgie, mais d’en emprunter une aux meilleures sources disponibles.
Q – De même dans les emprunts entre les liturgies franques et romaines.
Tout à fait. Ainsi la trajectoire du sacramentaire Hadrianum depuis Rome à la cour de Charlemagne, et le voyage que fit, plus tard, le Pontifical Romano-Germanique de Metz à Rome, furent d’une grande importance historique dans le développement de la liturgie, mais jamais ne furent conçus comme instruments de changement en tant que tel par leurs contemporains. Ceux-ci demeuraient aussi fidèles que possible à la tradition : à leur tradition locale propre, si possible, ou à défaut à la tradition la plus ancienne et la plus prestigieuse qu’ils eussent à portée de main.
Mais quid des emprunts plus modestes ? Peut-on affirmer que d’ajouter le Gloria de noël aux autres dimanches, la séquence gallicane de la Fête-Dieu au missel romain, ou encore la fête orientale de la Transfiguration au calendrier romain, constituent autant d’indications d’une attitude liturgique relâchée par rapport au changement ? L’adoption d’une coutume du diocèse voisin, voire d’une tradition lointaine mais prestigieuse, peut parfois s’avérer destructive de la tradition locale, et pour cette raison ce genre d’adoption fut parfois l’objet d’une résistance féroce : c’est le cas des essais d’imposition du rite romain à Milan. Ce qui nous importe c’est que la compétition entre coutumes locales – quand une coutume, ou certains de ses aspects, prend le dessus par rapport à une autre – est déterminée en fonction de catégories internes au concept de la tradition : l’antiquité des traditions en question, le prestige des diocèses auxquels elles sont attachées, la beauté, la piété, et l’adéquation d’un rite ou d’un texte, et ainsi de suite. L’historien de la liturgie n’est pas en droit de montrer ces développements du doigt pour démontrer que les Catholiques du passé ne respectaient pas la tradition.
Q – Il vous reste à parler du changement par abréviation ?
Un autre type de développement liturgique est en effet motivé par une pénurie de temps, de place, de chanteurs, enfin de ministres sacrés. Un bon exemple de ce phénomène, c’est l’apparition au IXe siècle de la messe basse ; l’apparition de la missa cantata est un développement parallèle à l’époque moderne. Le premier moteur de la messe basse semble avoir été de permettre aux prêtres en communauté religieuse de dire la messe tous les jours. La portée de ce développement est considérable, puisque ce qui avait débuté comme une adaptation à un besoin précis en est venu à former, plus tard, un aspect majeur, voire dominant, de l’expérience liturgique d’une grande proportion des Catholiques.
Ce type de développement liturgique présente-t-il un contrexemple à mon affirmation que ceux qui ont transmis la tradition liturgique ressentaient une forte obligation de ne pas la changer ? La réponse, c’est « non ».
Q – Vous voulez dire qu’en abrégeant de la sorte, on ne cherche pas à trafiquer le donné cultuel ?
Songez aux prêtres qui célébraient la messe en prison, pendant les persécutions nazie ou communiste, avec un dé à coudre comme calice, un raisin sec trempé dans de l’eau comme vin, sans servant de messe, les textes récités de mémoire, etc. Ils étaient bien obligés de laisser de côté certains aspects de la liturgie. En un certain sens, on pourrait dire d’eux qu’ils étaient des innovateurs liturgiques, mais dans le sens qui importe, ils n’étaient bien sûr rien de la sorte, car ils n’avaient pas l’intention de transmettre leurs innovations à la génération suivante. Pour dire les choses autrement, si l’on conçoit la tradition liturgique comme s’étendant sur les générations, ils ne la trafiquaient pas, car ils n’y laissaient pas leur marque. En fait, ils étaient aussi fidèles à la tradition que possible dans la mesure de leurs circonstances.
Q – Et la messe basse n’a pas aboli la messe chantée.
Bien sûr. La messe basse fut transmise et demeure encore aujourd’hui, un millénaire plus tard. Mais jamais il ne fut question qu’elle remplaçât la messe solennelle, ce qu’elle n’a d’ailleurs pas fait. La messe basse représente la fidélité maximale à la tradition s’il y a vingt messes à dire avant le petit-déjeuner dans les chapelles minuscules d’un monastère tout en préservant la célébration pleine et entière de la messe solennelle au quotidien. Ainsi, ceux qui développèrent la messe basse pouvaient dire que la tradition liturgique dans son ensemble n’était pas compromise par l’introduction de la messe basse.
Au contraire, l’on pourrait soutenir que l’apparition de la messe basse apporta la tradition liturgique dans des situations où elle n’aurait pas pu aller autrement : dans ces chapelles latérales, par exemple, et comme l’histoire devait le montrer, dans les missions, les champs de bataille et les prisons. Il ne s’agit pas tant d’un changement à la tradition, que d’un nouveau produit de la tradition.
Q – Ne peut-on pas dire que les Orientaux sont restés plus fidèles à la messe antique, en son état solennel ?
Oui et non. On peut très bien soutenir que les gardiens des rites Orientaux avaient plus grande raison d’insister que la messe ne se célébrât qu’avec solennité. La question n’est pas tranchée : est-ce que la fidélité à la tradition exige la plénitude des cérémonies, ou bien permet-elle leur abréviation sous certaines conditions ? En tant que catholique de rite latin, je ne dirai que ceci : je comprends et j’apprécie la force de l’argument, non pas de jeter par la fenêtre, au motif de la commodité, de vénérables rites, mais de les préserver sous forme vestigiale en cas de nécessité.
Car c’est ainsi que les créateurs de la messe basse se mirent à l’ouvrage. Les cérémonies qui, dans certaines conditions, ne pouvaient pas être célébrées au complet furent retenues en forme symbolique, comprimée, qui retient toute la valeur symbolique du rite initial, plus long. Un bon exemple serait le servant qui porte le missel du sud au nord de l’autel, ce qui revient à une forme comprimée de la procession de l’Évangile avec flambeaux et encens à la messe solennelle. Un autre exemple : de ranger la patène sous le corporal, c’est un peu le parent pauvre du sous-diacre qui voile la patène sous le voile huméral (j’emprunte cet exemple au docteur Peter Kwasniewski).
Ce processus est également visible dans d’autres développements par abréviation : les quelques lignes du Psaume 25, Lavabo inter innocentes, etc., ont remplacé le psaume dans son entièreté tel qu’il était récité autrefois. C’est là un des aspects qui donnent à la « messe de toujours », telle qu’elle est célébrée aujourd’hui son immense richesse : la densité de ses références symboliques et textuelles.
Ces liturgistes qui cherchent à soutenir que les catholiques prémodernes ne faisaient pas grand cas de l’innovation liturgique feront appel à d’autres exemples qu’il faudra examiner au cas par cas ; mais ce n’est pas ici que je pourrai répondre à tous les arguments possibles. D’ailleurs, je n’en ai pas les qualifications.
Q – Mais, la liturgie à ses origines devait avoir un grand degré de liberté de changement et d’adaptation. La création initiale de la liturgie latine elle-même, nous dira l’objecteur, est assurément un exemple de bouleversement de la tradition ?
Pour répondre à cette objection je ferai deux observations :
– La première, c’est que à supposer que ce soit vrai, les catholiques des premiers siècles ne se trouvaient pas dans les mêmes circonstances que ceux du VIIIe siècle et suivants. Comme je le faisais remarquer en passant, l’antiquité d’une tradition est l’un des facteurs-clefs dans la détermination du respect qui lui est dû. D’ailleurs – pour faire une remarque connexe – il est notable que la vigueur de cette idée que la liturgie latine aurait représenté une rupture de la tradition est largement dissipée dès que l’on se rend compte que les textes liturgiques latins primitifs ne semblent pas avoir été autant de traductions de textes grecs encore plus anciens, mais au contraire semblent être aussi anciens, si ce n’est plus anciens encore, que les textes liturgiques grecs qui sont parvenus jusqu’à nous.
– Ma deuxième remarque, c’est que nous en savons très peu sur la manière dont ces tout premiers développements eurent lieu. Selon le mot mémorable de Jungmann, « Les débuts de la messe latine à Rome sont enveloppés dans une obscurité presque totale » (Jungmann, vol. I, p. 49, dans la version anglaise). Toute spéculation sur les attitudes de ceux qui, comme saint Gélase ou d’autres de cette époque (cf. Jungmann, vol. I, p. 58 : « La structure de la messe romaine… a donc dû avoir été essentiellement déterminée avant l’orée du Ve siècle »), participèrent vraisemblablement à ce développement de la liturgie latine, ne peut en aucun cas servir de base à un argument sérieux.
Q – Finalement, que peut-on dire de l’attitude des chrétiens de Rome dans l’Antiquité vis-à-vis de la tradition ?
Il faut bien garder à l’esprit que tout comme leurs successeurs qui développeront les cérémonies de couronnement évoquées plus haut, ils avaient à portée de main tout une gamme de ressources traditionnelles, dont la liturgie du Temple et celle de la Synagogue, la Cène, et les cérémonies civiles et religieuses de leurs propres sociétés.
Saint Basile le Grand met en relief encore une autre source : nous ne sommes pas limités par ce que rapportent l’Apôtre ou l’Évangile ; tant avant qu’après, nous proférons des paroles qui sont d’une grande importance pour le mystère, des paroles qui nous viennent de l’enseignement non-écrit (Basile de Césarée, De Spiritu Sancto, 27, 66 : PG 32, p. 188).
Q – La civilisation romaine n’était-elle pas la plus traditionnelle qui soit ?
Plus généralement, la société méditerranéenne était un creuset de traditions et d’influence culturelles, et en même temps une société profondément traditionnelle où le présent se justifiait par le passé, et où l’on considérait que des rituels complexes, archaïques, et en partie incompréhensibles conféraient la faveur divine, la légitimité, le prestige. Le christianisme a surgi d’une des sociétés les plus traditionnelles de ce monde, le judaïsme, et l’Église d’Occident s’est installé dans une autre des sociétés les plus traditionnelles de ce monde, la Rome ancienne. Il y a, il est vrai, une vaste différence entre ces deux cultures, mais elles partageaient une révérence pour la tradition sans commune mesure avec ce que peuvent comprendre bien des gens d’aujourd’hui. Pour exemple je recommande à ceux qui m’écoutent la cérémonie de mariage romaine de l’aristocratie, qui a survécu dans toute son obscurité archaïque.
Cette idée qu’entre la culture religieuse du Lévitique dans la Jérusalem du Temple d’Hérode et la culture religieuse des Fastes d’Ovide dans la Rome des Césars, les premiers Chrétiens aient trouvé le moyen de s’affranchir de l’emprise de la tradition et de jouir d’un interlude pour vivre au rythme de conceptions de liberté personnelle, de spontanéité et d’autodétermination issues des Lumières manque, au bas mot, de plausibilité.
La Lettre de Paix liturgique
Lettre 817 du 26 Août 2021
| VATICAN II ET LA TRADITION LITURGIQUE
TROISIÈME PARTIE DE L’ENTRETIEN AVEC LE PROFESSEUR JOSEPH SHAW |
Dans ce troisième entretien, Joseph Shaw traite du rapport du Concile lui-même avec la tradition liturgique, rapport complexe dont il décrit les nuances et dénoue les ambiguïtés. La constitution Sacrosanctum Concilium ne peut pas être exonérée de la responsabilité des déviations de la réforme qui l’a suivie.
Q – L’attitude envers la tradition, dont vous avez parlé dans votre dernier entretien, se retrouve-t-elle dans la constitution conciliaire sur la liturgie ?
Oui, c’est toute la question : savoir si l’attitude envers la tradition dont j’ai parlée précédemment demeure normative pour les catholiques aujourd’hui, même à la lumière du Concile Vatican II. Bref : est-ce que la constitution du Concile sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium, nous enseigne que nous n’avons plus à prendre la tradition liturgique pour ligne directrice du renouveau liturgique ?
Cette question est mise en lumière par la distinction que l’on fait parfois entre restauration et réforme. Ceux qui font cette distinction semblent parfois user du vocable de « restauration » comme un raccourci signifiant la promotion de la liturgie ancienne, et de celui de « réforme » comme un code pour la réforme (mise en place de nouveautés) qui fut mise en pratique après Vatican II. Cependant il faut les tenir au sens des mots, et demander à savoir au juste ce que l’on distingue.
Afin de répondre à cette question, il faut prêter attention au langage précis de Sacrosanctum Concilium. Vers le début de ce document l’on retrouve un passage important qui décrit ce qu’il compte effectuer. La traduction du site internet du Vatican nous en donne la version suivante : « Enfin, obéissant fidèlement à la tradition, le saint Concile déclare que la sainte Mère l’Église considère comme égaux en droit et en dignité tous les rites légitimement reconnus, et qu’elle veut, à l’avenir, les conserver et les favoriser de toutes manières ; et il souhaite que, là où il en est besoin, on les révise entièrement avec prudence dans l’esprit d’une saine tradition et qu’on leur rende une nouvelle vigueur en accord avec les circonstances et les nécessités d’aujourd’hui ».
La phrase-clef est ici l’avant-dernière, dont le latin donne : caute ex integro ad mentem sanae traditionis recognoscantur.
Ce quatrième paragraphe du préambule donne le « la » terminologique de tout le reste du document. Le verbe que je viens de citer, recognoscere, apparaît dix-neuf fois dans tout le document ; en plus, le substantif instauratio et son verbe d’origine instaurare apparaissent 21 fois. Un autre terme proche que l’on retrouve dans le document, c’est restitutio, qui est utilisé sept fois. Tous ces mots semblent avoir été utilisés de façon interchangeable : l’action exprimée par les verbes recognoscere, instaurare et restituere sont appliqués à la messe, au bréviaire, au rite du baptême des adultes, aux livres liturgiques, à la liturgie en général, et ainsi de suite ; le résultat en sera une instauratio ou encore une recognitio, tout comme celle qui se produisit – selon Sacrosanctum Concilium – quand Pie X restaura les livres de chant grégorien (116), ou quand le cardinal Bea produisit sa nouvelle version latine du Psautier (91).
Q – Mais que veulent dire au juste ces différents termes ?
La traduction française du site du Vatican propose « réviser/révision » pour recognocere, « rétablir, restituer, rendre (à la forme primitive) » pour restituere, mais pour instaurare et instauratio il y a flottement entre « restaurer/restauration, œuvre, réforme ». De fait, tout dictionnaire latin indiquera que instaurare, instauratio et restituere signifient tous « reprendre, renouveler, réparer, rétablir » : instaurare est le vocable employé dans la Vulgate pour décrire ce que firent au temple les rois Ézéchias et Josias (2 Chroniques 29:3; 34:8, 10; 35:20). Recognoscere a un sens technique en latin d’Église ; cela indique la révision d’un texte pour en vérifier l’exactitude. Dans les textes qui nous préoccupent, de dire que les rites doivent recognoscantur, c’est-à-dire être vérifiés pour leur exactitude selon la mens, l’esprit, de la saine tradition, revient à dire qu’ils doivent être restaurés.
En français, tout comme bien entendu dans d’autres langues, il y a une forte distinction entre restauration et réforme. Du temps du premier ministre du Royaume-Uni Tony Blair, on nous rabattait les oreilles en disant qu’il fallait « réformer » ; si telle institution ou tel dispositif constitutionnel avait existé de longue date, cela seul semblait constituer un argument en faveur d’un changement. Réformer avait un sens général de conférer une forme entièrement nouvelle, sans précédent aucun (ou si peu), et avec encore moins d’attention aux conséquences qui s’en suivraient.
En revanche, restaurer veut dire remettre en un état plus ancien ; d’ailleurs ce vocable s’est associé au métier de la restauration d’œuvres d’art. Les restaurateurs rendent aux bâtiments ou aux artéfacts la forme qu’ils avaient à tel moment précis de leur passé, au besoin en détruisant les ajouts plus tardifs ; c’est comme s’ils avaient le pouvoir de faire remonter ces objets dans le temps.
Q –Au total, Sacrosanctum Concilium entendait restaurer ou réformer ?
Ni l’un ni l’autre de ces concepts ne correspond à l’intention de Sacrosanctum Concilium ; il y a lieu d’être reconnaissant que, si on laisse les traductions de côté, le document s’exprime clairement. En améliorant quelque peu le passage cité ci-dessus, on obtient : « [Le Concile] souhaite que, là où il en est besoin, on les restaure avec prudence dans l’esprit d’une saine tradition et qu’on leur rende une nouvelle vigueur en accord avec les circonstances et les nécessités d’aujourd’hui. »
Restauration et nouvelle vigueur ne sont pas des aspirations opposées : la nouvelle vigueur sera impartie par la restauration. Ce qui peut paraître particulièrement remarquable, c’est la confiance des Pères conciliaires que ce qui était nécessaire afin d’aller au-devant des défis toujours changeants de la modernité, c’était un ensemble de rites liturgiques restaurés dans l’esprit de la saine tradition. Car c’est là le principe fondateur du mouvement traditionaliste.
Le document ne se contente pas d’établir ce principe seulement une fois ; il le répète plus loin, au paragraphe 50 : « [O]n rétablira, selon l’ancienne norme des saints Pères, certaines choses qui ont disparu sous les atteintes du temps, dans la mesure où cela apparaîtra opportun ou nécessaire. »
Là encore, la « vigueur » est à impartir aux rites par la « restauration ».
Bien entendu, l’idée qui se trouve exprimée ici a toute une histoire. Certains membres du Mouvement Liturgique étaient d’avis que la liturgie primitive avait justement les caractéristiques voulues pour attirer les hommes modernes ; avant tout, la simplicité. Cette idée rendit possible une coalition entre ces chercheurs liturgiques qui souhaitaient le genre de restauration radicale d’anciennes formes cultuelles que le pape Pie XII avait taxée d’« archéologisme », dans Mediator Dei, d’une part, et ces réformateurs pastoraux qui se moquaient bien du passé, de l’autre. Cette alliance, fragile, ne fit pas long feu dès lors que la réforme se fut mise en branle.
Mais ces débats en marge du Concile ne contrôlent pas, pour nous, le sens du texte. Ce qu’il dit, dans le contexte de la tradition de l’Église et de l’usage qu’elle a fait au fil des siècles de certains termes-clef dans ses documents, c’est que la tradition est normative, un véritable principe fondamental du renouveau liturgique. Il le dit et le répète, nettement, catégoriquement et à plusieurs reprises, sans jamais subordonner le respect de la tradition à aucune autre considération.
Q – La constitution Sacrosanctum Concilium serait donc innocente des déviations de la réforme qui a suivi.
Pas si vite ! Si le principe fondamental de Sacrosanctum Concilium paraît relativement clair, force est de constater que les exemples d’instauratio qu’il propose le sont moins et sont conformes à un schéma, troublant, qui se répète de 1955 à 1970. Les nouveaux rites de la Semaine Sainte de 1955 sont dénommés Ordo instauratus dans le document qui les promulgue (Pie XII, Maxima redemptionis nostrae), et on les retrouve souvent cités, dans les décennies qui suivront, sous l’appellation de « Rites restaurés de la Semaine Sainte ». Mais il est difficile de cerner dans quel sens les changements subis par la Semaine Sainte en 1955 peuvent être décrits comme une « restauration ».
Mais plutôt que de se pencher sur cette boîte de Pandore, passons à d’autres exemples. Si Sacrosanctum Concilium fait peu de propositions concrètes, il y en a bien une qu’elle met en avant : un lectionnaire réparti sur plusieurs années (paragraphe 51), ce qui est entièrement dénué de tout précédent dans l’histoire de la liturgie catholique. Il ne décrit pas un tel lectionnaire comme exemple d’instauratio, mais selon les principes mêmes du document, ce devrait en être un.
Q – Une restauration, mais qui apporte du tout neuf. La réforme Montino-Bugninienne ne se voulait-elle pas, elle aussi, une instauratio ?
L’apothéose du problème viendra plus tard, lors de la promulgation du missel réformé, dans la constitution apostolique Missale Romanum de 1970. Là, le pape Paul VI, pour évoquer la prière eucharistique, se sert d’une expression remarquable : praecipua instaurationis novitas, expression tout bonnement traduite par « l’innovation majeure » sur le site du Centre National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle de la Conférence des évêques de France (le site du Vatican ne propose pas de version française). Mais une traduction à la lettre donne plutôt « la nouveauté notable de la restauration ». Autrement dit, on assiste à une restauration, et celle-ci contient des nouveautés. À ce stade il est clair qu’il se passe quelque chose de plutôt étrange.
Un apologiste de ce document pourra dire que la notion d’instauratio signifie ici ramener quelque chose à la vigueur, la faire s’épanouir, ou lui donner un meilleur fonctionnement. S’il cela implique l’introduction de nouveautés, soit. Mais une telle compréhension, qui, avec le recul, semble avoir été celle dans l’air en 1955, est elle-même une nouveauté. Elle implique le rejet du respect de la tradition dont j’ai parlé tout au long de cette présentation. Il fallait évidemment s’y attendre, puisque seul le contexte d’un tel rejet explique la réforme liturgique telle qu’elle fut réalisée.
Il est caractéristique des documents de l’époque et depuis que le principe fondamental pérenne qui guidait l’attitude catholique envers la liturgie pendant tant de siècles n’est jamais l’objet d’un rejet explicite. Au contraire, comme je viens de l’expliquer, Sacrosanctum Concilium lui donne une expression très claire. Au niveau des principes théologiques, la réponse à la question : Est-ce que Vatican II enseigne que la tradition n’est pas un principe liturgique normatif ? – demeure « non ». Au niveau de la mise en pratique, les choses se compliquent. La tension entre ce que Sacrosanctum Concilium affirme être le principe fondamental, et les changements qu’il a entérinés, lui et les papes avant et après lui, dans les faits, est problématique. Mais ce problème regarde ceux qui cherchent à défendre ces changements, non pas le mouvement qui se dévoue à la restauration de l’ancienne liturgie.
Q – Que diriez-vous pour conclure ?
On pourrait éventuellement critiquer la conception de la tradition que j’ai défendue ici en la qualifiant d’extrême ; mais mon souhait n’a été que d’identifier avec précision l’attitude catholique séculaire. C’était là l’attitude des catholiques de l’Antiquité et du Moyen Âge, qui correspond à une attitude largement répandue parmi les sociétés prémodernes. C’était l’attitude des catholiques de l’époque post-tridentine qui, sur fond d’une élite laïque à l’incompréhension toujours croissante, combattirent vigoureusement et finalement victorieusement les innovations liturgiques des protestants, jansénistes, et autres joséphistes. C’est l’attitude résumée par le verset archiconnu de saint Paul : ego enim accepi a Domino quod et tradidi vobis : « Car, pour moi, j’ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai aussi transmis » (1 Cor 11, 2). Et c’est là aussi l’attitude qu’implique la conception ratzinguérienne de la liturgie comme donnée. Quand tout cela est dit, si l’on change la liturgie, elle n’est pas une donnée.
La compatibilité de cette attitude avec le développement de la liturgie dans l’antiquité et au Moyen Âge est le problème central auquel je me suis intéressé. La réponse que j’ai pu y apporter, c’est que ce qui peut avoir un aspect de changement aux yeux de l’historien ne constitue pas un changement à la tradition sur le terrain : c’était un changement aux choses qui n’avait pas encore été incorporées au noyau intérieur et immuable de la liturgie par une pratique constante. Ceci nous amène aux aspects de la tradition dont on peut se servir aujourd’hui, de façon particulière, pour subvenir aux besoins de notre époque, et que de futures générations viendront peut-être un jour à considérer comme autant de développements de la liturgie, dans la mesure où ils se seront tellement bien établis en coutumes qu’ils en seront considérés comme normatifs.
Enfin, j’ai soutenu que cette attitude n’est pas en porte à faux avec les orientations réformatrices du Concile Vatican II, puisque chacun des mots traduits en français par « réforme » dans le texte de Sacrosanctum Concilium, veut en fait dire « restauration », et le même document précise que la révérence envers la tradition, accompagnée de confiance en la puissance de la tradition, est le principal fondamental de tout renouveau liturgique.