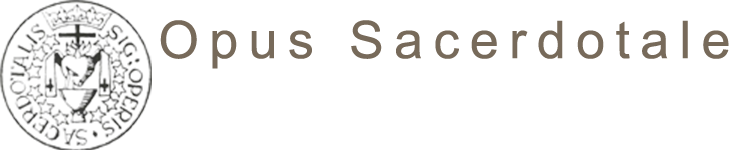Res Novæ nov. 2021
Res Novæ novembre 2021
L’interminable révolution conciliaire
Ce titre est celui de la conclusion très dense du dernier livre de l’historien Yvon Tranvouez, L’ivresse et le vertige. Vatican II, le moment 68 et la crise catholique[1]. L’historien considère Vatican II comme un événement global. En l’assimilant à la Révolution, il pose implicitement, en l’appliquant au Concile, la question du débat du bicentenaire de la Révolution en 1989 : cette « révolution conciliaire » est-elle ou non achevée ? Achevée, soit par une victoire définitive (comme la Révolution l’a été par l’avènement du gouvernement Ferry en 1880), soit par une restauration qui fermerait la parenthèse que l’événement de Vatican II aurait représenté. Elle n’est achevée dans aucun des deux sens.
Les chapitres du livre d’Yvon Tranvouez parcourent des sujets comme la crise catholique en terre de chrétienté (la Bretagne) au cours des dix années de liquidation (1965-1975), ou encore le choc des sciences humaines sur le clergé (lorsqu’il avait la culture et le loisir de s’y intéresser), et livrent aussi deux morceaux de bravoure, si l’on peut dire, constitués par deux études sur la psychologie et le parcours de Bernard Besret, le prieur explosif de Bocquen, qui a « fait » les textes conciliaires (la vie religieuse) avant de les traduire en « esprit », et du jésuite Michel de Certeau, « intermittent du spectacle sur la scène catholique de gauche », aussi difficile à comprendre qu’étonnamment clairvoyant sur la profondeur de la crise religieuse ouverte après le Concile, il avait relevé entre autres, dès 1976, que l’affaire Lefebvre avait établi un nouvel état des forces (ce qu’un étonnant motu proprio récent vient de souligner).
Yvon Tranvouez, un peu à la manière de son confrère Guillaume Cuchet dans son livre, Comment notre monde a cessé d’être chrétien. Anatomie d’un effondrement[2] – et dans sa récidive, Le catholicisme a-t-il encore de l’avenir en France[3], émet un jugement finalement très critique sur le discours que l’institution ecclésiastique tient et se tient à elle-même à propos de son histoire récente.
Une histoire tout entière attachée à Vatican II. Or, Vatican II est devenu un concile très daté. Il a voulu, dans les années 1960, rendre le message chrétien audible au monde de l’Amérique de Kennedy et répondre à ce qu’il estimait être ses interrogations. Mais le monde a depuis complètement changé et, de toutes façons, il ne pose plus de questions à l’Église (si tant est qu’il en posait vraiment alors : il lui suggérait plutôt des acquiescements, que désormais il exige brutalement). En fait, c’est ce qu’Y. Tranvouez qualifie joliment d’« émigration intégriste », impossible à résorber, qui explique principalement le « ressassement » de Vatican II. Nous parlerions pour notre part de mauvaise conscience, qui engendre un perpétuel discours de justification et de célébration.
« La rumination de Vatican II est d’autant plus étonnante qu’elle est, si l’on veut bien y réfléchir, à la fois équivoque et inutile », écrit Yvon Tranvouez. Rumination équivoque, parce que factice : « la réactivation artificielle du mythe conciliaire » d’une Église unie dans une réforme interne est illusoire ad intra, comme l’avait noté Michel de Certeau à propos de l’affaire Lefebvre, l’Église étant au reste devenue plus polyphonique que jamais, et illusoire ad extra, avec le monde, puisque l’optimisme des années 1960 s’est envolé. Rumination inutile, puisque désormais conservateurs comme progressistes se réclament de Vatican II.
Certes, le problème majeur est aujourd’hui « le divorce entre la mentalité contemporaine et le langage chrétien » (peut-il en être autrement ?), mais le langage rénové par le Concile, tout mystère s’étant envolé avec le latin (et avec une prédication au maximum aplatie), est encore plus incompréhensible – et plus évidemment inintéressant pour « les hommes d’aujourd’hui », dirions-nous.
Intéressant est le parallèle que l’historien fait entre l’histoire de la Révolution française et celle de Vatican II : l’ouverture de ce dernier, en 1962, ressemble à la tenue des États généraux, avec des documents transactionnels entre l’ancien et le nouveau, qui ne sont pas plus adaptés à la situation de l’Église créée par la déflagration conciliaire que n’était adaptée la constitution de 1791 à la France en révolution ; Mai 68 est comme l’accélération qu’avait provoquée sur le processus révolutionnaire la guerre en 1792 ; mais déjà, comme la Révolution, le Concile avait « dérapé », ce que dénonçait Jacques Maritain dans Le paysan de la Garonne, en 1966 ; élection en 1978 de Jean-Paul II, comme un 18 Brumaire. Avec une suite : Benoît XVI, en 2005, et son « verrouillage » (très relatif) ; puis François, en 2013, et sa tentative de remake de Vatican II (qui va accoucher d’un Synode parlant de la synodalité d’une Église en train de synoder).
« Aujourd’hui Vatican II, transformé en objet de célébration, est devenu au mieux vintage, au pire kitsch. »
[1] Desclée de Brouwer, août 2011.
[2] Seuil, 2018.
[3] Seuil, septembre 2021.
Du tohu-bohu théologique et de la démission du pape
La démission de Benoît XVI, en février 2013, restera un des principaux événements de l’après-Vatican II, peut-être même un événement-clé en ce sens qu’il a sans doute une valeur explicative qui dépasse les motivations du pape Ratzinger.
Dans la 20ème livraison de Res novæ, de juin 2020, nous parlions de cette étrange situation créée dans l’Église par l’absence de condamnation des hérésies. Nous donnions l’exemple allemand des époux de mariages confessionnels mixtes désireux de recevoir ensemble l’Eucharistie, exemple bien plus grave que les provocations du Chemin synodal allemand : la Congrégation pour la Doctrine de la Foi avait réuni des représentants d’évêques favorables et hostiles à la permission pour leur dire… que Rome ne décidait rien et leur demandait de trouver entre eux « un accord aussi unanime que possible ». L’autorité ecclésiastique se refuse de trancher : positivement par des énoncés se référant directement ou indirectement au charisme de l’infaillibilité dans les cas où la conduite du peuple chrétien le réclame ; négativement – ce qui est en fait la même chose – en se dispensant de condamner ceux qui s’écartent de la confession de foi. De facto, l’autorité s’abstient de jouer le rôle d’instrument d’unité (du moins d’unité au sens classique), et se présente comme gestionnaire d’une certaine diversité. Ne s’agit-il pas d’une sorte de démission morale, dont celle en acte de Benoît XVI a montré la possibilité ?
On a d’ailleurs vu paraître, depuis ce concile-tremblement de terre qu’a été Vatican II, une série d’œuvres de fiction dont le thème était précisément celui de la démission du pape. Ne sont-elles pas l’expression d’une sorte de cauchemar habitant désormais l’inconscient collectif catholique ? Nous en évoquerons trois.
En 2011, le film de Nanni Moretti, Habemus papam. Le cardinal Melville (Michel Piccoli) est élu, mais tombe immédiatement en dépression et l’annonce de son élection est retardée. Après divers épisodes (il est conduit chez une psychanalyste, puis retrouvé dans un théâtre), il apparaît finalement au balcon de Saint-Pierre pour refuser la charge : « Je ne suis pas le chef dont vous avez besoin », cependant que sur la place Saint-Pierre et sur toute l’Église s’abat le silence.
En 1998 avait paru le livre de Jacques Paternot et Gabriel Veraldi, Le dernier pape[1], roman d’anticipation, fort bien construit mais où le licencieux est trop présent, qui racontait qu’après la mort de Jean-Paul II, un cardinal brésilien est élu pape sous le nom de Mathieu Ier. Il permet le mariage des prêtres, la contraception, le sacerdoce des femmes, l’accès à la communion des divorcés remariés. Après quoi, il ne lui reste plus qu’à tirer la conclusion de tous ces actes « magistériels » : il réunit un concile pour parachever Vatican II, concile qui abolit le souverain pontificat.
L’œuvre la plus curieuse et la plus ancienne dans ce registre est un roman de Guido Morselli, Roma senza Papa[2] – Rome sans Pape, Gallimard, 1979 –, écrit dans l’immédiat après-Concile, en 1966 et 1967 (tous les romans de Morselli furent refusés par les éditeurs, et ne parurent qu’après son suicide, en 1974). Il est d’abord très clairement une expression du profond traumatisme créé par Vatican II. L’histoire, censée racontée par don Walter, un prêtre suisse marié, de tendance traditionaliste (il porte la soutane), se déroule en 2000. Au pape qui a succédé à Paul VI, Libero Ier (abolition du célibat ecclésiastique, décisions du pape soumises à l’approbation du Synode, etc.), succède Jean XXIV, sous lequel se continue le grand n’importe quoi : des théologiens parlent de « socialidarianisme », de l’introduction du totémisme dans la pratique religieuse ; on enseigne en dialogologie que le silence est la forme la plus achevée du dialogue interreligieux ; des jeunes prêtres défilent avec un brassard noir pour proclamer la théologie de la mort de Dieu ; un étudiant de l’Université Grégorienne, destiné au professorat, est d’ailleurs athée (l’idée de Dieu est subjective), ce dont ses supérieurs ne s’offusquent pas ; etc.
En fait, et c’est tout le thème du livre, Jean XXIV n’exerce plus sa charge, et pour le signifier, il a quitté Rome et s’est installé dans une résidence de type auberge ou motel, à Zagarolo, à 30 km de la Ville, où il mène une vie que Morselli qualifie de bucolique et qu’on dirait aujourd’hui écologique.
À la fin du roman, lorsque don Walter le rencontre avec un groupe de douze prêtres, le pape tient un bref discours improvisé qu’on pourrait comparer aujourd’hui à une homélie de Santa Marta, sur le thème : Dieu n’est pas prêtre. Enseignement ambigu, qui peut exprimer une pure évidence, ou au contraire viser le sacerdoce du Christ dont l’humanité est assumée par la Personne divine du Verbe, et du coup prôner la plus radicale des décléricalisations : le Christ n’est pas prêtre.
Enseignement non infaillible, pouvait se dire don Walter, comme nous nous le disons avec soulagement d’Amoris lætitia n. 301 (des personnes vivant dans l’adultère public peuvent y demeurer sans commettre de péché grave) ou de Nostra Ætate n. 2 (l’Église respecte les religions non chrétiennes). Enseignement qui donc n’enseigne pas à strictement parler, et qui est de fait une démission comparable à celles qu’imaginent ces fictions. Mais enseignement qui enseigne tout de même, au milieu d’un tohu-bohu théologique très semblable à ceux que décrivent ces mêmes fictions.
[1] L’Âge d’Homme.
[2] Adelphi, Milan, 1974.
Les vicissitudes contemporaines du droit pénal de l’Église
Par le Père Alexis Vernet
La Ciase (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église en France 1950-2020 dite « Commission Sauvé »), a publié son rapport le 5 octobre 2021, après trois ans de travaux à la demande de la Conférence des évêques de France (CEF). L’émotion était à son comble et le lynchage médiatique savamment orchestré. La liste des 45 recommandations égrène quelques inepties parmi lesquelles des exceptions au secret de la confession. Mgr de Moulins-Beaufort, président de le CEF, avait réagi immédiatement en rappelant que le secret sacramentel était plus fort que les lois de la République, ce qui provoqua une crise qui s’est conclue par une repentance dont les ecclésiastiques sont coutumiers, au mépris du c. 1311.
L’esprit du Concile
Quittons ces intrigues pour nous tourner vers les causes des dysfonctionnements originels du droit pénal de l’Église depuis plus de 50 ans (dont il est bon de rappeler qu’il concerne d’abord les délits contre la foi… secondairement les délits contra sextum). Pour cela nous prendrons appui sur l’analyse de la crise d’efficience de la législation pénale canonique d’Étienne Richer, prêtre et doyen honoraire de la faculté de droit canonique de l’Institut catholique de Toulouse[1]. Le constat est rude : « Si l’Église n’a point vocation à punir, et a fortiori moins encore à punir pour punir, elle ne saurait pour autant ignorer les délits lorsqu’ils sont commis par ses membres. Laisser impunis ou non suivis de mesures proportionnées des comportements incriminés par la législation canonique relèverait d’un déni de justice aux dépens des victimes qu’il s’agisse de personnes ou d’institutions. L’Église n’a pas non plus vocation […] à laisser des fidèles faire en son sein l’objet d’accusations […] sans discerner tenants et aboutissants et sans veiller au respect du droit naturel de la défense et au procès équitable. Entre laxisme et rigorisme se situe l’espace du droit et de la justice. »
La constitution apostolique Sacræ disciplinæ leges du 25 janvier 1983 précise que le nouveau Code pour l’Église latine « a mis en acte l’esprit du Concile. […] En un certain sens, on pourrait même voir dans ce Code un grand effort pour traduire en langage canonique cette doctrine même de l’ecclésiologie conciliaire. […] Il en résulte que ce qui constitue la nouveauté essentielle du Concile Vatican II, dans la continuité avec la tradition législative de l’Église, surtout en ce qui concerne l’ecclésiologie, constitue également la nouveauté du nouveau Code. » Parmi les éléments qui caractérisent cette ecclésiologie, la doctrine de l’Église comme communion. C’est ainsi que des théologiens, des historiens et des canonistes furent choisis pour participer au travail de révision complète du Corpus des lois canoniques de 1917 encore en vigueur après le Concile : il fallait que les travaux qui ont précédé le nouveau Code s’appuient sur le Concile une fois achevé. Il est donc nécessaire de reprendre le fil des travaux, non pas tant dans la rédaction de cette œuvre longue et complexe mais en la substance même des lois pénales élaborées sous l’inspiration de la doctrine de l’Église comme communion.
Étienne Richer donne le ton dans son livre sur la crise d’efficience du droit pénal dans l’Église : « Les années de l’immédiat après-Concile, qui furent aussi celles de la révision du Code, furent marquées, entre autres, par le renforcement d’une tendance qui, forte d’une sorte de vision romantique de la communion ecclésiale, portait à mettre plutôt dans l’ombre l’aspect disciplinaire, normatif et institutionnel de l’Église et de sa vie au point de ne guère laisser d’espace à la discipline et au droit en général, et a fortiori à tout ce qui relève des sanctions en particulier. »[2]
Le droit pénal au rabais du Code de 1983
Le Code de 1983 se limite à 89 canons et 2 parties en son Livre VI consacrées aux sanctions dans l’Église en excluant toute définition doctrinale. En comparaison celui de 1917 traitait du droit pénal en 220 canons et 3 parties dans son livre V des délits et peines. La matière a donc été nettement remaniée d’un Code à l’autre avec une attention accentuée sur l’utilité pastorale du droit pénal sous la poussée du courant dit « pastoraliste » du jésuite Peter Huizing animé par la revue Concilium. Seuls les exceptions aux lois, les non recours éventuels aux procès et aux sanctions canoniques, l’allégement des formalités juridiques ont une importance pastorale.
C’était oublier que la justice, les normes générales, les procès, les sanctions, chaque fois qu’ils s’avèrent nécessaires sont requis dans l’Église pour le bien des âmes. Le canon 6 du nouveau Code avait abrogé expressément toute autre loi pénale existant auparavant. Les travaux préparatoires ont été longs et les discussions retracées dans la revue Communicationes publiée par le Conseil pontifical pour les textes législatifs dans ses livraisons des années 2012-2017. Ces débats ont mis en lumière des questions fondamentales, à commencer par l’existence même d’un droit pénal de l’Église. La question a été posée lors des travaux d’élaboration du Code de l’utilité de maintenir un droit pénal après le Concile Vatican II.
Pour l’école du droit public ecclésiastique, qui a connu son apogée dans les années précédant le Code de 1917 qu’elle a profondément marqué, l’existence d’un droit pénal dans l’Église était évidente. Outre la tradition historique de la discipline pénitentielle dans l’Église ancienne et durant le Moyen Age, cette école soutenait que l’Église constitue une société juridiquement parfaite tout comme l’État et que le propre de toute société est de posséder un pouvoir coercitif sur ses membres. Le Code de 1917 s’inscrivait dans cette perspective, spécialement son livre V dont le c. 2214 § 1 affirmait le droit propre et originel de l’Église d’user d’un pouvoir coercitif.
A cette ecclésiologie fondée sur l’idée de société parfaite s’oppose une ecclésiologie fondée sur la notion de communion dont les grands promoteurs sont le cardinal Antonio Rouco Varela, Libero Gerosa et Eugenio Correco[3]. Cette école, partisane d’une Église-Peuple de Dieu contre l’Église-hiérarchie du Code de 1917, s’interroge sur le maintien d’un pouvoir coercitif dans l’Église. Ce pouvoir empiète sur la compétence du pouvoir civil et contredit la déclaration sur la liberté religieuse du Concile Vatican II. « C’est donc tout le droit pénal qui, dans cette théorie, doit perdre sa nature rétributive, pour devenir un système pénitentiel sui generis dans lequel la sanction principale, l’excommunication latæ sententiæ, n’a plus qu’un effet déclaratif d’une situation de non communion dans laquelle l’intéressé s’est lui-même placé. »[4]
Malgré tout, le droit pénal est maintenu in extremis, mais au rabais. Le premier canon du Titre I de la Première Partie du Livre VI c. 1311, dont la présence même tient du miracle, ne serait qu’un vestige suranné de nature « jusnaturaliste » incompatible avec la lecture du Concile Vatican II et la nouvelle conception du droit ecclésial ; ce canon « mal aimé » mais fondamental est formulé ainsi : « L’Église a le droit inné et propre de contraindre par des sanctions pénales les fidèles délinquants ». Mais ce droit pénal est relégué à un rôle supplétif. Ainsi le droit pénal « apparaît-il repoussé aussi loin que possible derrière l’impérieuse loi de charité » (Olivier Échappé).
La réforme « réactionnaire » de 2021, préparée par Benoît XVI
Le pape Benoît XVI a jeté un regard critique en ces termes : « Le droit pénal ecclésiastique avait fonctionné jusqu’à la fin des années 1950 ; il n’était certes pas parfait – il y a là beaucoup à critiquer – mais quoi qu’il en soit, il était appliqué. Mais depuis le milieu des années 1960, il ne l’a tout simplement plus été. La conscience dominante affirmait que l’Église ne devait plus être l’Église du droit mais l’Église de l’amour, elle ne devait plus punir. On avait perdu la conscience que la punition pouvait être un acte d’amour. […] Il y a eu dans le passé une altération de la conscience qui a provoqué un obscurcissement du droit et masqué la nécessité de la punition. En fin de compte est intervenu un rétrécissement du concept d’amour […] qui existe aussi dans la vérité. »[5] Une Église méprisant son droit aurait toute chance d’être non pas une Église de charité mais une Église de l’arbitraire.
Le remaniement de l’ordonnancement canonique était donc tel que le nouveau système pénal partit pratiquement « de zéro » après 1983. « Le nombre des délits caractérisés avait été réduit de manière drastique aux seuls comportements d’une gravité spéciale, et l’imposition de sanctions, soumises aux critères d’appréciation de l’Ordinaire [l’évêque pour faire court], qui étaient inévitablement différents. »[6] Le Secrétaire du Conseil Pontifical pour les Textes législatifs ajoute : « Certains canons du Code lui-même contiennent en effet des invitations à la tolérance qui pourraient parfois être indûment vues comme une volonté de dissuader l’Ordinaire de l’utilisation des sanctions pénales, là où cela serait nécessaire pour des exigences de justice ».
Le regretté cardinal De Paolis parlait d’« inadéquation du système pénal. » Le cardinal Ratzinger a adressé une requête dès le 19 février 1988, soit 5 ans après la promulgation du Code, où sont dénoncées les conséquences négatives produites par certaines options du nouveau système pénal. L’incurie des évêques est compensée par une forte centralisation vers les congrégations romaines (pour la Foi, pour le Clergé et pour l’Évangélisation des Peuples dont relèvent 50% des Églises particulières) et une inflation de textes correctifs. Concrètement, au ras des officialités, les procédures pénales ont été si rares que les juges balbutient, la jurisprudence étant quasi inexistante.
C’est pourquoi devant la misère du droit pénal Benoît XVI s’est attelé à une réforme en profondeur du livre VI. Après 12 ans de travaux le nouveau Livre pénal a été promulgué et entre en vigueur le 8 décembre 2021 : c’est de fait un retour à l’esprit du droit pénal de 1917 tant décrié durant les années postconciliaires.
[1] La lumière montre les ombres. Crise d’efficience et fondements du droit pénal de l’Église, Les Presses Universitaires / Institut catholique de Toulouse, 2016. Le titre énigmatique est tiré de la constitution Lumen Gentium, 8. L’auteur est un témoin privilégié de la crise traversée par la communauté des Béatitudes.
[2] Op. cit.
[3] « Fondements ecclésiologiques du Code de droit canonique de 1917 », Concilium, 107, 1975. Pour un approfondissement de la doctrine d’E. Correco et la radicalisation théologique des positions de son maître allemand Klaus Mörsdorf voir Errazurriz Carlos J., Il diritto e la giustizia nella Chiesa, Giuffrè, 2000.
[4] Échappé Olivier, « Le droit pénal de l’Église », dans Droit canonique, sous la direction de Patrick Valdrini, Précis Dalloz, 1999 (1989).
[5] Benoît XVI, Lumière du Monde. Le Pape, l’Église et les signes des temps, entretien avec Peter Seewald, Bayard, 2011.
[6] Arrieta Juan Ignacio, “L’influsso del cardinale Ratzinger nella revisione del sistema penale canonico” [L’influence du Cardinal Ratzinger sur la révision du système pénal canonique], La Civiltà Cattolica, 161/5 (2010). La subsidiarité et la décentralisation étaient l’un des principes directeurs pour la révision du Code.